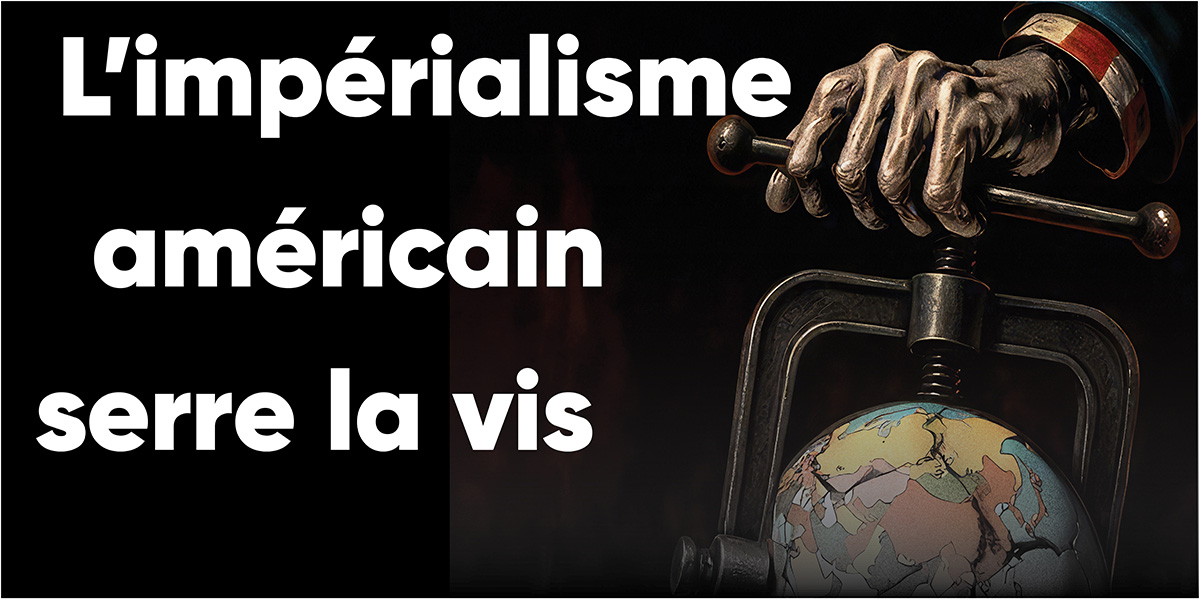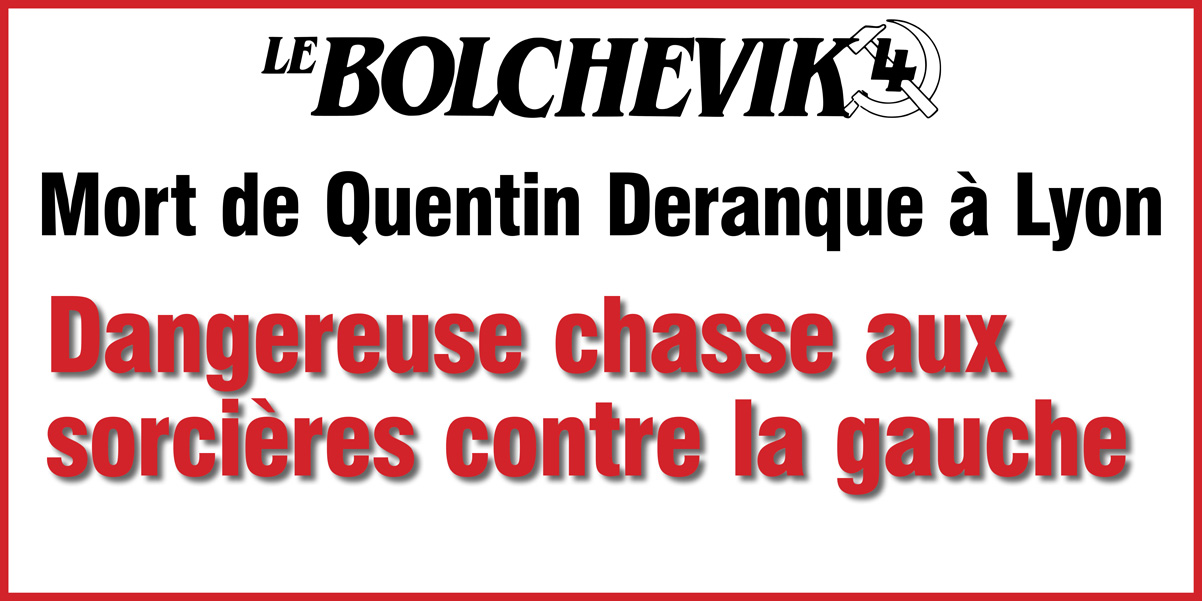https://iclfi.org/spartacist/fr/48/vis
Le mémorandum ci-dessous, rédigé par Vincent David, a été adopté par le plénum du Comité exécutif international de la LCI en avril dernier.
Introduction
La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a déclenché un séisme politique, et les premiers mois de son mandat confirment que nous sommes entrés dans une ère de profonds bouleversements mondiaux. Pourtant, la rapidité des événements n’a d’égale que la confusion qui règne parmi les commentateurs politiques et la gauche. D’un côté, certains commencent à comprendre des choses qui leur échappaient jusqu’ici. Parmi les libéraux et les socialistes, il est désormais courant de parler de la crise et de l’échec du libéralisme. De l’autre côté, panique et hystérie sont monnaie courante. Beaucoup ont réagi au discours de J. D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité en déclarant que les États-Unis abandonnaient l’Europe ou que c’était « la fin de l’Occident ». Certains pensent que Trump capitule devant la Russie, ou qu’il est un fasciste qui s’acoquine avec des gens de son espèce. D’autres pensent qu’il est tout simplement cinglé. Et à l’autre bout du spectre il y a ceux qui imaginent Trump et Elon Musk comme des cerveaux politiques qui purgeront le deep state (« l’État profond ») et inaugureront un âge d’or pour le capitalisme américain.
Si l’on veut y comprendre quelque chose, il faut mettre de côté la frénésie libérale et regarder la tendance sous-jacente à ces événements. Les États-Unis ne sont pas sur le point d’abandonner l’Europe, où ils ont d’énormes intérêts économiques et plus de 100 000 soldats. Trump ne capitule pas non plus devant Poutine. Il ajuste simplement la politique des États-Unis à la réalité du champ de bataille en Ukraine, afin de rediriger l’attention des États-Unis ailleurs. Et, évidemment, ce n’est pas la fin de l’Occident. C’est l’Occident libéral qui est à l’agonie.
La tendance de fond qui définit les changements dans le monde est le déclin relatif des États-Unis. Depuis 80 ans, ils sont la puissance hégémonique du monde capitaliste – et de la planète entière depuis la chute de l’URSS. Mais la suprématie des États-Unis contenait aussi les germes de son propre déclin. Son industrie, autrefois toute-puissante, a été en grande partie délocalisée dans le Sud global. L’armée américaine s’est étendue au-delà de ses moyens. Et d’autres pays, la Chine en particulier, ont connu une croissance économique substantielle. Pourtant, les États-Unis demeurent la superpuissance mondiale. Ils ont la mainmise sur la monnaie de réserve internationale et sur le système financier, tandis que l’armée américaine – toujours la plus puissante – reste le principal garant de la sécurité dans le monde. La contradiction croissante entre la position hégémonique des États-Unis et le déclin de leur puissance économique atteint désormais un point de rupture. Voilà ce qui explique les bouleversements actuels dans la situation mondiale.
Loin d’être cinglé, Trump représente un tournant fondamental dans la stratégie de l’impérialisme américain, visant à réaffirmer sa domination et inverser son déclin, ou du moins le ralentir. Pour cela, Trump cherche à réindustrialiser les États-Unis pour préparer la guerre, et à pressurer davantage ses alliés et néocolonies. La nouvelle administration rompt avec les institutions et les idées libérales qui avaient dominé le système américain pendant des décennies car elles sont devenues un obstacle au rétablissement de la position des États-Unis. Derrière les guerres commerciales, les négociations avec la Russie et les discours enflammés contre « l’ennemi intérieur » se profile une nécessité stratégique : constituer un bloc fermement aligné sur la politique commerciale et étrangère des États-Unis, afin d’isoler et d’asphyxier la République populaire de Chine, le principal rival économique des États-Unis.
Contrairement à une idée largement répandue, en particulier dans l’extrême gauche, la source des bouleversements dans le monde n’est pas la montée du soi-disant impérialisme chinois ou russe. La Chine a connu un développement économique sans précédent dans l’histoire de l’humanité, mais celui-ci s’est déroulé dans le cadre de l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Alors que les États-Unis s’efforcent d’isoler la Chine, la bureaucratie du Parti communiste à Beijing espère préserver l’ancien système mondial, mais sans la domination américaine – un pur fantasme. Quant à la Russie, malgré sa puissance militaire, son économie reste minuscule comparée à celle des États-Unis. Ce qui a poussé les oligarques à attaquer l’Ukraine, ce n’est pas l’expansionnisme du capitalisme russe mais la nécessité de réagir à la surextension des États-Unis jusqu’aux frontières mêmes de la Russie.
Malgré tout ce que peuvent dire les médias occidentaux, le monde reste bel et bien un empire américain. Ni la Chine, ni la Russie, ni les BRICS+ ne cherchent à dominer le monde, et aucun de ces États ne construit un système alternatif à celui des États-Unis. En fait ils cherchent simplement à se protéger de l’agression américaine. Mais pour la superpuissance mondiale, même ces gestes modestes constituent un défi fondamental, voire existentiel, à sa suprématie, et elle doit le confronter.
Cette réaffirmation de la domination états-unienne provoque des crises économiques et politiques majeures. De nombreux obstacles se dressent sur la route de cette stratégie impérialiste, et il y a un écart entre les objectifs et ambitions de la bourgeoisie américaine et sa capacité à les mettre en œuvre. La nouvelle administration est déjà confrontée à la colère d’autres pays. Sur le plan intérieur, bien qu’aucune force sérieuse ne menace Trump actuellement, l’opposition grandira. Et tôt ou tard, les attaques brutales de Trump se heurteront à la résistance de la classe ouvrière, aux États-Unis et à l’étranger.
Les dirigeants européens et canadiens font beaucoup de tapage en prétendant qu’ils vont résister aux exigences américaines. Mais ils restent dépendants des États-Unis et, à court terme, ils n’auront pas d’autre choix que de s’aligner. Une crise économique combinée à la pression de Washington accélérera probablement le virage à droite et facilitera la chute des politiciens libéraux européens et canadiens. En effet, à court terme, les forces les mieux placées pour profiter d’une récession sont les partis de droite populistes, qui gagnent du terrain partout en Occident. Cette lutte de factions au sein de la classe dirigeante promet d’être houleuse, les libéraux s’accrochant au pouvoir et utilisant tous les moyens pour le conserver.
La dynamique sera différente dans le monde néocolonial – Amérique latine, Asie, Afrique, etc. La plupart de ces pays sont déjà asphyxiés par l’impérialisme. L’étau que resserrent les États-Unis sera un désastre dans ces régions où il n’y a déjà presque plus rien à couper et où des centaines de millions de personnes vivent dans la misère la plus totale. La classe ouvrière et les masses opprimées vont être poussées à combattre la domination américaine et à résister au pillage du FMI. Nous avons déjà assisté à de telles révoltes ces dernières années.
En ce qui concerne la Chine, l’instabilité ne viendra pas de la pénurie de ressources, du moins à court terme, mais des contradictions internes de son système. Le régime du Parti communiste est constitué d’une caste bureaucratique qui cherche à concilier le capitalisme et une économie planifiée. Son modèle de croissance reposait sur l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Mais ceux-ci cherchent maintenant à isoler et à confronter la Chine. Une pression énorme va s’exercer sur les dirigeants du Parti communiste, à la fois de la part des capitalistes – dont les profits fondent – et de la gigantesque classe ouvrière chinoise – dont les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. La bureaucratie stalinienne devra pratiquer un jeu d’équilibre de plus en plus périlleux pour contenir ces forces contradictoires, allant de subventions à l’industrie et de phraséologie gauchiste à un renforcement de la répression. Mais cela ne suffira pas à retarder indéfiniment le choix fondamental auquel est confrontée la République populaire : soit la restauration du capitalisme, soit la révolution politique ouvrière.
En cette période d’offensive impérialiste, de réarmement et de crises croissantes, la question posée est la suivante : l’impérialisme américain sera-t-il vaincu ou continuera-t-il à entraîner le monde dans une spirale de réaction, de misère et de guerres ? Pour les communistes, la tâche historique consiste à forger des directions révolutionnaires capables d’unir les travailleurs et les opprimés et de mener à la victoire la lutte contre l’hégémonie américaine. Placer ses espoirs dans les staliniens chinois, les oligarques russes, les nationalistes ou les sociaux-démocrates en tout genre s’avérera fatal. Comme ils ne cherchent pas à renverser l’hégémonie américaine et puisqu’ils s’opposent à la révolution ouvrière, ils sont incapables de mener une lutte cohérente ou véritablement progressiste contre l’impérialisme. La libération des travailleurs du monde entier de l’oppression et de l’exploitation ne progressera et ne triomphera que sous la bannière d’une IVe Internationale reforgée.
L’objectif de ce document est d’orienter les révolutionnaires pour la période qui vient. C’est d’autant plus crucial que les forces révolutionnaires sont partout faibles, discréditées et terriblement désorientées. Nous espérons que ce document pourra contribuer à surmonter cet état de fait.
I. Marxisme contre gradualisme
Politiquement, les libéraux occidentaux, les sociaux-démocrates, les bureaucrates syndicaux, les partisans de l’alliance BRICS+, les staliniens chinois et de nombreux soi-disant révolutionnaires ont tous quelque chose en commun. Ils partagent différentes variantes d’une conception gradualiste et pacifiste de l’histoire et des relations internationales. Cette conception les paralyse face à la nouvelle offensive de Trump.
Pour les libéraux, le progrès social et la démocratie se développent graduellement au fil de l’histoire. De même, les sociaux-démocrates et les dirigeants syndicaux réformistes pensent que le développement des organisations de la classe ouvrière conduit petit à petit au progrès, voire au socialisme. Quant aux défenseurs des BRICS+, ils considèrent le développement graduel de la Chine, de la Russie et du Sud global comme une marche linéaire ascendante vers un nouvel ordre mondial plus juste et « multipolaire ». Partout, on retrouve la même tendance : les grandes dynamiques historiques sont réduites à un développement constant conduisant à un progrès graduel et progressif.
Malheureusement pour eux, le monde ne fonctionne pas comme cela. Tout au long de l’histoire, on peut constater que le développement graduel conduit à des chocs brusques et violents. Le capitalisme s’est développé progressivement au sein du système féodal pour ensuite briser son carcan par des guerres et des révolutions. La spéculation financière conduit progressivement à la crise économique. L’exploitation des travailleurs conduit progressivement à la grève. L’accumulation progressive de la quantité se transforme en qualité, non pas pacifiquement, mais par des chocs soudains. Et la force motrice du changement dans la société est la lutte des classes, qui conduit inévitablement à des confrontations violentes.
La prédominance des conceptions gradualistes chez beaucoup de gens de gauche reflète la stabilité relative des trois dernières décennies. L’hégémonie des États-Unis après la destruction de l’URSS a permis la mondialisation et l’expansion rapide du commerce mondial. Pratiquement tous les pays se sont soumis à la suprématie militaire et économique des États-Unis, ce qui permettait la libre circulation des capitaux tandis que les guerres impérialistes américaines se limitaient aux quelques pays qui défiaient leurs diktats. La croissance économique et le progrès social relatif donnaient l’illusion que le monde atteignait progressivement de nouveaux sommets. C’est cette base économique qui a nourri le libéralisme, l’idéologie dominante de la période postsoviétique.
Des milliardaires russes achetaient des équipes de football en Grande-Bretagne. Des magnats de l’industrie indienne acquéraient des villas de luxe en Californie. L’Union européenne était unifiée sous le signe de la paix et des valeurs libérales. Même les staliniens chinois ont troqué le col mao pour un costume-cravate, afin d’avoir l’air de capitalistes respectables. Les relations économiques semblaient organiques, naturelles et aussi « libres » que les flux commerciaux à travers le monde. Beaucoup de militants de gauche en étaient venus à oublier que l’impérialisme se maintient par la force. L’impérialisme était réduit à une vague notion économique d’« exportation du capital » – et, puisque la plupart des pays exportent du capital, l’impérialisme était à la fois partout et nulle part. Tout pays ayant une forte croissance du PIB, une grande armée et beaucoup de millionnaires était déclaré plus ou moins impérialiste, une simple question de degré sur une échelle de l’impérialisme.
En réalité, la période postsoviétique n’a été rendue possible que par la suprématie d’une seule puissance impérialiste : les États-Unis, qui sont parvenus à dominer le monde non par un processus pacifique et graduel, mais grâce à la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand carnage de l’histoire de l’humanité. La victoire des États-Unis leur a permis d’unifier toutes les anciennes puissances coloniales – le Japon, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie – au sein d’une alliance dirigée par les États-Unis pour confronter l’Union soviétique. Les États-Unis ont fini par dominer le monde entier en détruisant l’URSS par une contre-révolution capitaliste qui a renversé les acquis de 1917 et brisé le tissu social de la Russie et de l’Europe de l’Est.
Aujourd’hui, Trump met l’impérialisme américain sur le pied de guerre. Il renverse la mondialisation, rompt avec les valeurs et les institutions libérales et confronte la Chine. Ceux qui sont les plus choqués face à l’offensive de Trump sont toujours ceux qui s’accrochent au gradualisme. Ils ne voient pas que le déclin économique graduel des États-Unis allait inévitablement conduire à un virage soudain et brutal de la classe dirigeante américaine, qui est déterminée à défendre sa position par tous les moyens. L’avantage des marxistes, c’est précisément que nous comprenons que les empires naissent dans le feu de la guerre et qu’ils se maintiennent non seulement par les relations économiques mais aussi par la force. Et nous comprenons que l’empire américain ne quittera pas la scène de l’histoire graduellement et pacifiquement, il faudra le renverser par la force. C’est-à-dire « soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte », pour reprendre la formule du Manifeste du Parti communiste.
Mais de nombreux groupes marxistes pensent aujourd’hui que l’hégémonie américaine est déjà une chose du passé ! Ils pensent que la Russie et la Chine sont progressivement devenues des puissances impérialistes. Ils pensent que le monde a déjà été redivisé, que les États-Unis ont perdu leur position hégémonique pacifiquement, par le seul biais d’un développement économique graduel, sans guerre ni fracture majeure, et qu’à présent le monde est divisé en blocs impérialistes concurrents. Ils affirment souvent cela tout en se réclamant du léninisme. Pourtant, Lénine ne cessait de répéter que les guerres sont une caractéristique inévitable du système impérialiste et le moyen par lequel les grandes puissances se battent pour rediviser le monde en sphères d’influence. Réviser ainsi Lénine révèle une conception gradualiste consistant à nier que le monde demeure un empire américain et que sa puissance repose en dernier ressort sur son armée et ses 750 bases militaires réparties sur tous les continents.
D’une certaine manière, Trump le comprend mieux que les gradualistes. Il sait que pour consolider la position des États-Unis il doit préparer la guerre et étouffer la Chine. Et il sait que pour cela il doit écraser les libéraux et les mous qui se dressent sur son chemin. Au moins, Trump pourrait avoir pour effet de clarifier certaines choses pour nos gradualistes quant à la vraie nature de l’impérialisme et des relations internationales. Car ceux qui veulent combattre l’impérialisme américain doivent absolument se débarrasser de toute illusion gradualiste. Sans cela, il est impossible de comprendre le monde, où il va et, surtout, ce qu’il faut faire.
II. Comment fonctionne le système américain
Beaucoup de gens savent que les États-Unis dominent l’économie mondiale. Mais rares sont ceux qui comprennent vraiment comment cela fonctionne. Pour comprendre ce que fait Trump, il faut prendre un peu de recul et analyser les mécanismes utilisés par l’impérialisme américain, ses rouages, son fonctionnement et ses limites.
Ce qui a permis aux États-Unis de sortir victorieux de la Deuxième Guerre mondiale et de dominer tous leurs rivaux, c’est l’énorme puissance de leur industrie, grâce à laquelle ils s’étaient dotés de l’armée la plus forte. Les États-Unis ont pu ainsi imposer le dollar comme monnaie de réserve internationale (la monnaie utilisée pour la plupart des échanges internationaux et gardée en réserve par les banques et les gouvernements). Le dollar était alors indexé sur l’or (l’étalon-or), ce qui lui assurait sa stabilité. En gros, les États-Unis prêtaient de l’argent aux autres pays capitalistes qui, de leur côté, l’utilisaient pour acheter des biens fabriqués dans les usines américaines. C’est ainsi que s’est construit l’empire américain, les anciennes puissances coloniales étant cooptées en tant que partenaires subalternes pour dominer le reste du monde et affronter l’URSS. Pour la première fois, le monde capitaliste était unifié derrière la puissance et la monnaie d’un seul chef.
Mais au fur et à mesure que les États-Unis menaient la guerre dans le monde entier contre les alliés de l’Union soviétique et que l’Europe et le Japon reconstruisaient leur base industrielle, ces rapports se sont transformés. Les produits manufacturés américains devenaient moins compétitifs et les États-Unis ont commencé à décliner sur le plan économique. Les guerres aux quatre coins du monde pesaient lourdement sur le budget américain. Bien vite, pour financer l’augmentation des importations et leurs campagnes militaires, les États-Unis se sont mis à imprimer plus d’argent que leurs réserves d’or ne pouvaient garantir. Normalement cela aurait signifié la faillite. Mais les États-Unis ont pu retourner cette situation à leur avantage d’une manière tout à fait unique.
Comme les États-Unis importaient désormais plus qu’ils n’exportaient, les pays étrangers accumulaient d’importantes réserves de dollars, en comptant sur le fait qu’elles étaient convertibles en or. Mais le président américain Nixon limita la convertibilité du dollar en or, et abolit carrément l’étalon-or en 1971. Les États-Unis pouvaient désormais imprimer de l’argent sans aucune limite. De plus, ils exigèrent que les pays étrangers ayant des excédents en dollars achètent des bons du Trésor américain, autrement dit qu’ils prêtent de l’argent au gouvernement américain moyennant intérêt. Ainsi, à partir de ce moment, les pays étrangers fabriquaient des produits pour les États-Unis, obtenaient des dollars en échange et renvoyaient ces dollars aux États-Unis contre des bons du Trésor, lesquels servaient à financer un déficit budgétaire américain croissant. Les dollars revenaient également aux États-Unis sous forme d’investissements en Bourse ou d’achat d’actifs aux États-Unis (propriétés immobilières, etc.). En d’autres termes, les pays étrangers payaient pour les guerres des États-Unis, et puisque ceux-ci pouvaient imprimer des quantités illimitées de dollars, ils pouvaient également emprunter sans limites.
La fin de l’étalon-or provoqua une onde de choc dans le monde, entraînant troubles économiques et inflation. Les impérialistes européens étaient furieux de cette décision unilatérale, la France dénonçant ainsi le « privilège exorbitant » des États-Unis. Mais au final, l’Europe n’avait pas d’alternative. Les impérialistes européens, mais aussi les Japonais, bénéficiaient grandement de leur statut de partenaires subalternes de l’empire américain, qui garantissait leurs intérêts domestiques et étrangers. Refuser de céder aurait signifié rompre avec les États-Unis. Ils acceptèrent donc ce « privilège exorbitant » et les coûts économiques associés afin de conserver leurs avantages au sein de l’empire. Les États-Unis conclurent également un accord avec la monarchie saoudienne et les pays de l’OPEP pour qu’ils vendent leur pétrole uniquement en dollars et achètent des bons du Trésor américain, en échange de leur protection militaire. Cela obligeait tous ceux qui voulaient acheter du pétrole à détenir d’importantes réserves de dollars.
Quant au tiers-monde, il fut contraint à la soumission. Pour obtenir des dollars, ces pays étaient forcés de contracter des prêts à des taux exorbitants auprès des banques américaines. Lorsqu’ils ne pouvaient plus payer, le FMI les obligeait à mettre en œuvre des mesures d’austérité, à privatiser et à ouvrir leur marché aux entreprises américaines, plongeant ainsi des dizaines de pays dans une crise de la dette qui perdure encore aujourd’hui. Quant à ceux qui se tournaient vers l’URSS comme alternative, toute la puissance de Washington se déchaînait contre eux sous forme de sanctions économiques, de blocus ou même de coups d’État. L’ensemble du monde capitaliste se soumit aux États-Unis, soit parce qu’il y était contraint, soit en raison d’intérêts économiques dans l’empire américain. Dans tous les cas, ce fut possible parce que les États-Unis restaient la puissance militaire incontestée du monde capitaliste.
Le livre de l’économiste Michael Hudson explique :
« Les États-Unis ont réalisé ce qu’aucun système impérial antérieur n’avait mis en place : une forme flexible d’exploitation mondiale où ils avaient la mainmise sur les pays endettés en imposant le consensus de Washington via le FMI et la Banque mondiale, tandis que le système basé sur les bons du Trésor obligeait les pays ayant une balance des paiements excédentaire – en Europe et en Asie de l’Est – à accorder des prêts forcés au gouvernement américain. Contre les régions déficitaires en dollars, les États-Unis continuaient à appliquer le levier économique classique que l’Europe et le Japon n’étaient pas en mesure d’utiliser contre eux. Les économies endettées étaient contraintes d’imposer l’austérité, bloquant ainsi leur propre industrialisation et la modernisation de leur agriculture. Leur rôle désigné était d’exporter des matières premières et de fournir une main-d’œuvre bon marché dont les salaires étaient libellés dans une monnaie dépréciée. »
– Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire, ISLET, 1972 (troisième édition 2021)
Bien que Hudson parvienne à décrire brillamment les mécanismes d’exploitation du système américain, il les présente constamment comme des choix politiques erronés des dirigeants de Washington, qui auraient dû au contraire utiliser leur avantage pour faire le bien dans le monde. Ce qu’il nie, c’est que la création d’un mécanisme d’exploitation sans égal découle de la logique même du capitalisme à son stade impérialiste, c’est-à-dire qu’elle découle des intérêts matériels de la bourgeoisie impérialiste américaine.
Au fur et à mesure que le poids économique des États-Unis diminuait et que leur industrie devenait de moins en moins compétitive, la production nationale ne suffisait plus à elle seule à soutenir le coût de leur empire. Pour le maintenir, il fallait imprimer davantage d’argent fictif et extorquer toujours plus de valeur aux autres pays – par le biais de prêts forcés via les bons du Trésor américain, par le remboursement de la dette aux banques américaines ou par la fourniture d’une main-d’œuvre bon marché aux entreprises américaines. Plus les capacités productives des États-Unis diminuaient, plus ils avaient recours à des moyens parasitaires pour maintenir leur empire mondial. C’est cette contradiction entre le déclin des forces productives de l’économie américaine et le fardeau de l’empire qui ne cesse de s’intensifier, telle un élastique de plus en plus tendu et qui menace de rompre.
En 1991, l’Union soviétique s’effondra sous la pression massive de l’impérialisme américain. Soudainement, le système états-unien était étendu à l’ensemble du globe, ce qui permit aux États-Unis d’engranger d’énormes bénéfices tout en alimentant leur déclin. Le capital pouvait désormais s’étendre partout et conquérir de nouveaux marchés. Mais cela accéléra aussi la désindustrialisation des États-Unis et des autres puissances impérialistes, affaiblissant ainsi leur poids économique et renforçant la financiarisation. L’économie mondiale s’est alors davantage organisée autour d’un groupe de pays du Sud global – la Chine en particulier – dont la main-d’œuvre bon marché produisait des biens destinés aux États-Unis et à l’Occident, et d’un autre groupe de pays maintenus dans un état de pauvreté abjecte du fait de l’étranglement financier.
La Chine en particulier a connu un essor industriel sans précédent, exportant de grandes quantités de produits manufacturés vers les États-Unis et l’Occident. Elle accumulait d’énormes réserves de dollars, qu’elle réinvestissait dans des bons du Trésor américain. Dès les années 2000, la Chine détenait des centaines de milliards de dollars de dette américaine, ce qui inquiétait certains à Washington. Ainsi, la Chine a joué – et joue encore – un rôle important dans le système du dollar, comme nous allons le voir avec la crise de 2008. Cependant, la puissance industrielle de la Chine, la taille de son économie et le développement de ses relations commerciales ont commencé à éroder la domination des États-Unis. L’exemple le plus évident est l’initiative des nouvelles routes de la soie, le programme de la Chine pour développer son commerce en fournissant des projets d’infrastructure, des crédits et des biens bon marché aux pays du Sud global. Même si cette initiative s’inscrit dans le cadre du système américain (de nombreux investissements sont réalisés en dollars), elle ébranle néanmoins son fondement. Pour les dirigeants américains, la Chine devenait une menace croissante pour leur empire.
La crise financière de 2008 a révélé les faiblesses de l’empire américain. Toutefois, à court terme, elle a eu pour conséquence de renforcer le rôle du dollar. Pour éviter l’effondrement des banques, les États-Unis ont porté leur « privilège exorbitant » à de nouveaux sommets en imprimant d’énormes quantités de dollars pour les injecter dans les marchés boursiers. Comme leurs partenaires subalternes étaient également sur le point de s’effondrer, ils ont accordé des lignes de crédit illimitées aux banques centrales d’Europe et à d’autres alliés des États-Unis – les « lignes de swap ». Celles-ci sont devenues une caractéristique permanente du système financier, qui avait maintenant besoin de quantités toujours croissantes d’argent fictif pour éviter l’effondrement. Les pays du Sud global ont également obtenu des prêts du FMI pour éviter la faillite de leur économie. Tout cela a été payé par des programmes d’austérité massifs, y compris en Europe. Mais les États-Unis ont également financé tout cela en exigeant que la Chine achète d’énormes quantités de bons du Trésor américain. Soucieuse de stabilité, la bureaucratie du Parti communiste s’est exécutée, contribuant ainsi à soutenir le système du dollar tout au long de la crise.
Le même processus s’est répété pendant la pandémie, à un niveau encore plus élevé. Alors que l’économie mondiale piétinait, les États-Unis ont imprimé encore plus d’argent – plus que l’ensemble de leurs dépenses pendant la Deuxième Guerre mondiale, en dollars constants. Leurs alliés ont fait de même, en utilisant les lignes de swap. Le système a ainsi été poussé à l’extrême, provoquant l’inflation et une énorme bulle boursière. Le déficit américain a également explosé, au point où les États-Unis dépensent aujourd’hui mille milliards de dollars par an pour le seul paiement des intérêts. De plus, à la suite de la guerre en Ukraine, la Russie a été pour l’essentiel exclue du système du dollar. Non seulement c’était la première fois qu’une économie importante s’en faisait exclure depuis la guerre froide, mais cela n’a pas écrasé la Russie. En fait, la Russie a pu fonctionner et même gagner sur le champ de bataille. Tous ces facteurs et d’autres encore ont étiré le système impérial américain jusqu’à ses limites. Une nouvelle stratégie pour l’impérialisme américain est devenue urgente, et c’est précisément pourquoi Trump est en train de détruire le statu quo.
III. La crise économique qui vient
Les tarifs douaniers imposés par Trump font déjà des ravages sur les marchés boursiers. L’instabilité financière ne manquera pas de faire éclater l’énorme bulle spéculative qui s’est formée depuis 2008. Notre document de conférence de 2023 prévoyait qu’elle éclaterait plus tôt (voir « Le déclin de l’empire américain et la lutte pour le pouvoir ouvrier », Spartacist n° 46), mais le regain de spéculation sur l’IA et les nouvelles technologies a permis de la faire durer un peu plus longtemps. Cependant, aujourd’hui le boom de l’IA se tarit et la nouvelle administration américaine ne dépense plus d’énormes sommes comme auparavant. Une crise économique, ou du moins une récession majeure, est désormais une certitude.
L’impact d’une récession sera d’exacerber toutes les tendances économiques et politiques actuelles. Nous ne pouvons pas savoir exactement comment cela se passera, mais deux grands scénarios sont possibles : soit tout l’ordre de l’après-guerre volera en éclats, mettant fin à la domination du dollar américain, soit la majorité des pays accepteront à nouveau de se saigner pour sauver le système américain, qui se maintiendra sur une base encore plus oppressive. Nous pensons que cette seconde option est beaucoup plus probable, du moins à court terme.
Comme on l’a vu en 2008, une crise financière ne poussera pas les pays à sortir du dollar américain. En temps de crise, les dollars retournent aux États-Unis, perçus comme le pays le plus sûr, privant ainsi le reste du monde de liquidités. Et qui a la main sur le robinet du dollar ? Les dirigeants américains, bien sûr. Et maintenant que les États-Unis – qui restent le plus grand marché de consommation – ont imposé des tarifs douaniers à tout le monde, ils n’ont fait qu’accroître leur pouvoir sur les autres. C’est pourquoi, sur la scène mondiale, une crise économique n’affaiblira pas Trump, mais, en fait, renforcera sa main contre le reste du monde.
Les banques d’Europe, du Japon, du Canada et d’autres partenaires des États-Unis auront besoin d’un afflux massif de liquidités pour éviter l’effondrement. Elles se tourneront vers les États-Unis, qui exigeront un prix sous forme d’austérité et de concessions pour les entreprises américaines. On a beaucoup parlé de la possibilité que les États-Unis imposent un « accord de Mar-a-Lago » à leurs alliés – un plan visant à les forcer à acheter de nouveaux bons du Trésor américain avec un engagement à long terme et des taux d’intérêt faibles, à augmenter leurs dépenses militaires (en achetant des armes fabriquées aux États-Unis) et à contribuer à la dévaluation du dollar pour stimuler les exportations américaines. En d’autres termes, saboter leur propre économie pour soutenir celle des États-Unis tout en finançant le déficit américain à un taux beaucoup moins élevé. Face à la crise, la pression sur les alliés des États-Unis sera décuplée pour qu’ils acceptent un tel accord.
Dans les pays du Sud global, les investissements et les capitaux vont se volatiliser. Une crise fera également éclater les autres petites bulles spéculatives, comme celle du marché boursier en Inde. L’argent envoyé par les migrants travaillant à l’étranger (souvent en Occident), et qui constitue pour beaucoup de pays une énorme source de revenus et de liquidités, diminuera également. (Par exemple, ces transferts de fonds représentent 8,5 % du PIB des Philippines et 4,5 % de celui du Mexique. Il en va de même dans de nombreux autres pays.) Le manque de dollars se fera cruellement sentir, notamment pour rembourser la dette qui, dans des dizaines de pays, a atteint des niveaux historiques. Le FMI interviendra avec des programmes de « restructuration de la dette », qui se feront au détriment des dépenses publiques, des actifs nationalisés, des barrières protectionnistes et des recettes nationales.
Mais nombre de ces pays sont déjà à bout de souffle. Au Mexique, 70 % de la population reçoit une aide financière de l’État, sans laquelle beaucoup de gens ne pourraient plus se nourrir. Avec la crise, il est probable qu’un grand nombre de ces programmes sociaux seront supprimés. En Inde, seuls 10 % des 1,4 milliard d’habitants ont de l’argent disponible pour la consommation, tandis que 90 % vivent au jour le jour. Un resserrement supplémentaire ne manquera pas d’être explosif, notamment en attisant les divisions de castes et les divisions nationales et religieuses auxquelles le pays est déjà en proie. En Afrique du Sud le taux de chômage atteint déjà 32 %. Les États-Unis ont mis un point d’honneur à écraser ce pays, et une crise va certainement asphyxier davantage encore son économie.
Mais ce sont là des pays où les États-Unis et l’Occident ont des intérêts économiques et des investissements. Ils voudront les renflouer, certainement à un prix exorbitant. Il y a d’un autre côté toute une couche de pays que les impérialistes n’ont aucun scrupule à laisser dans un état de chaos total, tant qu’ils peuvent piller leurs ressources et que n’émerge aucune force capable d’unifier les populations contre leur saccage. C’est le cas d’une grande partie de l’Afrique orientale et centrale et de certains pays du Moyen-Orient, qui sont déjà ravagés par la famine et les guerres ; une crise réduira à néant les quelques revenus qu’ils tirent du marché mondial. On peut s’attendre à ce que les pressions économiques y alimentent encore davantage des guerres régionales et ethniques sanglantes ainsi que des flux de réfugiés de plus en plus importants.
L’état de misère déjà extrême qui règne dans l’ensemble du Sud global (à l’exception de la Chine et de la Russie) provoquera des explosions sociales et exercera une pression énorme sur les régimes. Les faibles bourgeoisies nationales seront de plus en plus contraintes d’osciller entre se soumettre complètement aux exigences américaines et s’appuyer sur les impulsions anti-impérialistes des masses. Dans les deux cas, cela se traduira par une tendance croissante au bonapartisme, voire à des coups d’État.
Quant à la Russie, sa transformation en économie de guerre a permis une certaine croissance malgré sa sortie du système du dollar américain. Le régime des oligarques est relativement solide, en particulier compte tenu de sa victoire imminente en Ukraine. Mais une crise fera chuter les prix du pétrole, l’une des principales exportations de la Russie, ce qui provoquera inévitablement des difficultés. Cependant, les problèmes plus sérieux pour la Russie viendront probablement après la guerre en Ukraine, lorsque la production de guerre s’arrêtera et que des dizaines de milliers de soldats seront démobilisés.
L’une des plus grandes questions que posera la crise qui vient est : que fera la Chine ? Comme on l’a vu, en 2008, les dirigeants du PCC ont effectivement soutenu le système du dollar en achetant d’énormes quantités de bons du Trésor américain. Comme les États-Unis devront à nouveau faire tourner la planche à billets, il est probable qu’ils exigeront à nouveau de la Chine qu’elle contribue à stabiliser l’économie mondiale. Comme les États-Unis cherchent ouvertement à asphyxier la Chine, on est en droit de penser qu’elle n’accédera jamais à leurs exigences. Toutefois, si l’on comprend que la bureaucratie du Parti communiste est une force conservatrice, intéressée avant tout à sa propre stabilité et à ses privilèges, et qui est prise en étau entre une classe ouvrière gigantesque et l’impérialisme américain, il est probable qu’elle voudra sauver le système du dollar en temps de crise. Nous ne pouvons pas savoir exactement comment cela se passera, ni si le PCC sera contraint d’adopter une position plus conflictuelle. Mais il ne faut jamais sous-estimer la détermination des bureaucraties staliniennes à chercher un accommodement avec l’impérialisme mondial.
Ces projections sont toutes basées sur les effets à court terme qu’une crise est susceptible d’avoir. Vu la mainmise des États-Unis sur la monnaie de réserve internationale et sur les flux de capitaux, leur position sera probablement renforcée. Mais cela ne sera vrai que dans un premier temps. Le monde n’est plus le même qu’en 2008. La mainmise des États-Unis est plus faible car ils font face à des défis croissants, et le prix qu’ils doivent exiger pour soutenir le système du dollar est plus élevé. Le pillage systématique du monde par le biais du système du dollar dépend avant tout de la volonté des partenaires impérialistes de l’Empire d’accepter leur subordination en échange de certains privilèges ; pour d’autres, de l’absence d’alternatives ; et pour le reste, de la contrainte pure et simple. À moyen et à long terme, chacun de ces acteurs pourrait, d’une manière ou d’une autre, rompre avec le système du dollar. Mais il ne s’agira pas automatiquement d’un phénomène progressiste. Cela ne peut l’être que si une telle rupture fait avancer la lutte de la classe ouvrière internationale contre l’ensemble du système impérialiste.
IV. La guerre en Ukraine
Aucune autre question n’a suscité autant d’hystérie parmi les libéraux que le tournant effectué par l’administration Trump concernant la guerre en Ukraine. Beaucoup ont crié à la trahison, accusant Trump de capituler devant un autocrate comme lui et d’abandonner l’Europe, laissée désormais seule à porter le flambeau de la liberté, de la démocratie et des valeurs de l’ordre d’après-guerre. Là encore, pour y comprendre quoi que ce soit il faut d’abord mettre de côté la frénésie libérale.
Contrairement aux affirmations du ministère ukrainien de la Défense, dont les rapports sur la situation militaire sont religieusement répétés par les médias et les politiciens libéraux, l’Ukraine est en train de perdre cette guerre. L’aventure de Zelensky à Koursk s’est soldée par un désastre complet ; sur toute la ligne de front, l’armée ukrainienne fait face à des pénuries d’hommes et d’armements et se fait anéantir. Pendant ce temps, les forces russes avancent partout, leur armée grossit et une offensive majeure semble se préparer. Alors que l’économie ukrainienne est en ruine, l’économie russe est en croissance malgré les lourdes sanctions, et elle a été réorganisée pour une production militaire massive. De plus, l’approvisionnement de l’Ukraine pour cette guerre industrielle de haute intensité a épuisé les stocks d’armements occidentaux à un rythme insoutenable. L’impuissance industrielle de l’Occident a été mise en lumière : alors que l’ensemble de l’OTAN peut produire collectivement 1,2 million d’obus par an, la Russie en produit à elle seule plus de 3 millions.
Ainsi, du point de vue de Washington, qui est de loin le principal fournisseur d’aide militaire, la politique d’hostilité totale à la Russie et de soutien à l’Ukraine jusqu’à la victoire s’est révélée être un échec coûteux. La nouvelle administration ne fait qu’accorder la politique américaine à cette réalité. Les États-Unis n’ont pas d’intérêts vitaux en Ukraine. Si la Russie représente un défi géostratégique pour les ambitions américaines, sa modeste économie ne constitue en aucun cas une menace du même ordre que celle de la Chine. C’est pourquoi, pour beaucoup dans la nouvelle administration américaine, trois années de guerre en Europe ont été un gaspillage de ressources qui auraient pu être utilisées à meilleur escient dans le Pacifique. La guerre en Ukraine a également renforcé les liens entre la Russie et la Chine, ce qui pose problème du point de vue des intérêts de Washington. Pour toutes ces raisons, il est logique pour les États-Unis de chercher non seulement à mettre fin à cette guerre – même si cela implique de faire des concessions à la Russie –, mais aussi à opérer un rapprochement économique et politique avec la Russie. Cela pourrait la ramener dans le giron occidental et l’éloigner de la Chine – ou au moins la neutraliser en tant que nuisance constante pour les États-Unis.
Du point de vue du Kremlin, l’Ukraine – un pays frontalier historiquement dans la sphère d’influence russe – est d’un intérêt vital. Les cris d’indignation sur l’expansionnisme russe ne font que masquer la réalité : depuis trente ans, c’est l’OTAN et l’UE qui se sont étendues jusqu’aux frontières mêmes de la Russie, malgré les objections constantes de cette dernière. Ce que veut Poutine, et ce qu’il cherche depuis longtemps, c’est un accord avec l’Occident pour garantir sa frontière occidentale, mettre fin à l’expansionnisme de l’OTAN et assurer l’emprise de la Russie sur l’Ukraine. C’est pourquoi il a accueilli favorablement bien qu’avec prudence les ouvertures de Trump. Cela dit, la classe dirigeante russe n’a aucun intérêt à embrasser l’Occident et à couper ses liens avec la Chine. Au contraire, de son point de vue, un accord avec les États-Unis serait bénéfique non seulement pour mettre fin à l’expansion de l’OTAN mais aussi pour lui permettre de jouer la Chine contre les États-Unis et vice versa, tirant des avantages des deux côtés pour développer l’économie russe.
Les récents changements ont montré combien ceux qui, dans l’extrême gauche, ont pris le parti de l’Ukraine ou de la Russie se sont lourdement trompés. Le principal argument des marxistes soutenant la Russie était que sa victoire porterait un coup aux États-Unis et serait donc progressiste. Mais la victoire russe imminente montre clairement la faillite d’une telle position. Car si les États-Unis sont effectivement en train de perdre cette guerre, ils ne se battent pas directement mais par procuration – via une armée supplétive. Cette caractéristique essentielle a été jugée sans importance par tous les « socialistes » pro-russes. Pourtant, c’est ce qui permet aux États-Unis de changer tout simplement de position, de jeter aux orties leur supplétif ukrainien et de chercher un accord avec la Russie pour piller conjointement l’Ukraine. Par conséquent, quel que soit le contenu d’un futur accord entre les États-Unis et la Russie (si accord il y a), la guerre de la Russie n’aura pas fait progresser la lutte contre l’impérialisme en Europe de l’Est, ni affaibli les États-Unis de manière fondamentale. Il en résultera au contraire l’oppression de l’Ukraine par la Russie, le réarmement de l’Europe et la réorientation des États-Unis pour affronter la Chine, autant de développements réactionnaires mais prévisibles.
Les marxistes soutenant l’Ukraine ont tout autant fait faillite. Leur principal argument reposait sur la nécessité de défendre la souveraineté d’une petite nation contre une agression étrangère. Mais la souveraineté de l’Ukraine ne pouvait être défendue que contre le gouvernement ukrainien. Pendant des années, le régime de Kyiv a mené une politique d’oppression à l’encontre de la minorité russophone – environ 20 % de la population – tout en menant une guerre pour conserver la Crimée et les régions de l’Est qui cherchaient clairement à faire sécession. En même temps, le régime de Kyiv s’est aligné sur l’OTAN, l’UE et les États-Unis et a cédé sa souveraineté militaire et économique à ces impérialistes. Cela n’a fait que transformer l’Ukraine en colonie occidentale tout en garantissant une hostilité totale de la part de la Russie, lui fournissant ainsi un prétexte de guerre idéal. La stratégie désastreuse de Zelensky consistait à lier le sort de l’Ukraine aux États-Unis, et son humiliation dans le bureau Ovale en est la meilleure illustration ; elle a tragiquement confirmé les paroles de Henry Kissinger : « Être un ennemi de l’Amérique est dangereux, mais être son allié est fatal. » Les marxistes qui ont défendu le gouvernement ukrainien, que ce soit de manière critique ou non, se sont ainsi retrouvés les idiots utiles dans le jeu des impérialistes.
La seule politique socialiste dans une telle guerre réactionnaire était – et demeure – de lutter pour la fraternisation des Ukrainiens et des Russes sur la base de l’opposition inconditionnelle à l’impérialisme occidental et à ses marionnettes ukrainiennes, de l’opposition au chauvinisme grand-russe et de la défense des droits des minorités russes. C’est la seule voie pour unir la classe ouvrière de toute la région. C’est ainsi que l’encerclement de la Russie par les impérialistes peut être brisé de manière progressiste, que la liberté de l’Ukraine peut être garantie et que l’ensemble de l’Europe de l’Est peut être libérée de l’oppression nationale. Cette perspective a toujours été confrontée à d’importants obstacles, mais elle demeure la seule voie progressiste. Le mouvement ouvrier n’a pas réussi à adopter une politique indépendante – ses dirigeants se rangent soit derrière les impérialistes et leurs sous-fifres, soit derrière les oligarques russes ; cela garantit maintenant que l’issue de cette guerre sera un désastre pour les travailleurs d’Ukraine, de Russie et de toute l’Europe.
Les négociations entre la Russie et les États-Unis n’en sont qu’à leurs débuts et pourraient durer des mois. Alors que les États-Unis souhaitent conclure la guerre au plus vite, la Russie n’est pas pressée. Elle est en train de gagner sur le champ de bataille, elle prépare de nouvelles offensives et ne voit aucune raison de faire des concessions. Cette situation sera problématique pour les États-Unis, qui chercheront à limiter les dégâts. De plus, ils doivent gérer leur supplétif ukrainien ; ils l’ont renforcé pendant plus de dix ans en nourrissant les ultranationalistes ukrainiens, qui ne sont pas connus pour leur attitude conciliante à l’égard de la Russie. Jusqu’à présent, les Ukrainiens font tout pour faire échouer les négociations. La question n’est donc pas de savoir si Zelensky sera renversé, mais quand, comment et par qui. Les États-Unis doivent également composer avec l’hostilité d’une grande partie des élites européennes ainsi que d’une partie de leur propre classe politique.
Compte tenu des forces d’inertie en Occident, il se peut que la Russie doive d’abord enregistrer de nouveaux gains militaires en effectuant une percée majeure sur la ligne de front, y compris jusqu’à Kyiv – ce qui n’est plus une hypothèse farfelue. La voie serait alors libre pour un accord entre les États-Unis et la Russie aux conditions de cette dernière. Il s’agirait notamment de garantir la mainmise de la Russie sur les quatre régions de l’Est de l’Ukraine, de renverser le régime de Zelensky, de mettre fin au soutien de l’OTAN à ce qui reste de l’Ukraine et de mettre un terme à l’expansion de l’OTAN vers l’est. Certaines sanctions pourraient être levées, mais il reste à voir si les relations commerciales avec l’Europe reviendront aux niveaux d’avant 2014. En échange, les États-Unis s’appuieront probablement sur la Russie pour qu’elle les aide dans d’autres domaines, par exemple en faisant pression sur l’Iran pour qu’il abandonne son programme nucléaire.
Mais un nouvel accord de sécurité entre les États-Unis et la Russie aurait une conséquence plus fondamentale : l’Europe se ferait écraser dans le cadre d’un accord réactionnaire. Ni les États-Unis, maîtres de l’Europe, ni la Russie n’ont intérêt à l’instabilité sur le vieux continent. Elle a toujours été de mauvais augure pour la Russie, et les États-Unis ont besoin d’une Europe stable pour concentrer leur attention ailleurs. La Russie, avec sa puissance militaire, ses abondantes ressources naturelles et son réservoir de conservatisme religieux, pourrait très bien faire cause commune avec le capital financier américain et son nouvel establishment chrétien réactionnaire pour écraser l’Europe libérale. Un rapprochement entre les États-Unis et la Russie serait ainsi un facteur de stabilité conservateur et réactionnaire en Europe.
Ce fut d’ailleurs le rôle de la Russie dans la politique européenne tout au long du XIXe siècle : un bastion de la réaction sur lequel la Grande-Bretagne, la grande puissance de l’époque, pouvait s’appuyer pour stabiliser l’Europe. Si la situation est évidemment différente aujourd’hui, un accord américano-russe pour déterminer la politique européenne est dans l’intérêt de la Russie et de l’impérialisme américain, d’autant plus que ce dernier cherche à promouvoir un réalignement politique fondamental sur le continent.
V. Europe et Amérique
Les négociations de Trump avec la Russie, l’humiliation de Zelensky dans le bureau Ovale, l’imposition de droits de douane et le discours de J. D. Vance dénonçant l’ensemble des élites libérales européennes comme l’« ennemi intérieur » ont provoqué une onde de choc dans toute l’Europe. En l’espace de quelques semaines, la Maison Blanche a lancé une série d’attaques contre l’ordre européen fondé sur la mondialisation, le libre-échange, les valeurs libérales et l’hostilité à la Russie – un système construit pendant des années sous la direction des États-Unis et garanti par leur puissance militaire. La panique s’est emparée des élites européennes. Pendant des années, les politiciens libéraux, de plus en plus détestés par leur propre population, pouvaient au moins se consoler en sachant qu’ils restaient dans les bonnes grâces de la superpuissance mondiale. Ce n’est plus le cas. La nouvelle administration Trump a marqué la mort du libéralisme dans tout l’empire américain, et l’Europe libérale est une cible prioritaire pour ses desseins de réalignement politique.
Trump veut obtenir davantage de concessions de l’Europe pour consolider la position des États-Unis, notamment en ce qui concerne les dépenses militaires et les termes des échanges commerciaux. Loin d’abandonner l’Europe, les États-Unis en ont besoin pour consolider un bloc contre la Chine qui soit plus agressif et mieux à même de contribuer à la puissance militaire des États-Unis. Le problème, toutefois, est que pour cela l’Europe a besoin d’un sérieux réalignement politique. Les institutions européennes et les structures de gouvernance ont été construites pour servir l’ancien ordre libéral. L’Union européenne, cet énorme appareil bureaucratique lié à d’innombrables institutions libérales, a d’importants intérêts économiques ancrés dans le statu quo. Et l’Europe est toujours dirigée par des politiciens comme Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Pedro Sánchez, etc. – des dirigeants dont la carrière s’est construite dans le vieil ordre libéral et qui s’accrochent à celui-ci. Ces dirigeants européens représentent à bien des égards l’énorme fossé politique qui existe entre l’ancienne Europe postsoviétique et la nouvelle administration américaine de droite.
Après l’humiliation de Zelensky par Trump, Kaja Kallas, cheffe de la politique étrangère de l’UE et belliciste antirusse notoire, a déclaré que « le monde libre a besoin d’un nouveau leader » et que « c’est à nous, Européens, de relever ce défi ». D’innombrables commentateurs et politiciens libéraux ont tenu des propos similaires, appelant l’Europe à enfin tracer sa propre voie, indépendamment des États-Unis, pour défendre les valeurs libérales, affronter la Russie et soutenir l’Ukraine plus longtemps. Cela ne fait que souligner à quel point les dirigeants européens vivent dans un monde parallèle. En réalité, toutes les grandes économies européennes sont dans un état de stagnation lamentable. À l’exception partielle de l’Allemagne, elles ont presque entièrement perdu leur base industrielle, et leurs économies reposent en grande partie sur la finance, les services et le tourisme. Partout sur le continent, les infrastructures tombent en ruine et la population vieillit. Sur le plan militaire, l’Europe est actuellement incapable de soutenir une guerre conventionnelle d’envergure. Ses armées, petites et obsolètes, dépendent toutes de la puissance aérienne, de la logistique, du renseignement, des lignes d’approvisionnement et des systèmes de commandement américains pour toute opération sérieuse.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a beau répéter que l’Europe dans son ensemble est plus forte que la Russie, ce n’est pas vrai pour autant. L’Europe est balkanisée en une multitude de pays aux intérêts divergents. Ce que les libéraux oublient toujours, c’est que l’unité européenne a toujours été un produit de la suprématie américaine. Seule la domination économique et militaire des États-Unis sur l’Europe depuis 1945 a rendu possible l’unité européenne et a empêché le continent de se déchirer à nouveau. C’est pourquoi les ambitions des dirigeants européens de prendre la direction du « monde libre », de construire une « coalition de volontaires » ou d’acquérir une « autonomie stratégique » pour l’Europe ne sont que des lubies. L’Europe est totalement dépendante des États-Unis, tant sur le plan militaire qu’économique. À court terme, et probablement même à moyen terme, ni l’Europe ni aucune des puissances européennes ne jouera ni ne pourra jouer le moindre rôle indépendant des États-Unis.
Derrière les fanfaronnades, les déclarations enflammées et le déni de la réalité dans les cercles dirigeants européens se cache un décalage qui s’est accentué au fil du temps. Il existe une contradiction croissante entre la superstructure politique de l’Europe – ses institutions, son idéologie, sa bureaucratie, ses politiciens, etc. – et sa base économique réelle – son état de faiblesse totale et sa dépendance à l’égard des États-Unis. Tôt ou tard, cette contradiction devra être résolue, et l’Europe n’aura d’autre choix que de se débarrasser de son libéralisme dépassé et de se ranger derrière les États-Unis. La montée des partis populistes de droite représente cette tendance croissante (AfD en Allemagne, RN en France, Reform UK en Grande-Bretagne, FPÖ en Autriche, Meloni qui est déjà au pouvoir en Italie, etc.). L’administration américaine favorise ces partis moins parce qu’elle est d’accord avec eux que parce qu’ils sont la seule force capable de briser le statu quo libéral d’une manière qui serve au mieux les intérêts des États-Unis.
Car jusqu’à présent, le centre politique tient toujours en Europe. Le fait que de nombreux dirigeants se sentent suffisamment forts pour résister (partiellement) aux exigences américaines et défendre (mollement) le statu quo libéral reflète des intérêts économiques bien ancrés. Il s’agit en premier lieu des capitalistes européens qui ont grandement profité du système en place depuis trente ans, qui résistent au changement et qui, souvent, ne font pas entièrement confiance aux partis de droite émergents, du moins pour le moment. Ensuite, l’inertie des institutions et de la bureaucratie européennes pèse lourdement. Enfin, dans les pays européens avancés, il existe encore une classe moyenne substantielle, souvent liée aux institutions européennes, qui jouit d’un niveau de vie relativement élevé et qui sert de base principale aux partis du centre. Cela s’applique également à la Grande-Bretagne. Les formalistes de gauche peuvent bien répéter mécaniquement que le Parti travailliste est un parti ouvrier-bourgeois – ce qui conserve une part de vérité –, la réalité c’est qu’actuellement la base de soutien du Parti travailliste est dans la classe moyenne urbaine, pas parmi les ouvriers.
La tendance ci-dessus s’est clairement exprimée lors des élections allemandes de février. Alors que les voix pour l’AfD ont considérablement augmenté (en particulier parmi les travailleurs), les partis traditionnels ont malgré tout conservé une vaste majorité de l’électorat, signe que le libéralisme allemand n’est pas encore tout à fait mort. Le score en hausse du Parti de gauche, qui a été célébré par la plupart des partis d’extrême gauche dans le monde, provient en fait presque entièrement d’électeurs petits-bourgeois venus des Verts et doit être interprété comme une défense du statu quo libéral. En Allemagne comme ailleurs, la popularité des partis de droite anti-establishment provient principalement de la classe ouvrière, en particulier de ses couches inférieures, mais aussi de secteurs de l’aristocratie ouvrière.
Ainsi, l’Europe continue d’être dominée par ces politiciens « de transition » – Macron, Starmer, Merz et Cie – qui ont un pied dans la défense de l’ordre libéral européen et un pied dans la réaction de droite pour couvrir leur flanc droit, avec pour résultat que pratiquement tout le monde les déteste. Ces gouvernements, comme la plupart des gouvernements européens, sont généralement arrivés au pouvoir pour faire barrage à l’« extrême droite » ; ils sont totalement discrédités dans la population et ne tiennent qu’à peu de chose. Cependant, leur chute et leur remplacement par la droite – presque inévitable à ce stade – ne sera pas un processus pacifique et linéaire mais le résultat de crises politiques et économiques aiguës. Sur le papier, les élections en Grande-Bretagne et en Allemagne se dérouleront dans plusieurs années. Macron a encore deux ans avant les prochaines élections présidentielles, et les élites françaises viennent d’interdire à Marine Le Pen de se présenter. Les libéraux useront de tous les stratagèmes pour rester au pouvoir. Mais compte tenu du réalignement politique exigé par les États-Unis ainsi que du fossé entre la base économique de l’Europe et les idées et ambitions de sa classe politique, cette situation ne peut pas durer.
La crise économique qui vient mettra à nu le caractère complètement pourri des économies européennes. On peut s’attendre à ce qu’un choc économique, combiné à d’importantes mesures d’austérité, frappe de plein fouet la classe moyenne et les travailleurs. Le réarmement se fera également au détriment du système de protection sociale, qui reste important dans certains pays. Le mécontentement massif, qui existe déjà, ne fera que croître. Il en résultera une grave crise politique qui rendra impossible le maintien au pouvoir de ces politiciens de compromis ; ils devront céder leur place à des dirigeants plus résolus.
Dans les pays européens opprimés par l’impérialisme, la dynamique politique est bien entendu différente. La Serbie et la Grèce ont été secouées récemment par des mouvements populaires de masse contre leur gouvernement, alimentés par la colère contre le pillage impérialiste. Dans ces pays, la petite bourgeoisie est beaucoup plus appauvrie, tout comme la classe ouvrière. La Grèce en particulier a déjà traversé une crise majeure dans les années 2010, qui a dévasté de larges pans de la population. Une crise économique et l’austérité auront un caractère beaucoup plus explosif dans ces pays, ce qui augmentera la menace d’un régime bonapartiste. D’autre part, on peut regarder vers la Hongrie pour se faire une idée de la direction que prendra l’Europe sur le plan politique. Le Premier ministre Viktor Orbán, un chrétien réactionnaire proche de la Russie et des États-Unis, a longtemps été la bête noire de l’UE pour son opposition au libéralisme. Aujourd’hui pourtant, il apparaît comme un politicien en avance sur son temps.
Compte tenu de la situation actuelle de la classe ouvrière, une crise économique risque d’avoir un effet démobilisateur plutôt que d’encourager la combativité de la classe ouvrière, du moins dans un premier temps. L’augmentation du chômage et la dévastation du niveau de vie de la classe ouvrière et de la classe moyenne ne constituent pas un contexte favorable aux luttes de la classe ouvrière. De plus, une crise économique accélérera la dynamique politique actuelle qui, pour l’instant, favorise les partis de droite anti-establishment. En effet, dans la dernière décennie la gauche n’a nulle part réussi à s’imposer comme force politique sérieuse, précisément en raison de son soutien au statu quo libéral, poussant ainsi de plus en plus de travailleurs vers la droite. De nombreux ouvriers ont vu leurs conditions de vie dévastées et, face à une gauche engluée dans le libéralisme, se sont tournés vers le poison anti-immigrés comme seul canal pour exprimer leur colère.
D’importantes luttes syndicales ont également eu lieu en 2022-2023, comme le mouvement des retraites en France et la vague de grèves en Grande-Bretagne. Ces luttes étaient d’importantes occasions pour faire pencher le rapport de force en faveur de la classe ouvrière et positionner le mouvement ouvrier comme une alternative réelle contre le statu quo. Mais tous ces mouvements ont été conduits à la défaite par leurs propres dirigeants, qui ont refusé d’organiser une véritable confrontation avec la bourgeoisie. Et le plus souvent ces traîtres étaient soutenus par l’extrême gauche. En Grèce récemment, nous avons assisté de nouveau à une occasion manquée avec le mouvement de Tempé, où les dirigeants du mouvement ouvrier se sont montrés totalement impotents. Ces trahisons ont gravement affaibli la position de la classe ouvrière et ont alimenté le glissement vers la droite.
Ce qui renforcera également les partis de droite, c’est que la gauche en Europe continue de s’accrocher au libéralisme, à l’UE, à l’écologisme ou aux armes pour l’Ukraine (une grande partie d’entre elle soutient maintenant ouvertement le réarmement) – toutes choses que les travailleurs détestent. Et la gauche continue d’adhérer aux « fronts populaires » de la bourgeoisie pour faire barrage à la droite, dont le seul effet est de renforcer l’attrait de celle-ci parmi les travailleurs et de discréditer davantage la gauche. La seule force de gauche issue des mouvements des années 2010 qui ne s’est pas encore complètement évaporée, c’est Mélenchon et La France insoumise. Mais eux aussi s’accrochent au poids mort du Parti socialiste et embrassent le front républicain anti-RN, ce qui ne fait qu’aider le RN à gagner des voix dans la classe ouvrière.
Dans ce contexte difficile, la tâche des communistes est de lutter au sein de la classe ouvrière pour la placer dans une meilleure position défensive. L’heure n’est pas aux offensives inconsidérées. Des attaques massives se profilent à l’horizon et le mouvement ouvrier en Europe est faible et divisé. Ses organisations ne sont plus que l’ombre de ce qu’elles étaient, et elles sont souvent des coquilles vides. Les syndicats sont pour la plupart stratifiés par statut d’emploi, divisés par profession et limités à certaines couches de l’aristocratie ouvrière. Les communistes doivent être à l’avant-garde de la lutte pour surmonter ces divisions, renforcer les organisations ouvrières et mener des actions défensives. Cependant, à chaque étape, cela doit se faire en opposition totale à la bureaucratie syndicale. Les communistes doivent forger des fractions luttant pour une stratégie communiste dans les syndicats capable de lier les besoins immédiats des travailleurs à la nécessité du pouvoir ouvrier, tout en dénonçant la trahison des bureaucrates syndicaux. C’est ainsi que les communistes pourront regagner leur autorité dans la classe ouvrière et saper l’attrait de la droite.
Il se peut que les restes affaiblis des mouvements libéraux contre la droite s’agitent encore un moment. Toutefois, il s’agira des derniers soupirs d’une espèce en voie de disparition. Avec la bourgeoisie libérale sous pression des États-Unis, et la petite bourgeoisie confrontée à la crise, il n’y aura plus de base sociale pour des mouvements libéraux de masse en faveur de la démocratie, des droits des immigrés, etc. Ce seront des couches de plus en plus petites de militants de gauche qui essaieront de les maintenir en vie, discréditant ainsi encore plus la gauche aux yeux de la classe ouvrière (c’est ce qu’on voit actuellement aux États-Unis). Nous devons intervenir dans ces milieux, mais il faut lutter avec ces militants de gauche pour qu’ils se réveillent, qu’ils abandonnent le libéralisme et qu’ils se tournent vers la classe ouvrière. Nous devons nous battre pour reconstruire les mouvements de défense des immigrés, des musulmans et contre la droite, mais en opposition à l’impasse du libéralisme et sur une base ouvrière et anti-impérialiste – y compris contre l’UE.
Ces tâches s’appliquent également aux pays opprimés (Balkans, Europe de l’Est, etc.), mais là, il s’agit de lier la lutte contre la misère à celle pour libérer le pays de l’oppression impérialiste. Cela exige également de dénoncer sans relâche les directions à la tête des masses, qu’il s’agisse de nationalistes, de staliniens ou de bureaucrates syndicaux, pour leur conciliation avec les États-Unis et l’UE. Ou encore pour leur refus de lier la lutte des masses à celle contre l’oppression étrangère du pays. C’est la seule voie pour unir tous les opprimés et les minorités nationales, et pour gagner les travailleurs et les jeunes à une stratégie de lutte de classe pour l’émancipation nationale et sociale des nations opprimées.