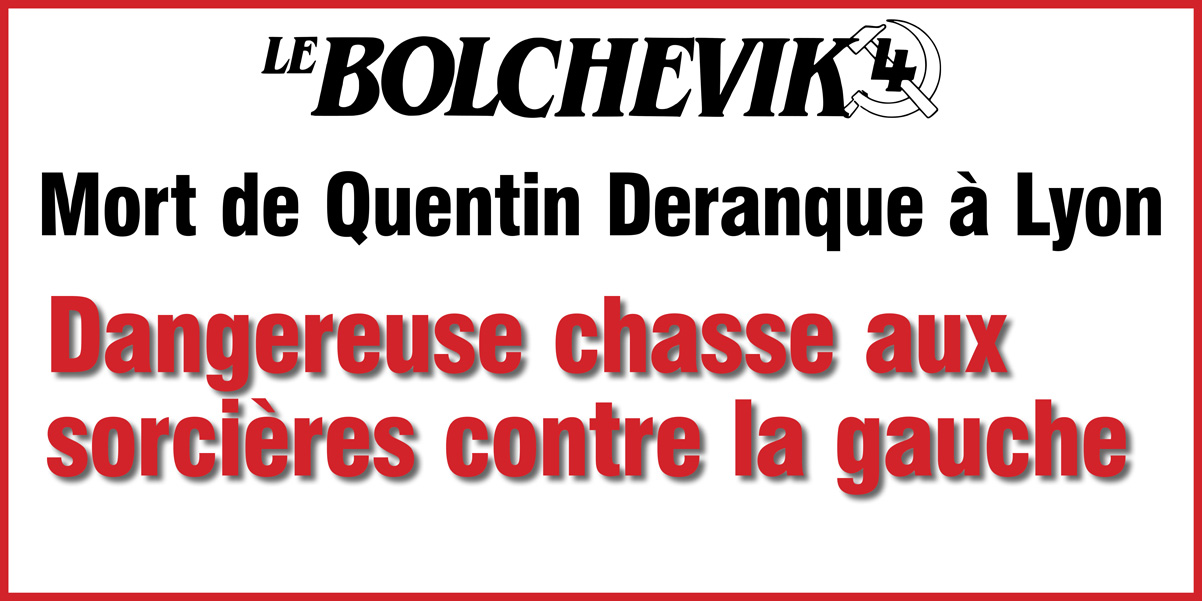https://iclfi.org/spartacist/fr/48/trans
De retour au pouvoir, Donald Trump n’a pas perdu de temps pour décréter une série de mesures anti-trans. Ces nouvelles attaques accentuent la tendance internationale déjà en cours. Pour les réactionnaires de toute sorte, les avancées limitées dont bénéficient les personnes trans sont la preuve de la dégénérescence morale et sociale de l’Occident. Plus que tout autre groupe, les personnes transgenres ressentent le vent de droite qui balaie la scène politique. Partis et personnalités qui hier encore avaient une position libérale sur la question transgenre prennent aujourd’hui leurs distances. D’abord ils ont évité la question, mais très vite les libéraux d’hier ont compris que ce n’était pas suffisant ; ils doivent se joindre au chœur réactionnaire, leur carrière parmi les élites en dépend.
Pourquoi le mouvement transgenre est-il à ce point dans la ligne de mire de la réaction ? Bien que le mouvement LGBTI+ soit parfaitement conscient du changement radical dans l’opinion publique, il ne peut généralement pas en expliquer les raisons. À cause de cela, il n’y a pas de stratégie claire sur comment organiser une riposte dans ce contexte hostile. Le mouvement transgenre se retrouve de plus en plus isolé et désorienté, incertain de la marche à suivre et sur qui compter.
Le mouvement marxiste n’a jusqu’à présent pas été en mesure de combler ce vide. De nombreux soi-disant marxistes adoptent ouvertement des positions anti-trans réactionnaires en utilisant des méthodes d’analyse plus proches de celles de l’Église catholique que des grands théoriciens marxistes. D’autres gardent tout simplement le silence sur la question. Les marxistes qui ne restent pas silencieux et qui dénoncent les attaques contre les personnes trans ne proposent ni réponses ni perspectives sérieuses. En général, ils se contentent d’ajouter du verbiage et des éléments d’analyse marxistes à un programme fondamentalement libéral.
Le présent article vise à combler ce vide. Pour commencer, nous développerons une explication matérialiste des « guerres culturelles » en expliquant pourquoi elles ont lieu maintenant et pourquoi on ne peut y répondre par des moyens libéraux gradualistes. Dans un deuxième temps, nous présenterons une analyse marxiste de la question transgenre, en opposition à l’empirisme réactionnaire du discours anti-trans ainsi qu’à l’idéalisme libéral qui domine dans le mouvement pro-trans. En nous appuyant sur ces deux bases, nous commencerons ensuite à élaborer un programme ouvrier pour la libération transgenre, appliqué au contexte de la montée de la réaction et la trahison des libéraux.
Première partie :
Le gradualisme et les courants de l’histoire
Selon l’opinion dominante dans le mouvement LGBTI+ contemporain, l’histoire a ses hauts et ses bas mais, pour reprendre la formule de Martin Luther King, « l’arc de l’univers moral est long, mais il tend vers la justice ». Les gays et lesbiennes ont fait face à des vagues de panique morale dans les années 1950 et à la fin des années 1970, mais les attitudes et la politique à leur égard se sont en fin de compte libéralisées. Aujourd’hui, dans de nombreuses sociétés, les gays et lesbiennes sont intégrés dans la culture dominante et acceptés partout dans le spectre politique. On pouvait penser, et certains le pensent toujours, que la même chose se produira pour les personnes trans : malgré les présents revers, tôt ou tard on retrouvera la bonne voie.
Mais déjà ce refrain sonne faux pour de nombreuses personnes transgenres. Beaucoup se tournent vers la gauche, en quête de réponses plus radicales. Même Shon Faye, une auteure libérale de gauche, écrit dans son livre très informatif The Transgender Issue (La question transgenre, 2021 – non traduit) qu’« il ne peut y avoir de libération trans sous le capitalisme ». Mais ce radicalisme accru ne se traduit pas nécessairement par des conclusions révolutionnaires. Par exemple, Faye écrit également que « le seul espoir des personnes trans pour faire promulguer au Parlement des mesures progressistes passe par le lobbying interne et, en fin de compte, l’élection du Parti travailliste ». Il est donc possible de croire que le capitalisme est incompatible avec les droits trans mais de préconiser tout de même les réformes par étapes plutôt que la révolution.
Par conséquent, les marxistes ne peuvent s’en tenir au lieu commun que la libération des personnes trans ou des femmes est incompatible avec le capitalisme. Ils doivent montrer pourquoi il faut des méthodes ouvrières révolutionnaires pour parvenir à la libération, et non des moyens réformistes libéraux. Pour cela, il faut confronter l’illusion sous-jacente que les progrès pour les personnes LGBTI+ étaient possibles auparavant et le seront certainement à nouveau. Nous allons le faire en montrant quelles étaient les circonstances spécifiques qui ont rendu ces réformes possibles, comment ces circonstances sont en train de disparaître rapidement et pourquoi il est suicidaire de penser qu’elles reviendront.
De la réaction au libéralisme
Pour comprendre comment la condition des groupes sexuellement opprimés a évolué au fil du temps, il faut aller plus loin que les idées et les attitudes dans la tête des individus. Marx et Engels disaient que les « pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle » (L’idéologie allemande, 1845-1846). Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la classe capitaliste américaine est la classe qui domine le monde sur le plan économique, politique et militaire. C’est pourquoi les idées dominantes sur la sexualité ont évolué en parallèle des intérêts et des objectifs de l’impérialisme américain.
Au plus fort de la guerre froide, lorsque la domination capitaliste était menacée, la priorité de l’impérialisme américain était d’assurer la stabilité intérieure face à un ennemi extérieur. Ce n’est pas un hasard si la « Lavender Scare » des années 1950 (une panique morale vis-à-vis des homosexuels au sein du gouvernement américain) était étroitement liée à la chasse aux sorcières anticommuniste maccarthyste. Ce n’est pas non plus un hasard si la croisade d’Anita Bryant contre l’homosexualité, à la fin des années 1970, a coïncidé avec la nécessité pour les États-Unis de se remettre des revers politiques et militaires qu’ils avaient subis dans les années 1960 et 1970.
En règle générale, il n’y a pas d’arme plus puissante pour écraser la gauche et unifier un pays sur des objectifs réactionnaires que de s’appuyer sur les préjugés sociaux les plus conservateurs concernant la sexualité et la famille. De nombreux militants ouvriers prêts à se faire tabasser et à aller en prison pour leurs convictions s’effondrent à l’idée d’être soupçonnés de déviances sexuelles. La classe dirigeante américaine a longtemps fait usage de campagnes de panique morale contre les « déviances sexuelles » comme instrument de contrôle social.
Cela dit, après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis n’avaient plus d’ennemi extérieur redoutable contre qui se mobiliser. L’objectif était plutôt d’étendre leur influence économique et sociale aux quatre coins de la planète. Dans ce contexte, les principes universalistes de liberté, de démocratie et de droits de l’homme étaient les outils idéologiques parfaits pour justifier l’ingérence et la domination états-uniennes. De plus, comme la lutte des classes était au creux de la vague et que les États-Unis n’avaient pas de rivaux géopolitiques sérieux, la classe dirigeante américaine pouvait se permettre des normes sociales plus souples au niveau national et pouvait déchaîner l’esprit indomptable et profitable de l’individualité consumériste.
Cependant, malgré tous les discours sur le progrès et la liberté dans les années 1990, la libéralisation de l’homosexualité, en particulier le droit au mariage, était encore considérée comme un tabou par la plus grande partie des élites politiques aux États-Unis. Ce n’est qu’après la crise financière de 2008, sous la présidence d’Obama, que le mariage homosexuel a été légalisé. À l’époque, la bourgeoisie cherchait à abaisser le niveau de vie de la classe ouvrière tout en maintenant la paix sociale à l’aide d’un vernis progressiste. Les réformes sur des questions sociales comme le mariage étaient parfaites, puisqu’elles ne coûtaient rien économiquement et qu’elles constituaient des prolongements naturels des principes libéraux de tolérance et de liberté de choix individuelle. Paradoxalement, c’est seulement parce que l’ordre mondial libéral a littéralement fait faillite que la classe capitaliste a pu progresser autant vers la libéralisation sexuelle.
Pendant cette période, des réformes similaires ont été menées un peu partout dans le monde occidental, par exemple en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Au fur et à mesure que le fondement économique de la domination occidentale s’érodait et que les classes dirigeantes impérialistes s’attaquaient aux conditions de vie matérielles, elles se sont de plus en plus appuyées sur les idées libérales pour compenser le déclin de leur pouvoir. C’est pourquoi le discours pro-LGBTI+ est devenu dominant dans la sphère culturelle et politique de la plupart des pays occidentaux : les séries télévisées mettaient en scène des protagonistes homosexuels et c’était la norme que les grandes entreprises, les politiciens et les flics défilent dans les marches des Fiertés. Non seulement ce positionnement donnait aux libéraux une couverture hypocrite de progressisme, mais aussi il offrait un bâton commode pour taper sur les travailleurs, les immigrés et les pays du tiers monde ; toute forme d’opposition au statu quo libéral pouvait être facilement contrée par des accusations d’arriération et de chauvinisme.
Ainsi, bien que la libéralisation sociale soit assurément progressiste, les raisons économiques qui expliquent son expansion au début du XXIe siècle étaient ancrées dans des dynamiques économiques régressives et dans des intérêts de classe réactionnaires. Cela n’efface pas les luttes longues et acharnées menées par des générations de militants LGBTI+, mais cela explique pourquoi elles ont eu autant de succès et pourquoi le mouvement est devenu moins radical et de plus en plus compatible avec le grand capital.
La question trans et le déclin de l’hégémonie américaine
Dans l’ensemble, la condition des personnes trans a suivi la même trajectoire que celle des gays et des lesbiennes, mais avec un retard significatif. Les droits des personnes trans et la sensibilisation du public à cette question perçaient tout juste dans l’opinion dominante quand la réaction populiste a commencé à prendre son essor. En 2014 le magazine Time publiait en première page une photo de l’actrice transgenre Laverne Cox, accompagnée du titre « Le point de bascule transgenre – La prochaine frontière des droits civiques en Amérique ». Un an plus tard, Donald Trump annonçait sa première candidature à la présidence.
Il se trouve que la question trans n’était pas seulement la prochaine frontière du libéralisme aux États-Unis, mais bien sa dernière frontière. C’était la limite jusqu’où pouvait aller la libéralisation sexuelle avant de se heurter à un mur. Si les libéraux sont allés aussi loin sur les questions LGBTI+ et d’autres questions sociales, c’était pour compenser le déclin de leur influence sociale. Mais alors que les libéraux avançaient de plus en plus, la réaction contre le libéralisme ne faisait que se renforcer. Les forces conservatrices perçoivent cette faiblesse croissante et elles utilisent désormais la question trans comme fer de lance pour renverser le statu quo libéral des dernières décennies.
D’un côté, la question trans incarne les limites du réformisme libéral sur la question de la sexualité. Les idées de libre choix et de tolérance se heurtent aux limites économiques et sociales du capitalisme. La pénurie de ressources matérielles et les intérêts conservateurs institutionnels rendent impossible le dépassement de l’organisation sociale fondée sur la famille hétérosexuelle monogame – une question que nous examinerons plus en détail ci-dessous.
Mais en même temps, la question trans incarne aussi les limites de l’ordre mondial libéral que les États-Unis avaient construit après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aujourd’hui au point où les bases économiques et sociales de cet ordre entrent en conflit avec les intérêts de la classe dirigeante qui les a établies. Le libéralisme devient de plus en plus une entrave à la tentative des États-Unis de restaurer leur position dans le monde. Si la question trans est en première ligne des guerres culturelles, c’est parce qu’elle représente un point de bascule entre l’ordre libéral à l’époque de l’hégémonie des États-Unis et l’ordre réactionnaire émergent né du déclin de l’empire américain.
Pour une large couche de la classe ouvrière, le libéralisme est devenu le symbole de tout ce qu’elle déteste dans le statu quo. Pendant des décennies on lui a demandé d’avaler des attaques économiques et la décomposition du tissu social au nom d’idéaux creux. Aujourd’hui, la droite peut facilement se saisir de ce mécontentement pour attiser une réaction sociale généralisée. Les premières cibles sont les minorités, mais le véritable objectif est de mettre l’impérialisme occidental sur une voie plus belliqueuse contre la classe ouvrière domestique et contre ses rivaux étrangers. Avec une bourgeoisie et une classe ouvrière qui s’éloignent du statu quo des dernières décennies, l’ordre social qui avait rendu possibles certaines réformes pour les personnes LGBTI+ entre dans une crise terminale. Voilà le facteur sous-jacent du conflit qui fait rage sur la question trans.
La seule perspective de progrès substantiels pour les femmes et les minorités sexuelles serait une nouvelle période soutenue de prospérité économique mondiale. Mais c’est totalement exclu, étant donné que les capitalistes américains sont déterminés à maintenir leur emprise sur le monde et ne peuvent le faire qu’en intensifiant la concurrence internationale et en faisant baisser le niveau de vie (voir « Le déclin de l’empire américain et la lutte pour le pouvoir ouvrier », Spartacist n° 46, novembre 2023). En dernier ressort, ce sont les réalités économiques d’un monde dominé par l’impérialisme qui excluent tout progrès significatif pour les groupes opprimés, quels qu’ils soient. C’est aussi ce qui exclut une voie gradualiste et réformiste pour la libération trans.
Deuxième partie :
Démêler le genre
Derrière les guerres de genre
Les débats sur la question trans portent souvent sur des définitions. Avant de plonger dans ces eaux troubles, examinons les enjeux politiques derrière les batailles sur le genre, le sexe et la biologie. Beaucoup d’écrits sur la question commencent par énoncer des définitions qui servent ensuite de base pour argumenter en faveur d’une perspective politique donnée. Bien que cette démarche semble logique à première vue, elle confère en réalité au débat un faux air d’objectivité. Derrière les conflits de définitions il y a des conflits d’intérêts. C’est pourquoi, avant de donner nos propres réponses et définitions, nous allons commencer par identifier les objectifs politiques des mouvements trans et anti-trans, ainsi que notre propre conception communiste du monde.
Comme le mot « transgenre » le suggère, les personnes trans sont des individus souhaitant être acceptés dans la société sous un genre distinct de celui sous lequel ils ont été socialisés précédemment. Le mouvement transgenre comme mouvement politique cherche à rendre possible et socialement acceptable de faire cette transition. La façon dont ce mouvement explique le monde, et les différents arguments qu’il élabore, découlent tous de cet objectif politique.
Ce qui unit les militants anti-trans, qu’ils soient TERF (acronyme anglais désignant les féministes anti-trans), motivés par la religion, misogynes ou même pseudo-marxistes, c’est de lutter contre l’acceptation sociale des personnes trans. Bien sûr, ces différents courants ont des intérêts différents et souvent en conflit. Mais ils sont unis dans leur volonté de rendre plus difficile, voire impossible, l’acceptation sociale des personnes trans dans le genre auquel elles s’identifient. Les théories et les arguments divers qu’ils élaborent visent tous cet objectif politique.
Comme on peut le voir, même si une grande partie du débat sur la question trans se concentre sur le sexe biologique par opposition au genre, sur la définition de la féminité et ainsi de suite, ce n’est pas le cœur du sujet. La question est simplement de savoir s’il est socialement souhaitable et possible que des individus puissent faire la transition d’un genre vers un autre. Tous les conflits sur les concepts tournent autour de cette question fondamentale.
En tant que communistes, notre objectif politique est de parvenir à une société d’abondance pleinement égalitaire, sans classes ni aucune autre forme d’oppression, y compris celle causée par la division genrée de la société. Nos objectifs sont par conséquent compatibles avec ceux du mouvement transgenre et ils les recoupent. Nous pensons sans ambiguïté que oui, les individus devraient pouvoir changer de genre et, de manière générale, faire ce qu’ils veulent de leur propre corps. La société doit également faciliter cette transition. Mais au-delà de cela, nous pensons que la lutte pour la libération sexuelle, y compris la libération trans, est une cause non seulement compatible avec la lutte pour l’émancipation de la classe ouvrière, mais aussi indissociable de ses luttes quotidiennes dans la société actuelle. En d’autres termes, la tâche n’est pas d’attendre un avenir communiste, mais de lutter aujourd’hui pour faire avancer cette cause.
Ce qui nous distingue, en tant que communistes, c’est que nous considérons que la lutte pour la libération des personnes transgenres fait partie intégrante de la lutte plus large pour l’émancipation de la classe ouvrière. Une autre distinction importante par rapport au mouvement transgenre concerne les moyens et les méthodes avec lesquels nous cherchons à atteindre nos objectifs politiques. Dans notre combat, nous sommes guidés par la doctrine du socialisme scientifique, c’est-à-dire le marxisme.
Biologie et société
Les discours contre l’acceptation et l’intégration des personnes trans se concentrent en grande partie sur les questions de biologie. L’argument de base est qu’il existe une différence biologique indéniable entre les hommes et les femmes et que prétendre qu’une femme trans est une femme, c’est rejeter la science la plus élémentaire. Vient alors la question inévitable posée sur les plateaux télé et par les youtubeurs provocateurs : « Qu’est-ce qu’une femme ? » Toute réponse qui n’insiste pas sur les différences biologiques essentielles entre les hommes et les femmes est ridiculisée et rejetée.
Il y a indéniablement des différences biologiques fondamentales et qualitatives entre les hommes et les femmes ; cela dit, ces différences ne disent pas grand-chose sur ce que signifie être un homme ou une femme dans une société donnée. Il est tout simplement faux de penser que les rapports sociaux sont déterminés par la biologie. En fait, l’évolution humaine elle-même contredit ce mythe et montre une interaction constante entre le développement de la culture et de la technique et les changements anatomiques. Par exemple, le développement du langage et l’utilisation d’outils ont directement conduit à la croissance du cerveau humain ; autrement dit, la culture a modifié la biologie. On voit donc que la biologie n’est pas le facteur décisif pour comprendre les rapports sociaux entre humains.
Somme toute, les différences biologiques entre les sexes ne sont ni indépendantes des rapports sociaux entre hommes et femmes ni déterminantes pour ces rapports. Le fait de pouvoir mettre au monde des enfants a une signification dans toutes les cultures, mais ce que signifie concrètement être une « femme » change radicalement d’une culture et d’une époque à l’autre. Réaffirmer les caractéristiques biologiques d’un être humain de sexe féminin ne dit rien sur ce que signifie être une femme vivant dans une société occidentale moderne, ou une femme vivant dans un village traditionnel en Afrique subsaharienne. C’est pourquoi il est trompeur et contre-productif de centrer le débat sur la question transgenre dans les sociétés capitalistes modernes sur les différences anatomiques entre hommes et femmes.
La question piège « qu’est-ce qu’une femme ? » vise à amalgamer la signification biologique et la signification sociale du fait d’être une femme. Pour y répondre, il faut séparer ces deux questions. Parfois, les démagogues rendent cela impossible. Mais trop souvent, ce sont les voix pro-trans elles-mêmes qui contribuent à embrouiller la question.
Spectre et dichotomie
En réponse aux idéologues anti-trans et à la société en général qui insistent sur les différences biologiques fondamentales entre les hommes et les femmes, de nombreux intellectuels trans ont attaqué à tort l’idée même qu’il existe une dichotomie entre la biologie masculine et la biologie féminine. La plupart de ces intellectuels ne nient pas qu’il existe des différences importantes entre hommes et femmes, mais ils insistent sur le fait que ces différences se situent sur un continuum et que la binarité des sexes est une invention pure et simple. À l’appui de cet argument, ils soulignent la grande variabilité des caractéristiques physiques de chaque sexe et le fait que, pour certaines personnes intersexes, il n’est pas possible de les classer sans ambiguïté comme biologiquement masculines ou féminines.
Dans sa révolte contre les catégories sociales rigides, l’universitaire trans Jack Halberstam s’attaque au fait même d’attribuer des « catégories » au monde naturel :
« La manie adamique de nommer tout ce qui bouge a commencé, sans surprise, avec l’exploration coloniale. Toute personne ayant visité un jardin botanique ou zoologique le sait : la collection, la classification et l’analyse de la faune et de la flore du monde vont de pair avec les diverses formes d’expansion et d’initiative coloniale. »
– Trans*, Libertalia, 2023
S’il est bien vrai que la science s’est développée en même temps que le capitalisme et ses nombreux crimes, le problème n’est pas de « nommer » ou « classifier », ni d’ailleurs la science. On ne peut tout simplement pas comprendre le monde, qu’il soit naturel ou social, sans catégories et sans noms. Et si on ne peut pas comprendre le monde, on ne peut pas le changer.
Le point essentiel, c’est qu’il n’y a rien de rétrograde à reconnaître qu’il existe effectivement un ensemble de différences biologiques qualitatives entre les hommes et les femmes, ou entre les plantes. Accepter une dichotomie ne remet pas en cause le fait qu’il existe une grande variation au sein des catégories ni qu’il existe certains cas spécifiques qui sont difficiles à classer. Tout dans la nature combine des catégories distinctes et des états transitoires intermédiaires.
Par exemple, l’évolution des espèces se produit à travers un processus où l’accumulation de différences génétiques mineures conduit finalement à l’émergence d’un type d’animal ou de plante fondamentalement différent. Il est généralement impossible de déterminer le moment exact où la quantité devient qualité. Mais cela n’enlève rien au fait qu’à un certain moment il devient évident qu’un changement qualitatif s’est produit. Tout comme on peut dire qu’un tigre et un lion sont deux espèces différentes, nous pouvons dire qu’un homme et une femme appartiennent à deux sexes différents. Cela ne signifie pas que les ligres ou les personnes intersexes n’existent pas. Mais ce sont deux variations extrêmes dans le cadre d’une dichotomie.
La variation et l’opposition coexistent en toute chose. Nier la première, c’est donner une vision rigide de la réalité, aveugle au changement et aux contradictions. Nier la seconde, c’est donner une vision amorphe de la réalité, où tout est relatif et subjectif.
Pour en revenir à la question trans, on a d’un côté les idéologues anti-trans qui ne voient le monde qu’à travers des catégories biologiques rigides. Cela les conduit à rejeter ou à dénoncer certaines situations contradictoires, notamment celles où un être humain agit consciemment pour modifier des éléments de son existence physique et chimique afin de se rapprocher des caractéristiques biologiques d’un sexe différent. D’un autre côté, de nombreux militants et militantes trans nient toute différence qualitative entre les sexes, ce qui les empêche d’aborder intelligemment les réalités du monde physique et social.
Le mouvement trans n’a pas besoin de rejeter la binarité des sexes pour faire avancer sa cause. Bien au contraire, une meilleure compréhension scientifique des différences biologiques entre hommes et femmes pourrait permettre un jour de transcender les différences biologiques entre les sexes. L’obstacle à cela et plus généralement à la libération trans ne réside cependant pas dans les limites actuelles de la science, mais dans les rapports sociaux capitalistes.
Capitalisme et genre
L’argument le plus courant des anti-trans est qu’« un homme est un homme » et « une femme est une femme », que tout le monde sait que c’est vrai et qu’on ne peut pas passer de l’un à l’autre. Pour eux, quiconque conteste ces « faits » évidents nage en plein délire. En un sens, l’argument le plus fondamental contre ce raisonnement, c’est qu’il y a un tas de personnes transgenres qui vivent leur vie de tous les jours sans que personne ne s’en offusque ni même remarque qu’elles sont transgenres. En réalité, il est clairement possible de faire une transition sociale d’un genre à un autre. Bien sûr, cela ne clôt pas le débat. Au fond, le mouvement anti-trans pense que de telles transitions sont socialement nuisibles et qu’elles doivent être complètement stoppées ou sévèrement limitées.
Cela soulève deux questions : « Pourquoi y a-t-il tant d’opposition à la transition de genre ? » et « Pourquoi l’argument selon lequel la transition est impossible a-t-il une telle prise ? » Pour y répondre, il faut comprendre que les idées concernant les rôles genrés, la sexualité et la transition de genre ne sortent pas simplement du cerveau des individus mais qu’ils reflètent la société telle qu’elle est actuellement organisée.
Dans son brillant ouvrage L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), Friedrich Engels explique comment l’oppression des femmes, c’est-à-dire l’inégalité des rapports entre les genres, trouve son origine dans l’avènement de la société de classes et dans le développement de la famille patriarcale. Depuis l’époque de l’esclavage jusqu’aux sociétés capitalistes modernes, cette forme de famille a été l’unité de base de l’organisation sociale.
Toutes les sociétés capitalistes modernes sont organisées selon une norme consistant en un couple hétérosexuel monogame qui élève des enfants à qui il léguera ses biens (s’il en a). C’est dans la sphère privée de la famille que des tâches essentielles telles que l’éducation des enfants, l’instruction, les soins et les tâches domestiques sont assurées, principalement par les femmes. Cette structure familiale est une institution essentielle du capitalisme. En même temps, le capitalisme moderne sape les fondements de cette institution en offrant aux femmes un certain degré d’indépendance financière, en érodant le rôle de l’Église et en développant l’individualité. Mais si la norme peut être ébranlée, parfois de manière significative, cela ne peut pas créer les conditions sociales nécessaires pour remplacer complètement le rôle social que joue la famille.
Pour le dire plus simplement, la famille ne peut être remplacée que dans la mesure où ses tâches sont prises en charge par la société. Plus la santé et l’éducation sont socialisées, moins elles reposent sur la famille. Plus les individus seront libérés de la concurrence économique et du besoin, plus ils seront libres de s’associer et de vivre comme bon leur semble avec qui ils veulent. Le problème, bien sûr, c’est que le capitalisme ne peut, au mieux, que commencer à créer de telles conditions. Dans la période actuelle de déclin capitaliste, où les forces productives se contractent, nous ne verrons que des reculs par rapport à ce qui avait été gagné, et une dépendance toujours plus grande à l’égard de la structure familiale de base. C’est cette réalité qui est derrière la crise mondiale de la santé, de l’éducation et des soins aux personnes âgées.
De plus, les capitalistes ont un intérêt direct à maintenir la famille hétérosexuelle traditionnelle, tant pour des raisons politiques (renforcer la conformité sociale) qu’économiques (reproduire et maintenir une main-d’œuvre abondante). Tout cela montre que l’hystérie croissante contre les personnes transgenres n’est que le début d’une vague de réaction qui vise au fond les femmes et tous ceux qui ne se conforment pas strictement aux normes rigides de la famille monogame.
Dans les sociétés occidentales, le christianisme est en première ligne de la campagne anti-trans. À travers ses codes moraux fixes dictés par Dieu lui-même, la religion offre une doctrine qui consacre la propriété privée, impose la subordination éternelle des femmes aux hommes et, naturellement, l’imperméabilité du genre de chacun. La religion en tant qu’institution est toujours la voix la plus cohérente pour défendre la famille patriarcale, et elle est un pilier des normes et des valeurs sociales conservatrices.
Mais tout comme le capitalisme érode les piliers de la famille hétérosexuelle, il sape l’emprise de la religion. Dans la plupart des sociétés occidentales, les réalités de la vie moderne ont conduit à ce qu’une majorité de la population n’adhère pas à une interprétation stricte des textes religieux. Même parmi les personnes religieuses, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des gays et des lesbiennes et, jusqu’à récemment, les droits trans sont de plus en plus acceptés.
À eux seuls, les arguments religieux ne sont pas les plus efficaces pour attiser la réaction anti-trans. C’est au nom de la « défense des femmes » que la pensée conservatrice traditionnelle a pu se lier aux discours idéologiques plus modernes. Ironiquement, sur la question trans, le féminisme a servi d’auxiliaire aux valeurs patriarcales qu’il est censé remettre en question.
Pourquoi les TERF existent ?
En Grande-Bretagne, considérée par beaucoup comme l’épicentre de la réaction anti-trans, on trouve souvent d’un côté les militants pro-trans et de l’autre des femmes féministes qui se considèrent parfois comme progressistes, voire de gauche, et qu’on appelle les TERF. Au fond, l’argument féministe contre l’extension des droits trans c’est que cela se fait au détriment des droits chèrement acquis des femmes. Il y a des versions très rétrogrades de cet argument qui accusent les femmes transgenres d’être des pervers sexuels qui veulent « s’approprier » la féminité. Cependant, les versions les plus efficaces – et les plus dangereuses – de ces arguments sont avancées par des femmes aux allures progressistes, comme Kathleen Stock, une universitaire affable qui est elle-même lesbienne.
Contre des gens comme Stock, les huer et les accuser de préjugés anti-trans ne marche pas. Pour répondre aux arguments féministes contre les droits trans, il faut au contraire comprendre ce qu’il y a derrière ce conflit. Qu’est-ce qui a poussé des femmes comme Stock ou J. K. Rowling à entrer dans le débat sur la question trans, et surtout, pourquoi leurs interventions ont-elles trouvé un terreau aussi fertile ? La réponse est simple : elles s’appuient sur l’oppression des femmes. Elles utilisent le fait que les femmes sont victimes de violences, souffrent d’une plus grande précarité économique et sont en proie à toutes sortes de préjugés, pour présenter les femmes trans comme des concurrentes aux droits des femmes.
Dans sa brochure « Beyond Binaries » (juillet 2024), le Socialist Workers Party (de Grande-Bretagne) balaie d’un revers de main l’argument avancé par les TERF en expliquant que « la droite – et certains socialistes et féministes qui leur ont donné une couverture de gauche – ont fondé leur opposition à la réforme de la GRA [loi reconnaissant le genre] sur le mensonge que les femmes transgenres représenteraient une menace pour les droits des femmes » (souligné par nous). Soyons clairs : il est faux d’opposer la cause des femmes à celle des personnes trans. Cela dit, rejeter simplement la question comme un mensonge n’est pas un argument sérieux ni efficace. La vérité, c’est que si l’on considère la société uniquement telle qu’elle est actuellement organisée, où tout le monde est en concurrence pour une quantité limitée et décroissante de ressources, il y a effectivement une tension entre améliorer la condition des personnes trans et améliorer celle des femmes.
Nous aborderons plus loin dans cet article la question de savoir comment surmonter ces tensions. Mais il faut d’abord insister sur l’importance de reconnaître la réalité de ce conflit d’intérêts. Qu’il s’agisse de sport, de compétitions, de foyers d’hébergement, de prisons, de toilettes ou de programmes de discrimination positive, le manque de ressources se pose partout. Souvent, les questions les plus controversées, comme celle des femmes transgenres dans le sport professionnel, ne sont pas celles qui touchent la plupart des gens dans leur vie quotidienne. Cela dit, ce sont des questions qui ont un poids symbolique important et qui sont l’expression concentrée de tensions sous-jacentes réelles.
Au fond, le problème c’est que non seulement l’inclusion des personnes trans augmente la pression sur les ressources déjà limitées consacrées aux femmes cisgenres (non trans), mais elle remet aussi en question la ségrégation genrée qui régit la société. Bien que les divisions genrées soient en dernière analyse responsables de l’oppression des femmes, la plupart d’entre elles considèrent les espaces et les programmes sociaux réservés aux femmes comme des droits importants offrant une certaine protection dans une société patriarcale souvent violente. Pour faire avancer l’intégration et l’inclusion des personnes trans, il faut répondre aux divers conflits et tensions en offrant des solutions qui font avancer à la fois la cause trans et celle des femmes cis. On ne trouvera jamais ces solutions en niant ou en minimisant les conflits d’intérêts, ou en soutenant que les préjugés sont le seul facteur qui pousse des femmes progressistes dans une direction anti-trans.
Une partie du problème tient au fait que les TERF aussi bien que les activistes LGBTI+ voient le monde à travers une perspective féministe. Bien sûr, il existe une différence claire entre le rôle réactionnaire joué par les TERF, qui travaillent activement à restreindre les droits des personnes trans, et les militants et militantes LGBTI+ qui veulent améliorer les conditions de l’un des groupes les plus opprimés de la société. Après tout, ce n’est pas un hasard que les TERF et les courants politiques d’extrême droite se rejoignent de plus en plus. Cela dit, dans leur vision féministe du monde, les TERF tout comme la plus grande partie du mouvement LGBTI+ abordent l’oppression des femmes et l’oppression sexuelle en insistant sur l’identité et sur ce qui est possible selon les normes sociales et économiques actuelles.
Par exemple, les TERF accordent une énorme importance à déterminer qui appartient ou non à la catégorie des « femmes ». En effet, la « féminité » est le prisme déterminant à travers lequel elles voient toutes les relations sociales. Être une femme ou non détermine si l’on est un oppresseur ou non, si l’on est autorisé à assister à des réunions non mixtes et si l’on a bénéficié ou non du « privilège masculin ». Non seulement une telle conception du monde ne contribue guère à faire avancer la condition des femmes, sa logique de division conduit à une fragmentation et à des conflits sans cesse croissants entre les différents groupes opprimés, à commencer par les féministes elles-mêmes.
Quant aux courants dominants du mouvement LGBTI+, ils se sont concentrés sur le lobbying auprès des grandes entreprises et des institutions pour qu’elles changent le langage qu’elles utilisent afin d’inclure un éventail toujours plus large d’identités. Cette insistance découle de l’idée féministe selon laquelle ce sont le langage et les idées, et non les institutions sociales ancrées dans la réalité matérielle, qui sont la source de l’oppression. Ce type de militantisme n’entraîne que peu ou pas de changements positifs dans la vie des personnes trans, mais il provoque un maximum de réactions sociales négatives. L’exemple classique est J.K. Rowling qui se moque de l’utilisation de l’expression « personnes qui ont leurs règles ».
Lorsqu’il s’agit de décisions politiques concrètes, des deux côtés du débat on ne considère généralement la question que sous l’angle de ce qui est possible selon la pensée politique dominante. Sans comprendre que le capitalisme lui-même prive tous les groupes opprimés de ressources, les féministes, qu’elles soient trans-inclusives ou non, proposent en règle générale des politiques qui se feraient au détriment des intérêts matériels ou des sensibilités d’un autre groupe opprimé. Par exemple, inclure les femmes trans dans le système carcéral féminin sans rien changer d’autre à la manière barbare dont les gens sont emprisonnés ne peut que créer des tensions et des incidents socialement explosifs. Encore une fois, si l’on ne comprend pas que la tension est provoquée par la limitation des ressources et par les rapports sociaux existants, on ne peut pas proposer de solution permettant de surmonter ou du moins minimiser les conflits entre groupes opprimés.
Le problème de l’idéalisme libéral
Nous avons déjà abordé certains des problèmes de l’idéologie pro-trans dominante en ce qui concerne la biologie et le féminisme. Dans les deux cas l’on en vient à une question plus large : le mouvement a un fondement idéologique idéaliste. Par « idéaliste », nous entendons une vision philosophique du monde qui ne considère pas l’oppression comme découlant fondamentalement des rapports économiques, mais de conceptions erronées qui flotteraient dans la tête des gens.
Judith Butler, universitaire reconnue dans le domaine des études de genre, a exercé une influence considérable dans l’élaboration des bases idéologiques du mouvement LGBTI+ moderne. Selon elle :
« Le postulat politique selon lequel il faut au féminisme une base universelle à trouver dans une identité présumée transculturelle va souvent de pair avec l’idée que l’oppression des femmes aurait une forme spécifique, identifiable au niveau de la structure universelle ou hégémonique du patriarcat, ou encore de la domination masculine […]. L’empressement du féminisme à décréter l’universalité du patriarcat pour pouvoir sauver l’apparence de sa revendication de représentativité a, de temps à autre, incité les féministes à prendre un raccourci, celui qui va tout droit à une universalité catégorielle ou fictive de la structure de domination, censée produire pour les femmes une expérience collective de l’oppression. »
– Trouble dans le genre,
Éditions La Découverte, 2005
Derrière ce jargon, Butler rejette l’idée que le « patriarcat », c’est-à-dire l’oppression des femmes, est enraciné dans une institution sociale définie. En d’autres termes, Butler nie que la famille patriarcale soit l’institution qui consacre et reproduit la division genrée de la société. Par conséquent, elle ne cherche pas à lutter contre l’oppression de genre en créant des conditions sociales susceptibles de remplacer la famille en tant qu’institution, mais en remettant en question et en subvertissant les normes sociales existantes :
« En guise de stratégie pour dénaturaliser et resignifier les catégories relatives au corps, je décrirai et proposerai un ensemble de pratiques parodiques fondées sur une théorie performative des actes de genre, des pratiques qui sèment le trouble dans les catégories de corps, de sexe, de genre et de sexualité, et qui amorcent un processus subversif de resignification et de prolifération du sens débordant du cadre strictement binaire. »
Si la transgression des normes de genre peut être un acte émancipateur pour ceux qui rejettent leur genre et / ou les attentes sociales qui en découlent, ce type d’action ne remet absolument pas en question l’organisation de la société dans son ensemble.
La division de la société en deux genres est un fait social tout aussi réel que la division biologique entre les sexes. Elle n’est pas le produit d’idées, mais d’une institution qui a évolué historiquement et qui est perpétuée par des contraintes matérielles et par les intérêts de classe de la bourgeoisie. Cela ne veut pas dire que les relations patriarcales doivent être permanentes. Mais pour briser les normes de genre, il faut en fin de compte transformer la société dans son ensemble et non pas sa propre identité.
On peut haïr le capitalisme et aller vivre en communauté dans une forêt, mais cela ne change rien au fait que le capitalisme continuera d’exister. De la même manière, on peut s’identifier comme non binaire, non conforme au genre ou autre, mais cela ne changera rien au fait que la société (en dehors de cercles petits-bourgeois très isolés) continuera à placer les individus dans une binarité genrée. Les individus qui rejettent personnellement ces normes se marginalisent de la société ; ils ne la changent pas.
Les « marxistes » pro-trans
Le marxisme, en tant que doctrine révolutionnaire, a été développé au XIXe siècle en opposition directe à ce qu’on appelait alors le « socialisme utopique ». Les socialistes utopiques avaient imaginé différents projets pour transcender le capitalisme en changeant la conscience collective ou en concevant des micro-sociétés idéales. Mais la doctrine du socialisme scientifique élaborée par Marx et Engels a au contraire identifié les forces et les dynamiques au sein du capitalisme qui ont le potentiel de renverser la structure de classe existante et de jeter les bases d’une évolution vers une société égalitaire. Le moteur de cette révolution n’était pas un ensemble d’idéaux, mais les intérêts d’une classe, le prolétariat.
Pour tout marxiste, c’est l’ABC. De nombreux marxistes critiquent par conséquent la théorie postmoderne du genre pour son idéalisme. Cependant, ceux qui sont pro-trans le font sans conviction, tout en colportant les illusions mêmes qu’ils prétendent combattre. En essayant de ne pas « se couper du mouvement », ils liquident le programme marxiste en faveur d’un idéalisme libéral très ordinaire. Non seulement cela désoriente les militants radicaux pour les droits transgenres, cela permet également aux réactionnaires d’attaquer facilement le mouvement en le qualifiant de pur produit de l’idéalisme.
Voici un exemple flagrant de cette conciliation, dans la brochure du SWP déjà mentionnée :
« On peut considérer que le genre comporte deux grands éléments. Premièrement, le genre est extérieur à la personne. Il est basé sur les rôles genrés perçus qui nous sont attribués par la société à partir de la façon dont nous agissons, nous habillons, nous comportons et parlons. Deuxièmement, c’est aussi un sentiment intérieur de notre moi, ou de notre identité de genre. Il est profondément ressenti par les individus, et les gens devraient pouvoir l’exprimer comme ils le souhaitent. »
Ici le SWP confond tout. D’une part, il présente le genre comme ayant un caractère social, bien que défini de manière vague. En même temps, il présente le genre comme un « sentiment de soi » personnel pouvant être interprété de façon totalement idéaliste et même religieuse. Et enfin, il exprime le souhait que les gens puissent exprimer leurs désirs comme bon leur semble.
Au fond, la définition du SWP embrouille le fait que le genre est le produit des rapports sociaux et non du cerveau des individus. Ce n’est que lorsque le désir intérieur de changer de genre interagit avec d’autres êtres humains qu’il peut se réaliser dans les faits. De plus, la volonté d’une personne de s’identifier d’une certaine manière ne signifie aucunement qu’elle sera socialement acceptée comme telle. C’est cela la base de l’oppression trans. À première vue, cela semble évident et les personnes trans le savent mieux que quiconque. Il y a une énorme différence entre, d’un côté, une personne trans « qui passe », et de l’autre une personne trans « qui ne passe pas » ou une personne non binaire.
Pour le SWP et les libéraux pro-LGBTI+, définir le genre uniquement comme un produit des rapports sociaux serait probablement considéré comme offensant et comme une capitulation face au discours anti-trans. Mais il est indéniable que le capitalisme ne permettra pas à la plupart des personnes trans de s’intégrer socialement dans le genre de leur choix. Et il ne rendra jamais socialement acceptable la non-conformité à la binarité des genres. Reconnaître cela, ce n’est pas une capitulation devant les réactionnaires. C’est reconnaître ce à quoi nous sommes confrontés. Affirmer que le « sentiment intérieur de soi » conduit automatiquement à une réalité sociale différente, ce n’est pas être un bon allié, c’est mener en bateau les personnes transgenres, exactement ce que font les libéraux depuis des décennies.
La réponse du mouvement LGBTI+ à l’oppression transgenre est d’insister sur le fait que les individus doivent « affirmer » le genre des personnes trans et non binaires. Bien que ce soit certainement la chose à faire quand on a une conscience sociale, et cela va de soi pour les communistes, il est totalement illusoire de penser que l’« affirmation sociale » par elle-même pourrait briser les normes de genre rigides de la société. En fait, l’affirmation du genre n’a jamais quitté les limites étroites de l’intelligentsia libérale et de la sous-culture LGBTI+ ; c’est un fait qui est aujourd’hui une évidence.
Cependant, les marxistes qui écrivent sur la question trans ne le reconnaissent absolument pas. C’est évident dans les « Dix thèses sur la question du genre – Révisées », où la camarade Roxy Hall écrit ceci :
« Bien que l’identité trans ne soit pas en soi révolutionnaire – l’arme de la critique ne remplacera jamais la critique des armes –, nous devons encourager chacun à se rebeller à sa manière contre les hiérarchies de genre qui nous sont imposées. Ne serait-il pas bénéfique que toutes sortes de personnes résistent aux normes de genre, brisent le lien symbolique entre les caractéristiques sexuelles et les rôles genrés, vivent de manière audacieuse et non conventionnelle ? Le processus d’abolition du genre se présentera certainement dans un premier temps comme une explosion de modes de vie différents. »
– thepartyist.com, 2 juin 2024
Non, « vivre de manière audacieuse et non conventionnelle » n’aidera en aucun cas à abolir le genre. En fait c’est tout le contraire. En changeant de « mode de vie », on confronte les idées conservatrices de la société sans rien faire pour en changer la structure. Dans un contexte où les conditions de vie de la classe ouvrière sont constamment attaquées et où elle se retrouve de plus en plus dépendante de la structure familiale, le fait de s’opposer aux normes sociales en tant que stratégie politique ne fera que provoquer un retour de bâton conservateur. Au lieu de « vivre de manière audacieuse et non conventionnelle », il faut montrer concrètement comment les intérêts matériels de la classe ouvrière sont servis par la défense des droits sociaux et politiques des personnes transgenres.
Une autre expression des concessions idéalistes faites par les marxistes qui écrivent sur la question trans est l’acceptation quasi unanime de l’idée selon laquelle les genres seraient « assignés à la naissance ». Le SWP et Roxy Hall répètent tous deux ce mythe idéaliste. Ce concept minimise une fois de plus le fait que les relations de genre sont un fait social objectif, pas une idée erronée ou une étiquette arbitraire attribuée aux bébés. Le genre que l’on a à la naissance n’est pas moins arbitraire que la race, la nationalité ou la classe sociale. Bien que chacun de ces exemples soit très différent, ils sont tous le produit des rapports sociaux objectifs dans lesquels on naît. Cela ne signifie pas que ces catégories soient immuables. Mais cela veut dire que les changer est un processus social, qui est généralement très difficile.
La plupart des marxistes et des défenseurs des personnes LGBTI+ sautent au plafond lorsque les réactionnaires comparent le changement de genre au changement de race. L’exemple classique est celui de Rachel Doležal, une femme née blanche qui s’est identifiée comme noire et qui a occupé un poste dirigeant au sein de la NAACP (organisation américaine de défense des droits civiques). Les libéraux sont horrifiés à l’idée que l’on puisse choisir de devenir noir et réussir à le faire en Amérique, et ils avancent toutes sortes de raisons alambiquées pour expliquer pourquoi changer de race, contrairement à la transition de genre, est moralement répréhensible. Cette réaction révèle une approche moraliste de l’oppression raciale : tout comme le changement de genre, il n’y a rien de mal en soi à changer de race. Mais cette réaction reflète également une vision idéaliste du genre qui, contrairement à toute autre division sociale, dépendrait uniquement de la volonté des individus.
On retrouve toujours la même dynamique. Le mouvement trans est attaqué par la droite, les réactionnaires et certaines féministes. Ces attaques réaffirment les lois sociales rigides et imperméables qui régissent les rapports entre les genres. Le mouvement pro-trans réagit à ces attaques en cherchant à défendre le droit et la possibilité pour les individus de changer de genre. Mais en menant ce juste combat, il s’appuie sur des théories idéalistes du genre qui ne font qu’alimenter la réaction et renforcer l’isolement des personnes trans.
À cela s’ajoute une forte dose de moralisme libéral : il faut être bienveillant, tolérant, éclairé, conscient de ses privilèges, etc., etc. Cette stratégie a connu un certain succès tant qu’elle était reprise par la bourgeoisie la plus puissante du monde. Mais maintenant que les États-Unis se sont brusquement retournés contre le libéralisme, avec Amazon, Facebook et J.P. Morgan qui abandonnent leurs programmes de diversité, d’équité et d’inclusion et leur capitalisme « woke », le mouvement trans se retrouve seul face à l’hostilité de tous ceux qui en ont assez de devoir subir des sermons creux alors que leurs conditions de vie se détériorent.
La raison pour laquelle les marxistes doivent expliquer la fausseté des conceptions idéalistes du mouvement LGBTI+, c’est qu’elles rendent absolument impossible l’organisation d’une véritable riposte pour défendre les personnes trans et toutes les autres catégories d’individus qui ne se conforment pas aux normes sexuelles. Le mouvement trans ne peut pas se permettre de s’accrocher aux mythes et aux illusions qui l’ont conduit à la situation exposée et vulnérable où il se trouve. Plus que jamais, il est crucial qu’il adopte un programme révolutionnaire et matérialiste pour la libération trans.
Troisième partie :
Un programme marxiste contre la réaction
Dans son article de 1909 « De l’attitude du parti ouvrier à l’égard de la religion », Lénine avance l’argument suivant :
« Aucun livre de vulgarisation n’expurgera la religion des masses abruties par le bagne capitaliste, assujetties aux forces destructrices aveugles du capitalisme, aussi longtemps que ces masses n’auront pas appris à lutter de façon cohérente, organisée, systématique et consciente contre ces racines de la religion, contre le règne du capital sous toutes ses formes.
« Est-ce à dire que le livre de vulgarisation contre la religion soit nuisible ou inutile ? Non. La conclusion qui s’impose est tout autre. C’est que la propagande athée de la social-démocratie doit être subordonnée à sa tâche fondamentale, à savoir : au développement de la lutte de classe des masses exploitées contre les exploiteurs. »
Cette approche s’applique pleinement aux questions relatives à l’oppression trans. Les marxistes doivent s’opposer aux conceptions arriérées dans la classe ouvrière dans le domaine des relations de genre, et notamment de l’oppression des femmes. Mais ce travail doit être inspiré et guidé par la lutte des classes.
Autrement dit, en tant que marxistes, nous voulons que la ligne de démarcation dans la société passe entre travailleurs et capitalistes et non entre positions pro et anti-trans, entre libéraux « woke » et conservateurs arriérés. Cela ne signifie pas qu’il faudrait mettre la question de côté et s’adapter aux préjugés rétrogrades, mais qu’il faut mettre la question transgenre au premier plan comme une nécessité de la lutte pour l’émancipation des travailleurs. Appliquer cette méthode et élaborer un programme pour la libération trans n’est pas une tâche facile, surtout à une époque où la question trans est devenue un tel sujet de discorde. Il faut le faire concrètement pour chaque pays et chaque lieu de travail, mais nous proposons les points clés suivants comme éléments constitutifs généraux d’un tel programme :
1) Libérons-nous des libéraux
Nous devons tirer les leçons de la trajectoire désastreuse qui a conduit les personnes trans à la position où elles se trouvent aujourd’hui. La leçon la plus claire et la plus évidente, c’est que les libéraux ne sont absolument pas fiables comme alliés ; on ne peut en aucun cas compter sur eux. Parti démocrate, Parti travailliste britannique, partis verts, Die Linke : ils ont tous montré que lorsque la pression monte, ils abandonnent les opprimés à leur sort. Il est suicidaire de penser qu’on peut pousser les libéraux à devenir de véritables défenseurs des droits LGBTI+. Leur carrière parmi les élites et leurs appétits capitalistes passent toujours avant leurs soi-disant valeurs.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faille jamais former de bloc défensif d’aucune sorte ni entreprendre des actions communes avec les libéraux. En période d’offensive de la réaction et d’attaques contre les droits démocratiques, de telles alliances peuvent très bien être nécessaires. Mais elles doivent être conclues en sachant que les libéraux sont lâches et traîtres. En fin de compte, le but d’une telle alliance doit être de convaincre les militants de base d’abandonner le libéralisme en démontrant le bien-fondé de la stratégie marxiste. Et non de liquider le programme marxiste pour amadouer les libéraux, comme le font sans cesse les marxistes pro-trans.
2) Abandonnons le symbolisme creux
La libération trans est un acte matériel. Ses progrès se mesurent par la possibilité plus ou moins grande qu’ont les individus de pouvoir changer de genre et le degré d’antagonisme genré dans la société. Les idées et la conscience changeront en proportion directe des changements dans les rapports sociaux et dans les institutions. Elles ne changeront pas grâce à une campagne idéologique « woke » sermonnant les gens sur ce qu’ils pensent ou sur la façon dont ils parlent. Il faut bien sûr éduquer les gens et s’opposer fermement aux préjugés, y compris le mégenrage délibéré. Mais cela ne peut pas être le seul ou le principal objectif de la lutte. Au lieu de cibler le langage et les symboles, elle doit se concentrer sur la défense des conditions matérielles et des droits des personnes transgenres, contre l’offensive réactionnaire actuelle.
3) Aucune concession à la morale bourgeoise
Ce n’est pas un hasard si la réaction contre les personnes trans se concentre si fortement sur la question des enfants trans. Selon la morale traditionnelle, les enfants sont des êtres asexués qui n’ont pas la capacité de faire des choix concernant leur propre vie et leur propre corps. D’où une campagne hystérique contre les bloqueurs de puberté et contre toute forme de soins d’affirmation de genre pour les personnes légalement déclarées mineures. À travers cette campagne, les personnes trans ont été dénoncées comme des dégénérés et des prédateurs sexuels, tandis que ceux qui les soutiennent dans le corps médical ont été accusés de maltraitance d’enfants, de faute professionnelle et même de « mutilation ».
En réponse à ces attaques véhémentes et dégoûtantes, il y a une forte pression pour se conformer autant que possible aux normes et aux valeurs sexuelles traditionnelles. Par exemple, de nombreuses personnes se disant pro-trans concèdent que les enfants ne devraient pas pouvoir faire leur transition avant d’avoir atteint l’âge légal de la majorité. C’est une grave erreur. Non seulement de telles concessions ne feront rien pour atténuer les réactions négatives, elles ouvrent également la porte à de nouvelles régressions des droits trans.
Les concessions à la morale bourgeoise mettent le mouvement LGBTI+ sur une pente savonneuse. Concéder de quelque manière que ce soit que les individus ne devraient pas avoir le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps et leur propre sexualité revient à couper l’herbe sous le pied du mouvement. Cela revient à céder le pouvoir de décision à la famille, à l’État et à la religion, les institutions mêmes qui sont responsables de l’oppression des enfants, des femmes et des personnes trans.
4) Tournons-nous vers les minorités religieuses opprimées
Les minorités opprimées, en particulier les musulmans en Occident, ne sont pas le premier endroit où la plupart des activistes trans chercheraient des alliés. Si les musulmans pratiquants peuvent souvent être très conservateurs sur les questions de sexualité, ils constituent également dans de nombreux pays l’un des groupes les plus opprimés et les plus persécutés. Tout comme les personnes trans, ils se retrouvent de plus en plus isolés et dans le collimateur de l’État. Contrairement aux libéraux qui s’efforcent de s’intégrer dans le nouveau statu quo social conservateur, les musulmans se voient dans une grande mesure refuser cette possibilité.
Il y a une base objective pour une alliance fondée sur la défense des droits démocratiques fondamentaux. Cependant, de telles alliances ne sont possibles que si on fait passer les intérêts communs aux deux groupes avant ce qu’il y a dans la tête des gens. De plus, s’engager dans une lutte commune contribuerait grandement à changer les mentalités des deux côtés.
5) Forgeons l’unité entre la libération trans et celle des femmes
Aucun conflit n’est plus préjudiciable à la lutte trans que celui avec les féministes. C’est dû en partie aux opinions conservatrices et sectorielles de nombreuses femmes. Mais cela tient également à la manière dont la question trans est mise en avant par le mouvement LGBTI+ traditionnel. En voulant briser la barrière rigide entre les genres, le mouvement heurte souvent la sensibilité des femmes. Par exemple, il est stupide de prétendre qu’associer aux femmes l’anatomie féminine et la menstruation exclut en soi les hommes trans. Après des millénaires où l’oppression des femmes a été liée à leur corps, il est compréhensible que nombre d’entre elles réagissent négativement lorsqu’on leur dit qu’on ne peut plus faire ce lien.
De plus, penser que les personnes trans peuvent être intégrées dans des espaces réservés aux femmes sans que cela ne provoque de graves tensions sociales, c’est ignorer à quel point la ségrégation et l’oppression fondées sur le genre sont profondément ancrées dans la société. Il ne peut pas y avoir de solution parfaite à ce problème sous le capitalisme. Une stricte ségrégation des genres basée sur le sexe biologique n’est pas du tout la solution. Elle est non seulement totalement irréaliste mais aussi dangereuse et oppressante pour les personnes trans. Les personnes trans doivent pouvoir avoir accès aux installations de leur choix. Mais il faudrait également prendre des dispositions pour tenir compte des opinions conservatrices et minimiser les conflits de valeurs.
La solution consiste généralement à augmenter les ressources de manière à ce que tant les personnes trans que les femmes en général en bénéficient. Une solution évidente au conflit concernant l’accès des femmes trans aux hébergements d’urgences pour femmes est d’en construire davantage, de permettre aux femmes trans d’y accéder et d’offrir également la possibilité d’une ségrégation biologique stricte aux femmes qui le souhaiteraient.
Si, pour l’instant, la défense de la féminité est le principal argument utilisé contre les personnes trans, le retour de bâton réactionnaire actuel est également dirigé contre les femmes. La condition des femmes, celle des personnes LGBTI+ et celle des travailleurs sont en fin de compte indissociables les unes des autres. Tous ont intérêt à s’unir dans une lutte défensive commune et, plus largement, à lutter pour la libération des femmes, des personnes trans et de la classe ouvrière.
6) La classe ouvrière est la force décisive
La classe ouvrière est la seule classe capable de défendre de manière décisive les droits trans. Non qu’elle serait la couche la plus libérale de la société – elle ne l’est pas –, mais parce qu’elle a un intérêt de classe direct à renverser le capitalisme et à instaurer une société sans classes qui n’aura pas besoin d’oppression de genre.
Une alliance entre personnes trans et le prolétariat ne signifie pas qu’elles doivent abandonner la lutte contre leur propre oppression. L’oppression des personnes trans, tout comme l’oppression des gays et lesbiennes, des femmes et des minorités raciales, divise et affaiblit la classe ouvrière. Ce n’est qu’en luttant pour la libération de tous les groupes opprimés de la société qu’on peut forger l’unité. Il ne s’agit pas de se tenir la main autour d’un feu de camp libéral. Le ciment qui pourra unir ces luttes, c’est la lutte des classes.
Ce n’est pas un processus automatique ; les différentes causes doivent être fusionnées consciemment. Mais la lutte des classes, par ses propres lois et sa propre dynamique, offre le terrain où ce processus peut avoir lieu. Lutter en commun pour un intérêt commun, c’est la condition préalable pour surmonter l’arriération sociale. Pour que de telles luttes aient lieu, il ne faut pas poser de condition préalable. Par exemple, il serait tout à fait réactionnaire de s’abstenir de soutenir une grève parce que les travailleurs expriment des opinions arriérées sur la question trans. Il faut au contraire montrer, tout au long du conflit, que les droits trans sont liés à ceux des travailleurs. Cela contribuera à faire changer les opinions arriérées.
Il faut garder à l’esprit que le mouvement trans n’est pas un mouvement unifié. Si toutes les personnes trans sont opprimées, elles ne partagent pas toutes un intérêt commun. Pour cette raison, il est essentiel que les militants et militantes trans placent toujours les intérêts de la classe ouvrière au-dessus de tout le reste. Par exemple, ils ne doivent pas considérer les politiques de diversité et d’égalité des entreprises comme un moyen de défendre leurs droits.
Le mouvement trans doit autant que possible chercher à combiner sa propre lutte avec celle de la classe ouvrière. Un moyen évident d’y parvenir est la lutte pour les soins de santé, une question brûlante dans le monde entier. La crise de la santé va de pair avec les attaques contre les soins d’affirmation de genre et contre les droits reproductifs. Il va sans dire que la lutte pour améliorer le système de santé profitera aux personnes trans. Mais faire des soins pour les personnes trans une question centrale de la lutte pour la santé peut également galvaniser la cause en ralliant des milliers de personnes trans et leurs familles au mouvement.
7) Laissons tomber le gradualisme
La réforme graduelle du capitalisme a toujours été une impasse pour les personnes trans et tous les autres groupes opprimés sexuellement. Quels que soient les progrès temporaires pour éroder les normes de genre, ils se heurtent inévitablement au socle de la domination capitaliste : la famille, l’État et la recherche du profit. La période de progrès relatif pour les personnes LGBTI+ dans le monde occidental est maintenant terminée, et la seule perspective dans un avenir prévisible est l’aggravation du conservatisme social. La réforme graduelle est une perspective sans issue. Seule la lutte révolutionnaire offre une voie pour lutter contre l’oppression croissante et avancer la libération complète.
8) Construisons un parti révolutionnaire international
La lutte pour la libération trans des dernières années a été principalement centrée sur l’Occident. Mais la libération trans et la lutte contre l’oppression de genre est une lutte internationale. Nulle part cette oppression n’est plus sévère que dans les pays opprimés par l’impérialisme. Et nulle part il n’y a un terreau révolutionnaire plus fertile que parmi les femmes ouvrières de ces pays.
Pour établir le lien entre le mouvement trans en Occident et la lutte internationale contre l’oppression impérialiste, il faut un parti révolutionnaire international. C’est le seul outil pour unifier la lutte contre les diverses formes d’oppression. Pour construire un tel parti, il faut tirer les leçons politiques des échecs passés, comprendre comment le libéralisme de ces dernières décennies a non seulement conduit le mouvement trans dans l’impasse, mais qu’il a aussi conduit la gauche révolutionnaire à être plus divisée et plus faible que jamais. Alors que le monde devient chaque jour plus réactionnaire, nous n’avons pas de temps à perdre dans des débats ésotériques et des chicaneries sectaires : en avant vers une IV e Internationale reforgée !
Il ne fait aucun doute que cet article ne fait qu’entamer le travail. Il y a bien plus à faire pour répondre en marxiste aux questions scientifiques, sociales et politiques auxquelles est confronté le mouvement transgenre. Cependant, nous espérons que notre contribution pourra susciter un débat et aider à la clarification politique au sein de la gauche radicale et du mouvement LGBTI+.