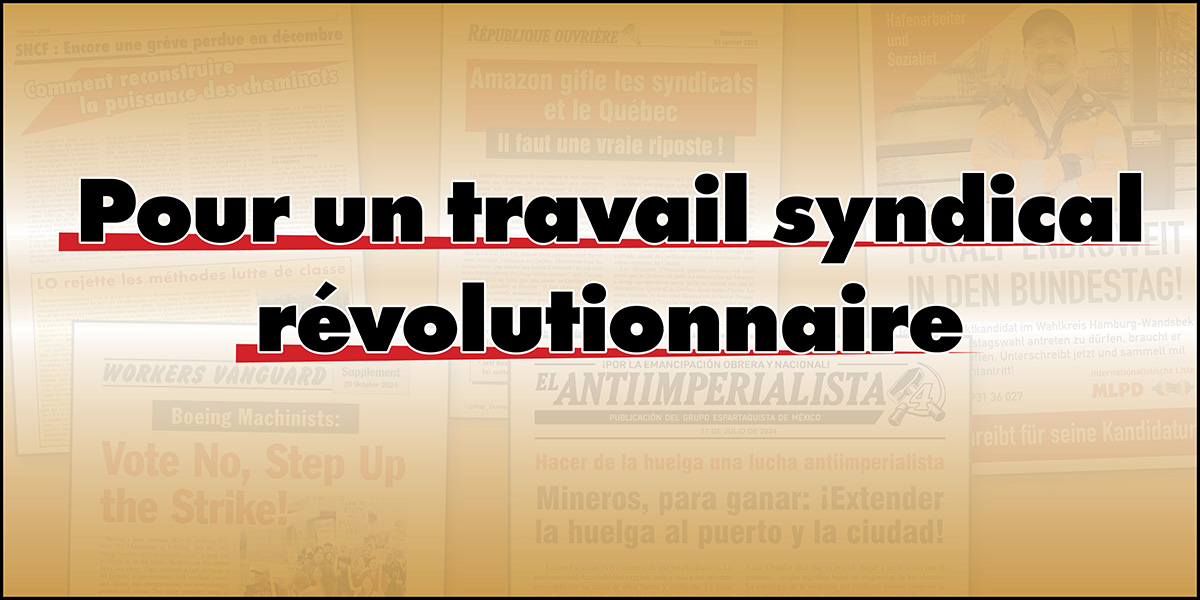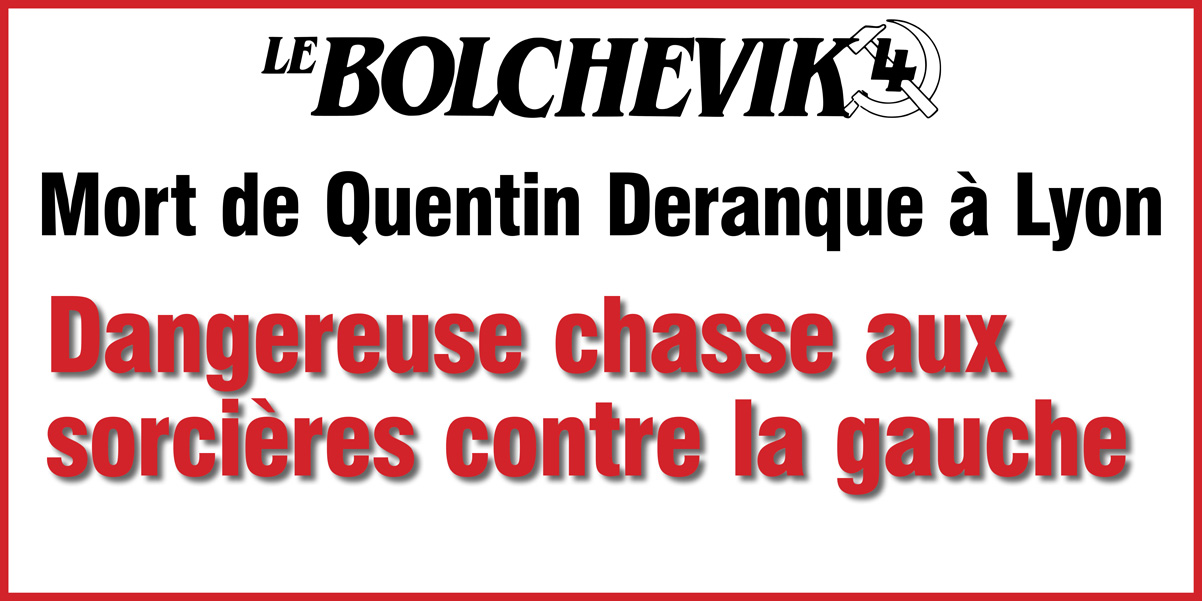https://iclfi.org/spartacist/fr/48/syndicats
L'article suivant a été présenté par la LCI pour la Rencontre des forces internationalistes à Paris de mai 2025.
Partout dans le monde les syndicats sont aujourd’hui l’ombre de ce qu’ils étaient. Partout ils sont dirigés par des traîtres qui enchaînent concessions et défaites. Pourtant, malgré le besoin criant de directions combatives pouvant véritablement défendre la classe ouvrière, l’influence des partis révolutionnaires sur la classe ouvrière est faible et / ou en retrait.
Cet échec ne s’explique pas par un simple manque d’effectifs mais par le refus ou l’incapacité de construire des oppositions conséquentes à la bureaucratie syndicale. Pourtant les Thèses sur la tactique du IIIe Congrès du Comintern déclaraient :
« L’Internationale Communiste a répudié les tendances sectaristes en prescrivant aux partis affiliés, si petits fussent-ils, de collaborer aux syndicats, de participer à vaincre leur bureaucratie réactionnaire de l’intérieur même des syndicats et de les transformer en organisations révolutionnaires des masses prolétariennes. » (souligné par nous)
Au fond si les organisations dites révolutionnaires ont failli c’est qu’elles poursuivent des stratégies erronées dans le travail en entreprise. La LCI n’a pas fait exception. Mais pour notre part nous avons ces dernières années tiré des leçons de nos échecs.
Les thèses suivantes se basent sur l’expérience de nos interventions dans les mouvements de grève qui ont récemment secoué plusieurs pays, notamment chez Boeing aux États-Unis. Mais tout aussi importante est notre expérience de conflits à plus petite échelle et de luttes quotidiennes dans un contexte international de réaction croissante.
Il faut une stratégie révolutionnaire
Le point de départ du travail révolutionnaire en entreprise est que la classe ouvrière a besoin d’un programme marxiste pour guider ses luttes. Qu’on soit dans une période réactionnaire, de grèves économiques ou de grandes luttes politiques, un programme révolutionnaire est essentiel. Pourtant la majorité des organisations marxistes rejettent explicitement la lutte pour une direction révolutionnaire des syndicats.
Quand on parle de guerre, tout le monde comprend qu’une armée doit être dirigée par un état-major cherchant à vaincre l’ennemi. Si le haut commandement cherche à tempérer le conflit au lieu de le gagner, non seulement il rendra la victoire difficile, voire impossible, mais il déploiera des tactiques maximisant les pertes et minimisant les gains.
Il en va de même dans la lutte de classe. Les directions ouvrières qui cherchent la coexistence avec le capitalisme seront conciliantes à toutes les étapes de la lutte. Elles maximisent les défaites et n’avancent en rien les intérêts stratégiques des travailleurs. De son côté une direction révolutionnaire, loin de sacrifier les gains immédiats, emploie des tactiques pouvant maximiser les victoires partielles tout en avançant les intérêts historiques de la classe ouvrière.
Le danger opportuniste
Le problème le plus commun dans le travail en entreprise est la conciliation de la bureaucratie syndicale. Dans sa forme la plus droitière cette politique prend la forme d’un soutien ouvert aux directions syndicales non révolutionnaires. Ce soutien est le plus souvent justifié par l’argument fallacieux qu’une direction « de gauche » encourage les travailleurs à lutter.
En tant que couche intermédiaire proche des capitalistes dans ses aspirations mais dépendant des travailleurs pour son influence, la bureaucratie syndicale ne joue pas un rôle indépendant dans la lutte de classe. Sa posture politique reflète les pressions venant de la bourgeoisie ou de sa base ouvrière. Mais fondamentalement la bureaucratie cherche à concilier le capitalisme. Si elle vire à gauche, ce n’est pas pour encourager la combativité des travailleurs, mais pour la maintenir autant que possible dans des canaux acceptables pour la bourgeoisie.
Cela ne signifie pas qu’il ne soit jamais principiel de former un front uni avec une aile de la bureaucratie syndicale. Mais un bloc temporaire doit se constituer sur la base d’une réelle ligne de classe (par exemple dans une grève ou contre l’unité nationale), et il ne doit jamais imputer un rôle progressiste à la bureaucratie. Le but d’un tel bloc n’est pas de cesser les hostilités mais de montrer en action la nécessité du programme révolutionnaire.
La critique de gauche
Dans bien des cas, la conciliation de la bureaucratie syndicale prend une forme indirecte. On fait une critique acerbe des directions ouvrières mais cette critique reste au niveau de la tactique et n’a pas pour objectif de remplacer ces traîtres par une direction révolutionnaire des syndicats.
Cette approche limite le rôle des révolutionnaires à faire pression sur les directions actuelles. Une pression de gauche peut forcer la bureaucratie à déployer des tactiques et une posture plus combative ou même pousser les travailleurs à dépasser leur direction temporairement. Mais si l’on n’offre pas une stratégie fondamentalement différente à laquelle puissent se rallier les éléments d’une nouvelle direction, on condamne le mouvement à rester entre les mains de la bureaucratie. Le moment venu celle-ci pourra saboter la lutte, quelle que soit la pression exercée sur elle entre-temps.
Critiquer les tactiques des directions syndicales sans chercher à construire une nouvelle direction sur la base d’une stratégie révolutionnaire, c’est s’attaquer aux symptômes de la maladie sans toucher à sa cause.
Le gauchisme antisyndical
Une politique sectaire envers les syndicats est tout aussi néfaste qu’une politique opportuniste. Bien qu’elle se couvre le plus souvent de verbiage radical, la conséquence pratique est la même : l’absence d’alternative à la bureaucratie.
Certaines organisations associent la politique procapitaliste des directions syndicales aux organisations syndicales elles-mêmes. Ce faisant elles nient ce que tout travailleur conscient comprend intuitivement : même le plus réactionnaire des syndicats constitue un rempart contre le patron et un point d’appui pour l’action collective. Le résultat de cette position gauchiste réactionnaire est d’abandonner les travailleurs lorsque leur organisation est attaquée par l’État ou le patron et cela fait perdre aux « marxistes » toute crédibilité aux yeux des travailleurs.
L’abstentionnisme radical
Une expression moins réactionnaire mais tout aussi stérile de politique sectaire est de dénoncer la bureaucratie syndicale avec du verbiage révolutionnaire sans offrir quoi que ce soit pour répondre aux problèmes concrets des ouvriers. Au mieux cette approche est totalement stérile.
Avec de grandes proclamations sur la nécessité d’une révolution, on peut se donner à soi-même l’impression d’être de grands révolutionnaires, mais on n’avance en rien la conscience de classe. La seule manière pour véritablement augmenter l’influence des idées révolutionnaires, c’est en montrant comment elles sont essentielles pour faire avancer la lutte des travailleurs.
L’aventurisme
Lorsqu’une organisation n’exerce aucune influence réelle dans une industrie il est facile de mettre de l’avant des revendications radicales sans se soucier du contexte politique et des obstacles à leur mise en œuvre. C’est une politique stérile, mais généralement sans impact. Beaucoup plus dangereux sont ceux qui exercent une vraie influence et qui lancent les travailleurs à l’offensive alors que les conditions ne sont pas propices.
Critiquer la bureaucratie en se fondant uniquement sur son manque de radicalité a pour conséquence pratique de pousser constamment à des actions plus radicales. À défaut d’une conception révolutionnaire plus large de la situation politique, cela donne des résultats caricaturaux où des petits groupes de travailleurs isolés se lancent à l’offensive ou restent en grève alors qu’ils n’ont aucune chance de remporter la victoire. Cette politique démoralise l’avant-garde et peut mener à des conséquences catastrophiques bien pires qu’une simple politique de conciliation.
Une direction révolutionnaire doit guider la lutte de classe à l’offensive comme à la défensive, pas appeler à l’offensive en toute circonstance !
L’économisme
La pression du travail en entreprise tend à limiter l’horizon politique aux problèmes les plus immédiats. La tâche des révolutionnaires est non seulement d’offrir aux travailleurs une perspective plus large de leur oppression mais de leur montrer qu’une conception générale des rapports de classe, du contexte politique et des conditions internationales est essentielle pour mener à bien les luttes, aussi modestes soient-elles.
Une conception économiste du travail syndical s’accommode au contraire à la conscience politique des couches retardataires de la classe ouvrière. Par exemple, face aux tensions raciales, la réponse économiste est de prôner abstraitement l’unité contre les patrons. Ce faisant on n’explique pas pourquoi les travailleurs ont tout intérêt à lutter activement contre l’oppression raciale. On cherche à « maintenir l’unité » non pas sur la base d’une conscience de classe supérieure mais selon le plus petit dénominateur commun. Les antagonismes qui divisent les travailleurs sont ainsi préservés.
Programme minimum et maximum
Le travail révolutionnaire en entreprise est nécessairement un travail concret. Il doit s’attaquer aux problèmes les plus pressants que confrontent les travailleurs dans leur quotidien. Cela ne rend pas pour autant ce travail réformiste ; pour surmonter les obstacles qui maintiennent la classe ouvrière docile et divisée il faut une compréhension marxiste de la société capitaliste.
C’est en mettant le programme marxiste en pratique contre la bureaucratie procapitaliste – le principal obstacle à la conscience de classe – que le travail syndical devient un travail révolutionnaire. La synthèse entre programme minimum et programme maximum se fait précisément lorsqu’une conception révolutionnaire large est employée pour guider les luttes immédiates du prolétariat. Les erreurs énumérées dans ce document ont toutes pour point commun de briser ce lien essentiel.
Pour voir comment la LCI met ces principes en application consultez : iclfi.org/t/fr/syndicats