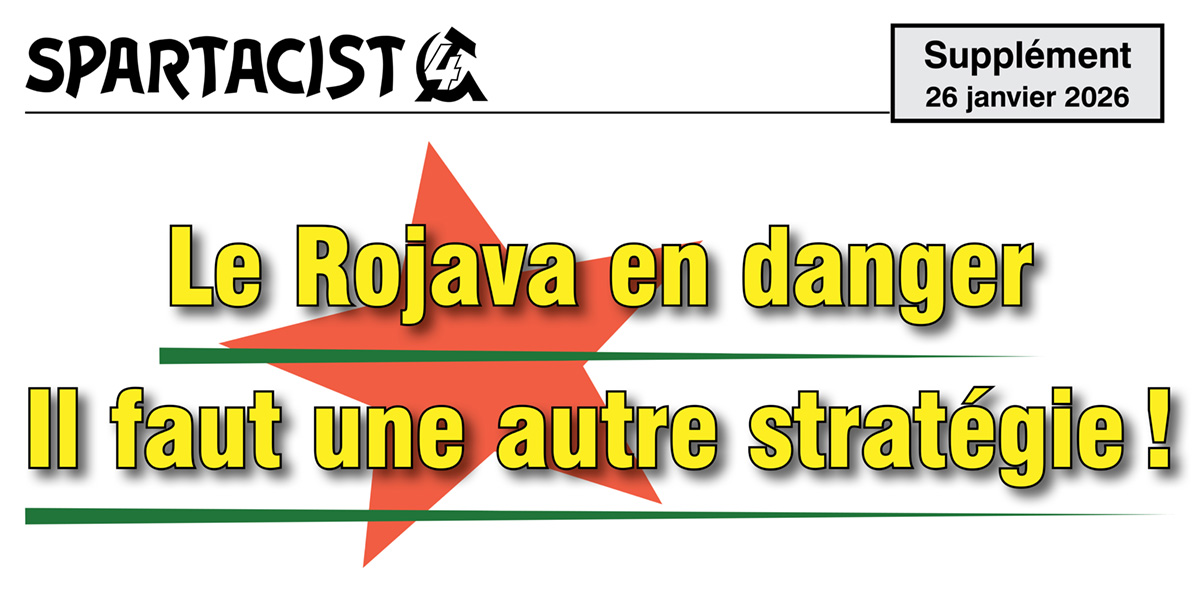https://iclfi.org/spartacist/fr/2025-monde
Où va le monde ? Vivons-nous « une chaîne mondiale de mouvements de masse, d’insurrections, de soulèvements et de révolutions », comme l’affirme l’Internationale communiste révolutionnaire (ICR) ? Ou bien « Trump et ses satrapes arrogants font du pays de Lincoln celui d’un aspirant Führer », comme le croit le Parti de l’égalité socialiste ? Peut-être un peu des deux, et « dans les mois à venir, nous pourrions assister à un processus combiné de guerres, de révolutions et de contre-révolutions qui pourrait ouvrir une situation mondiale prérévolutionnaire, voire révolutionnaire » (Courant communiste révolutionnaire international). Si les trotskystes ont des opinions divergentes sur où vont les choses, ils ne sont pas les seuls. On trouve de tous côtés des commentaires sur « la montée du fascisme », « l’effondrement du dollar », « les bulles boursières », « la révolution de l’IA » et « la guerre mondiale ». Il n’y a pas d’image cohérente et tout cela donne le tournis.
Si la confusion est si grande, c’est parce que le monde approche rapidement un tournant décisif et, comme le calme avant la tempête, les signaux se contredisent. Mais la question demeure : où va-t-on ? Pour y répondre en marxistes, nous ne pouvons pas nous contenter de sauter d’un titre de journal à l’autre ou de consulter les derniers sondages d’opinion. Il faut comprendre la dynamique interne des événements mondiaux et distinguer les courants dominants des contre-courants secondaires. Cette méthode n’exclut pas les erreurs ou les événements imprévus, mais elle offre le seul moyen d’éviter de se laisser emporter par l’impressionnisme.
La Ligue communiste internationale pense que nous sommes à l’aube d’une période réactionnaire d’offensive capitaliste où les conditions de vie des travailleurs seront attaquées à une échelle sans précédent depuis des décennies. Cela ne veut pas dire que ce sera une bataille à sens unique et que nous devons simplement baisser les bras. Bien au contraire. Cela exige une détermination à toute épreuve, des actions défensives et une préparation sérieuse. Plus la résistance sera forte, plus vite la classe ouvrière pourra passer à l’offensive. Mais pour y arriver, les travailleurs avancés et le mouvement socialiste doivent avoir une compréhension correcte du rythme et de la direction des événements.
Malheureusement, comme le suggèrent les exemples ci-dessus, la plupart des militants de gauche ont une vision du monde totalement décalée de la réalité, notamment en ce qui concerne le sentiment dominant dans la classe ouvrière. La plupart de ces militants vont vers la gauche : ils font de l’agitation pour des grèves générales et des soulèvements alors même que le monde va à droite. Pour éviter un choc douloureux avec la réalité, les communistes doivent ôter leurs œillères partisanes, étudier la situation mondiale actuelle et en débattre sérieusement.
PARTIE I : LES PRINCIPALES TENDANCES DE LA POLITIQUE MONDIALE
Pour comprendre la situation, il faut commencer par le haut. Le principal facteur imprimant sa marque sur la politique mondiale est le fossé croissant entre le rôle dominant que jouent les États-Unis sur la scène mondiale et leur puissance économique en déclin. La domination incontestée des États-Unis dans les années 1990 et 2000 garantissait un ordre mondial oppressif mais stable. Maintenant que la force centripète des États-Unis s’affaiblit, de plus en plus de conflits régionaux éclatent, l’économie mondiale vacille et les dirigeants américains déchirent les anciennes règles en tentant désespérément de maintenir leur position. C’est là qu’intervient Donald Trump.
Mais que veut donc Trump ?
Depuis un an, Trump bouleverse la politique mondiale, attaquant ses amis tout autant que ses ennemis. Mais ses actions ont-elles une logique ou sont-elles totalement incohérentes ? De nombreux commentateurs ont ruminé cette question. Le problème, c’est que c’est l’un et l’autre. Trump est un crétin qui n’a manifestement pas de plan cohérent, mais c’est un crétin ayant un fort instinct de classe. Il comprend que les États-Unis ont en réserve une énorme force brute et qu’ils doivent prendre des mesures drastiques pour enrayer leur déclin. Ainsi, comme tout bon magnat de l’immobilier, il recourt au chantage et à l’intimidation pour obtenir tous les avantages possibles. Il attaque, puis il observe la réaction. S’il pense qu’il a vu trop grand, il fait marche arrière. S’il sent une faiblesse, il en rajoute une couche. Cette approche est chaotique mais elle s’est avérée efficace pour obtenir des concessions de la part des pays dépendants du Sud global ainsi que des alliés des États-Unis. Mais elle s’est révélée inutile pour faire reculer la Russie et la Chine, qui ont toutes deux les moyens matériels pour résister aux menaces américaines.
Le problème de Trump est que, malgré toute la puissance de l’État américain, il ne peut pas remodeler l’économie mondiale à sa guise. Il ne peut pas non plus inverser des décennies de déclin économique relatif, du moins pas à court terme. Cela explique pourquoi tant de choses sont restées inchangées malgré les pitreries de Trump. Fondamentalement, ce sont des forces objectives, l’économie et le résultat des guerres, qui sont les principaux moteurs de l’histoire. À moins d’une guerre nucléaire, Trump ne peut rien faire pour empêcher la Russie de gagner la guerre en Ukraine. Il n’est pas non plus en mesure actuellement d’étouffer l’économie chinoise avec des droits de douane.
Bismarck a dit un jour : « Un homme d’État ne peut rien créer lui-même. Il doit attendre et écouter jusqu’à ce qu’il entende les pas de Dieu résonner à travers les événements ; puis il doit se lever et saisir l’ourlet de son vêtement. » Trump ne perd pas de temps à attendre ; il saisit le moindre fétu qui lui tombe sous la main. Mais de grands bouleversements se profilent, et au moment où titube l’histoire Trump sera à la tête de l’État le plus puissant du monde. À ce titre, le courant politique qu’il représente, le populisme de droite agressif d’une bourgeoisie impérialiste en déclin, jouera très probablement un rôle prépondérant dans la refonte de l’ordre mondial.
La Chine ne prend pas le contrôle du monde
Et la Chine ? Ne jouera-t-elle pas un rôle clé dans les chocs imminents qui vont secouer le système mondial ? La Chine, et son rôle international, est l’un des facteurs les plus importants mais les plus mal compris de la politique mondiale. La plupart des gens considèrent la Chine comme une superpuissance montante déterminée à supplanter les États-Unis. Certains pensent que cela conduira au progrès, d’autres sont horrifiés par cette perspective. Ils ont tous fondamentalement tort. S’il est vrai que l’essor économique et social de la Chine a été phénoménal et que le pays remet en cause la domination américaine dans toute une série de domaines, le Parti communiste de Chine (PCC) ne cherche pas à entrer en confrontation avec le système impérialiste américain. Il vit au contraire dans l’illusion qu’il peut continuer à se développer graduellement au sein de ce système hostile.
Il n’est pas nécessaire de faire une analyse complète de l’État chinois (voir « La nature de classe de la Chine », Spartacist n° 47, décembre 2024) pour se rendre compte que quelque chose ne colle pas dans l’histoire d’une Chine ascendante agressive. Si la Chine est le jeune et dynamique prétendant au trône de la domination mondiale, pourquoi est-ce les États-Unis et non la Chine qui font chanter et attaquent tous les pays de la planète ? Pourquoi la Chine n’a-t-elle pas construit une alliance pour affronter les États-Unis ? Pourquoi n’inonde-t-elle pas l’Iran, le Venezuela et la Palestine de systèmes d’armements modernes pour repousser l’agression impérialiste ? Non, au lieu de cela, le PCC continue de déblatérer sur la coopération gagnant-gagnant et la préservation de l’ordre multilatéral, alors que le principal garant de cet ordre, les États-Unis, est en train de le tailler en pièces.
Les défenseurs du PCC et les partisans des BRICS affirment souvent que la Chine fait preuve d’intelligence en ne défiant pas directement les États-Unis. Ils soutiennent que la Chine est en train de construire lentement mais sûrement les fondations d’un nouvel ordre économique multipolaire. Ce point de vue est erroné à deux égards. Premièrement, il nie l’existence d’un antagonisme fondamental entre le régime social chinois, établi par une révolution anticapitaliste, et l’économie capitaliste mondiale. À long terme, les relations économiques capitalistes, tant nationales qu’internationales, ne favoriseront pas le « socialisme aux caractéristiques chinoises » du PCC, mais le saperont et le détruiront. La deuxième erreur consiste à penser que les États-Unis vont simplement creuser leur propre tombe, garantissant ainsi l’ascension de la Chine. Cela minimise le danger que représente un empire américain en déclin. Livrés à eux-mêmes, les États-Unis répandront la misère, le chaos et la guerre à une échelle incommensurable. La Chine ne peut s’en tenir à distance. Son propre développement, et celui de l’humanité, exigent qu’il soit mis fin le plus rapidement possible à l’empire américain.
Si l’on examine la situation mondiale avec un minimum d’objectivité, il est évident que la Chine joue un rôle conservateur et qu’elle se méfie des chocs et des conflits, tandis que les États-Unis sont le principal agent de perturbation et de désordre. Ce n’est pas ainsi que se comporte une puissance impérialiste ascendante ; c’est ainsi que se comportait un État ouvrier dirigé bureaucratiquement comme l’Union soviétique. Il ne fait aucun doute que la Chine jouera un rôle important dans la période de turbulences qui s’annonce sur la scène politique mondiale. Mais en raison de sa nature politique conservatrice, le PCC continuera à jouer les seconds rôles derrière Trump, réagissant aux événements au lieu de les modeler.
Révolutions de la génération Z ?
Pour la plupart de la gauche, la montée de la réaction est contrebalancée par une montée tout aussi importante des luttes populaires. L’ICR parle d’un « septembre rouge » et d’un « tournant majeur dans la situation mondiale ». L’optimisme de cette analyse repose en grande partie sur la vague de soulèvements dans le monde semi-colonial qu’on a baptisée « révolutions de la génération Z ». Ces derniers mois des pays comme le Népal, l’Indonésie, Madagascar, le Maroc, le Pérou et la Tanzanie ont tous connu des explosions de mécontentement.
Chaque mouvement avait sa propre dynamique politique. Mais ils ont tous été fondamentalement causés par la détérioration des conditions de vie des jeunes dans un monde où la mobilité sociale et le développement sont des perspectives lointaines. Dans le passé, l’ordre américain suscitait des illusions dans le progrès économique et démocratique tout en utilisant l’émigration et l’argent des ONG comme soupapes de sécurité. Tout cela est terminé. En l’absence d’une perspective d’avenir viable, l’explosion sociale devient le seul exutoire.
Les soulèvements récents ont fait l’objet d’une répression massive (Indonésie, Maroc, Pérou, etc.) et, dans le cas de Madagascar, le résultat est un nouveau régime dirigé par l’armée. Pour l’instant, aucun virage radical vers la gauche ne semble s’être produit dans ces pays. Et à l’échelle de la politique mondiale, les révolutions de la génération Z restent une sous-tendance qui n’a pas stoppé le glissement général vers la réaction impérialiste.
La raison principale en est que ces explosions populaires n’ont pas trouvé de véhicules politiques capables d’orienter leur énergie dans une direction progressiste. Dans l’ensemble, la gauche n’a pas été en mesure d’offrir une direction aux soulèvements de masse. Au Népal, le soulèvement était en fait dirigé contre les différents partis communistes qui ont gouverné le pays. Au Sri Lanka, le soulèvement populaire de 2022 a finalement porté au pouvoir une coalition dirigée par les communistes, mais celle-ci a déjà trahi les aspirations des masses en s’inclinant devant le FMI.
Les problèmes causés par le manque de direction dans ces soulèvements sont aggravés par le fait que la classe ouvrière organisée n’a pas joué un rôle majeur. En fait, malgré les explosions sociales en Asie, en Afrique et en Amérique latine, la classe ouvrière industrielle du Sud global, qui représente la majorité écrasante du prolétariat mondial, n’a pas encore montré de signes de combativité accrue. Cela est dû en grande partie à la détérioration des perspectives économiques des travailleurs d’industrie. Si le prolétariat montrait sa force dans des pays comme la Chine, le Mexique ou l’Indonésie, cela donnerait beaucoup plus de poids social à la lutte et pourrait changer radicalement la politique mondiale.
Ces observations ne minimisent en rien le potentiel révolutionnaire dans le Sud global, y compris dans des pays périphériques de l’économie mondiale. À mesure que le monde s’enfonce dans le chaos de l’empire américain en déclin, la pression sur ces pays va s’intensifier, nourrissant ce qui sera très probablement le courant révolutionnaire le plus important de la période à venir. Les soulèvements récents étaient largement spontanés et politiquement amorphes. Mais comme la répression et les solutions réformistes ne parviennent pas à contenir la colère populaire, les éléments les plus avancés en tireront des leçons.
C’est la tâche des marxistes d’accélérer ce processus en aidant les combattants révolutionnaires du Sud global à tirer les leçons des échecs passés et à se rassembler derrière une stratégie anti-impérialiste unifiée (voir « En défense de la révolution permanente », Spartacist n° 46, novembre 2023). Cela nécessite un travail sérieux, systématique et de long terme. Malheureusement, la pratique trop courante de la gauche révolutionnaire consiste à saluer un soulèvement populaire, appeler à la création d’une forme ou une autre de comités ouvriers indépendants, puis passer à autre chose dès que l’ouverture s’estompe. De telles méthodes répandent illusions et cynisme ; elles ne contribuent en rien à organiser la lutte révolutionnaire dans les pays du Sud global.
Le populisme de droite en Occident
Et l’Occident ? Sommes-nous au bord d’une dictature fasciste ou la révolution est-elle au coin de la rue ? Ni l’un ni l’autre, du moins pour l’instant. Là encore, il faut se défaire de l’impressionnisme hystérique et examiner les tendances politiques réelles. Partout en Occident, on voit le centre politique s’effondrer sous les coups d’une droite populiste montante. La force de ce mouvement vient du fait qu’il est généralement la seule force politique s’opposant fermement au statu quo libéral des dernières décennies. En effet, la plupart des principales forces de gauche, bien que parfois radicales dans leur langage, sont pleinement dévouées à soutenir le centre contre la droite. Non seulement cela ne va pas arrêter la droite, cela condamne également la gauche à sombrer avec l’effondrement de tout l’édifice de la démocratie libérale.
Les différents pays ne sont pas au même stade de ce processus. Aux États-Unis et en Italie, le populisme de droite est déjà au pouvoir. Cependant, sur le plan international et national, ces forces y sont toujours confrontées à l’opposition politique des débris de l’ère précédente, qui entravent leurs actions sans toutefois leur poser de véritable défi. En Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, les gouvernements centristes de Starmer, Macron et Merz sont des coquilles vides, méprisées à droite et à gauche. Ils doivent recourir à des moyens de plus en plus répressifs et bureaucratiques pour maintenir leur position. Mais chacune de leurs manœuvres ne fait que rebuter davantage les masses et alimenter la montée de la réaction.
Il y a ensuite des pays comme le Canada, l’Australie et l’Irlande, qui pensent qu’ils résisteront aux vents trumpistes. Au Canada, les mesures économiques agressives des États-Unis ont temporairement renforcé le centre libéral. En Irlande et en Australie, l’espoir est répandu que ces nations insulaires resteront à l’écart des grands courants de la politique mondiale. Le problème est que ces pays sont tous fondamentalement dépendants des États-Unis sur le plan économique et militaire et, malgré leurs discours de défiance, leurs élites finiront bien par s’incliner. Les communistes ne peuvent pas se laisser bercer par un faux sentiment de sécurité. Ce n’est qu’une question de temps avant que le centre libéral ne s’effondre également dans ces pays.
… Et la montée de la gauche ?
Mais, et la gauche ? Bon nombre des pays mentionnés ci-dessus ont également connu un rebond de la gauche : la victoire de Zohran Mamdani à la mairie de New York, l’élection de Catherine Connolly à la présidence irlandaise, la montée en puissance du Parti vert et de « Your Party » en Grande-Bretagne ainsi que les récentes grèves en France, en Italie et en Grèce. Pour beaucoup, ces phénomènes confirment que la montée de la gauche fait au moins contrepoids à celle de la droite. Malheureusement, ce point de vue est faux et repose sur une lecture erronée de la dynamique politique.
Dans la mesure où il y a eu un glissement vers la gauche, celui-ci touche principalement des couches libérales de la classe moyenne et des étudiants. Il est motivé par la peur de la montée de la droite et l’indignation face aux libéraux traditionnels qui sont en train de trahir les valeurs qu’ils disaient défendre. Il ne repose pas sur une montée intrinsèque de la conscience et de la combativité de la classe ouvrière. Dans l’ensemble, la classe ouvrière ne va pas vers la gauche mais constitue une partie importante de la base des partis populistes de droite. D’autres couches sont démoralisées, ce qui profite également aux forces réactionnaires. Comme la bourgeoisie va également vers la droite, les forces progressistes de gauche se retrouvent sans poids social décisif pour les soutenir.
De plus, la plupart des forces de gauche se présentent comme les défenseurs les plus cohérents et les plus combatifs de l’impérialisme libéral et non comme une force aspirant à conduire la classe ouvrière vers le socialisme – Catherine Connolly, le Parti vert en Grande-Bretagne et Die Linke en Allemagne sont des exemples typiques. Même au sein de Your Party, un parti en formation qui a le potentiel pour adopter un programme radical en faveur de la classe ouvrière, la plupart de ses partisans et de ses dirigeants restent très attachés au libéralisme britannique traditionnel. Dans tous ces cas, la tâche des socialistes est de lutter pour une rupture politique avec le libéralisme et une orientation claire vers la construction de liens avec la classe ouvrière.
Aux États-Unis, où Trump est à la Maison Blanche et le Parti démocrate est en désarroi, la dynamique est légèrement différente. La victoire de Mamdani contre le MAGA et l’establishment du Parti démocrate présente de nombreux parallèles avec les mouvements de gauche dans d’autres pays. Cependant, il faut faire au moins deux distinctions majeures. La première est que Mamdani provient lui-même de l’intérieur du système bipartite traditionnel de l’impérialisme américain. Même si de nombreux membres du Parti démocrate s’opposent à lui, il ne franchit aucune ligne rouge pour la bourgeoisie. Des personnalités telles que Barack Obama ont déjà tendu la main à Mamdani, cherchant à le ramener dans le giron de l’establishment. Deuxièmement, la campagne de Mamdani n’était pas vraiment fondée sur la défense de l’ancien statu quo libéral. Elle soulevait des revendications économiques minimales et évitait pour l’essentiel les questions sociales telles que l’immigration, l’oppression des noirs et la question transgenre. Ainsi, contrairement aux politiciens traditionnels qui restent en Europe, Mamdani donne peut-être un aperçu de l’avenir du Parti démocrate : plus interventionniste sur le plan économique, moins libéral sur le plan social.
L’essentiel est de comprendre que Mamdani ne surfe pas sur une vague d’intentions de la classe ouvrière new-yorkaise de se battre. La plupart des travailleurs sont terrorisés ou démoralisés, et certains soutiennent encore Trump. Pour l’instant, ils cherchent surtout à ne pas couler, dans un contexte où tous les aspects de leur existence se détériorent. C’est particulièrement vrai des travailleurs immigrés et des travailleurs noirs. Et si les dispositions de la classe moyenne et des jeunes étudiants comptent, les marxistes comprennent que sans le soutien de la classe ouvrière il ne peut y avoir de base viable pour une politique de gauche radicale. Ainsi, comprendre les dispositions de la classe ouvrière et ajuster son intervention en conséquence doit être au cœur du travail communiste dans la période actuelle.
Beaucoup citeront sans doute les récentes grèves en Italie et en France comme contre-argument. Il est vrai que ces deux pays ont connu d’importantes journées de grève, les plus importantes depuis des décennies en Italie. Cependant, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Fondamentalement, les tendances en Italie et en France ne sont pas différentes de celles du reste de l’Europe. Le centre s’effondre, l’extrême droite est au pouvoir ou en ascension, la majeure partie de la classe ouvrière va vers la droite et les classes moyennes libérales paniquent.
En France, la journée d’action traditionnelle avec grève et manifestation a été complétée par une agitation radicale des partisans progressistes de Mélenchon dans les grandes villes pour « tout bloquer ». Mais la gauche est toujours sur la défensive, le Rassemblement national réactionnaire est plus proche que jamais du pouvoir et les travailleurs continuent de souffrir de la défaite de la lutte contre la réforme des retraites en 2023. Dans ce contexte, l’agitation gauchiste en faveur d’une grève générale ne fait que renforcer la droite et la bureaucratie syndicale, qui peuvent se présenter comme des agents responsables de la stabilité, par opposition à une gauche déconnectée de la réalité.
Quant à l’Italie, la grève générale en défense de la Palestine a été une démonstration de force. Mais de nombreux travailleurs reprochent à ces mêmes dirigeants syndicaux de ne pas avoir mené de lutte sérieuse contre les attaques des patrons et du gouvernement Meloni. De plus, les grèves d’octobre ne semblent pas avoir radicalement modifié la dynamique politique en Italie, et Meloni reste bien en selle. Malheureusement, tant en France qu’en Italie, les récentes mobilisations s’inscrivent dans la lignée des fortes traditions syndicalistes de ces pays et ressemblent davantage à l’agonie de l’ancien ordre qu’aux premiers signes d’un réveil de la classe ouvrière contre la droite populiste.
Le fascisme n’est pas au coin de la rue
Notre analyse signifie-t-elle que le fascisme est imminent et inévitable ? Non. Bien que les préjugés réactionnaires et les forces populistes de droite soient en hausse, cela n’équivaut pas au fascisme, qui consiste en des mobilisations paramilitaires pour écraser le mouvement ouvrier et les opprimés. La violence raciste des voyous réactionnaires est en augmentation, mais ce sont principalement des incidents isolés et non des mouvements de masse organisés comme ceux du XXe siècle. Quant à la répression et à l’autoritarisme accrus de l’État, tels que les rafles de l’ICE [police de contrôle des migrants] aux États-Unis, ils indiquent une tendance dangereuse, mais pas encore la destruction physique de toutes les formes d’opposition politique qui accompagne un régime fasciste.
Comme la violence fasciste vise le mouvement ouvrier organisé et les groupes opprimés et les minorités, qui constituent une grande partie du prolétariat, elle sera confrontée à la résistance de la classe ouvrière. Il n’y a rien d’inévitable dans la montée du fascisme. Le but de notre analyse n’est pas d’être défaitiste, mais d’insister sur le fait que pour arrêter le fascisme et la réaction, il faut une stratégie qui parte des conditions réelles, et non de celles que nous souhaiterions.
Il faut insister ici sur le fait que ce qui est vraiment inévitable, c’est l’effondrement du centre libéral. Aucune manœuvre électorale ni aucune répression bureaucratique ne sauvera l’ancien ordre. Les criailleries sur le danger du fascisme ne sont que des tentatives désespérées pour rallier la gauche à la politique du statu quo. Comme un homme qui se noie, le centre libéral s’accrochera à la gauche en essayant désespérément de rester à flot. Le mouvement ouvrier doit répondre en donnant un coup de pied au libéralisme et non en se laissant entraîner dans sa noyade.
La seule vraie question pour les communistes est de savoir à quelle vitesse l’effondrement du libéralisme peut conduire à la montée d’une nouvelle tendance révolutionnaire de la classe ouvrière. Accélérer cette évolution doit être au centre de nos efforts. Cela exige de cesser de servir d’appendice de gauche au libéralisme. Mais cela exige également de se mouiller dans les événements politiques concrets et non de simplement crier à tous les vents des slogans révolutionnaires. Ce n’est qu’alors que les marxistes pourront commencer à reconstruire leur propre influence indépendante au sein de la classe ouvrière et à saper l’emprise de la droite.
PARTIE II : CHOCS À L’HORIZON
Maintenant que nous avons élucidé certaines des principales tendances dans la politique mondiale, nous pouvons tourner notre attention vers l’avenir. La situation actuelle est très précaire. De multiples volcans en activité menacent de faire éruption à tout moment, remodelant l’ordre mondial. Une orientation correcte pour la période à venir exige d’analyser ces différents points de tension, la manière dont ils sont susceptibles d’évoluer et l’impact politique qu’ils pourraient avoir.
Chine : Le géant endormi
La plus grande source de tensions géopolitiques à long terme est le conflit entre les États-Unis et la Chine. Cela dit, ces tensions ne semblent pas encore tout à fait sur le point d’éclater. La guerre des droits de douane entre les États-Unis et la Chine a révélé à quel point s’est renforcée la position de la Chine (un fait minimisé dans notre récente analyse). Non seulement la Chine domine la production industrielle mondiale, mais elle contrôle étroitement les terres rares essentielles au complexe militaro-industriel américain. Cela a contraint les États-Unis à reculer partiellement dans leur guerre économique contre la Chine, et cela a clairement montré que les États-Unis ne sont pas en mesure de provoquer non plus une guerre conventionnelle. Les États-Unis peuvent et vont très probablement trouver un moyen de contourner la mainmise de la Chine sur ces goulots d’étranglement essentiels à l’économie. Mais ce processus prendra des années.
Si la Chine avait l’intention de vaincre les États-Unis, il serait logique qu’elle pousse son avantage et paralyse l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des forces armées américaines. Cependant, comme nous l’avons déjà vu, le PCC est une bureaucratie conservatrice qui n’a pas de telles intentions. Il a au contraire choisi de stabiliser ses relations avec les États-Unis en concluant un accord commercial d’un an. On verra combien de temps cet accord tiendra. Mais dans l’intervalle, il donne du temps aux États-Unis pour combler les lacunes de leur chaîne d’approvisionnement et il leur laisse les mains libres pour attaquer les pays plus faibles, une évolution qui pourrait bien se retourner contre la Chine à l’avenir (voir « La Chine face à Trump », Spartacist n° 48, mai 2025).
Le Venezuela dans le collimateur
La menace la plus immédiate pèse sur le Venezuela, qui est ciblé par un énorme dispositif militaire. Une guerre totale entre les États-Unis et le Venezuela ébranlerait profondément toute l’Amérique latine. Si les États-Unis parviennent à renverser le président Maduro, cela pourrait entraîner un remaniement politique majeur sur le continent, inversant les acquis démocratiques des dernières décennies et ramenant l’époque des dictatures militaires d’extrême droite pro-américaines. La chute de Maduro resserrerait considérablement aussi l’étau sur l’État ouvrier cubain.
Si une agression militaire contre le Venezuela, limitée ou totale, est une possibilité réelle, il y a des raisons pour lesquelles les États-Unis pourraient vouloir l’éviter. Tout d’abord, une guerre avec le Venezuela serait très impopulaire aux États-Unis mêmes. Une invasion terrestre à grande échelle susciterait certainement une opposition massive. Non seulement une guerre risquerait de se transformer en un nouveau bourbier, rien ne garantit qu’elle serait couronnée de succès. Une agression militaire pourrait facilement se retourner contre les États-Unis et rallier la population vénézuélienne derrière le régime, tout en alimentant une opposition massive aux États-Unis dans toute l’Amérique latine.
Il ne fait aucun doute que certaines personnes au sein du Département d’État espèrent que la simple menace de la puissance de feu américaine suffira à provoquer l’effondrement du régime Maduro. Ces dernières décennies, le régime mis en place par Hugo Chávez et désormais dirigé par Maduro a freiné et étouffé l’énergie révolutionnaire des masses vénézuéliennes. Cette situation, combinée aux conséquences brutales des sanctions économiques américaines, a progressivement affaibli le soutien populaire dont bénéficiait le régime, ce qui l’a rendu de plus en plus fragile et répressif. Néanmoins, pour la classe ouvrière, une capitulation sans combat du régime Maduro serait le pire des scénarios. Elle donnerait une énorme victoire aux gusanos vénézuéliens à un coût minime pour l’impérialisme américain et elle démoraliserait profondément les masses dans toute l’Amérique latine.
Nous ne pouvons pas savoir ce que les États-Unis décideront de faire. Malheureusement, dans ce cas-ci Trump a toute l’initiative, et peu de choses l’empêchent dans l’immédiat de faire ce qu’il veut. Mais une fois que le génie sera sorti de la lampe et qu’un conflit militaire aura éclaté, les conséquences pourraient être imprévisibles et l’issue pourrait très bien ne pas être en faveur de Trump. Quoi qu’il arrive, les révolutionnaires doivent prendre fermement position pour la défense du Venezuela et de tout autre pays sur lequel les États-Unis jetteraient leur dévolu.
L’Ukraine à un point d’inflexion
En ce qui concerne la guerre en Ukraine, la situation est totalement différente. Ici, l’initiative est fermement entre les mains de la Russie, et Poutine n’hésite pas à jouer à fond toutes ses cartes. Les gesticulations diplomatiques de Trump ont fait leur temps. Malgré tout son bluff, il n’a pas pu conjurer le fait que la Russie est en train de gagner. Les récentes négociations n’ont fait que confirmer que le conflit sera décidé par la force des armes, et non par la diplomatie.
Le rythme de la progression russe s’est accéléré ces deux dernières années et nous sommes désormais à un tournant majeur dans le conflit. La chute de la ville de Pokrovsk non seulement représente la perte d’un important centre logistique, elle ouvre aussi potentiellement la voie à un effondrement de toute la position de l’Ukraine dans le Donbass, l’épicentre de la guerre. La chute du Donbass ouvrirait la voie à la Russie pour marcher jusqu’au Dniepr, l’artère économique principale de l’Ukraine. Il est possible que l’arrivée de l’hiver et la résistance ukrainienne retardent cela de quelques mois supplémentaires. Mais l’issue est inévitable, et ce n’est qu’une question de temps avant que les lignes ukrainiennes ne s’effondrent sous l’implacable offensive russe.
Les évolutions en cours entraînent des pertes catastrophiques et irremplaçables en hommes et en équipements pour l’Ukraine. Elles préparent également le terrain à une grave crise politique à Kiev, qui affaiblirait encore davantage l’effort de guerre. Les conséquences de la défaite de l’Ukraine ne se feront pas seulement sentir dans le pays lui-même, elles provoqueront un séisme politique dans toute l’Europe. Les gouvernements allemand, français et britannique ont investi énormément de capital militaire, économique et politique en Ukraine, et son effondrement ébranlera profondément la classe politique. Le choc se fera également sentir aux États-Unis, mais Trump bénéficiera d’un recul légèrement plus grand par rapport à toute cette affaire que ses homologues européens.
Ce n’est qu’après l’effondrement militaire de l’Ukraine que la diplomatie jouera un rôle plus décisif. La question sera de savoir si les États-Unis et la Russie parviendront à s’entendre sur un accord qui permettrait au moins de geler la ligne de fracture entre le bloc pro-américain et la Russie, ou si le conflit se poursuivra. Dans le premier scénario, on pourrait assister à l’imposition d’un ordre réactionnaire en Europe fondé sur un pacte russo-américain. Ce résultat serait idéal pour la Russie, qui n’a ni l’ambition ni le poids économique nécessaires pour chercher à dominer l’Europe à l’heure actuelle. Le principal obstacle à la conclusion d’un accord est le fait que les États-Unis ne sont pas disposés à ravaler leur fierté, accepter la défaite et réduire leur influence en Europe de l’Est. Les États-Unis se heurtent également à une forte opposition de l’Ukraine et de l’UE à tout accord substantiel avec la Russie.
Si les hostilités militaires se poursuivent, cela rendrait l’Europe extrêmement instable et pourrait finalement conduire à un affrontement militaire entre la Russie et l’OTAN, dont l’issue pourrait être cataclysmique. Malheureusement, en raison des lâches capitulations du mouvement ouvrier en Ukraine et en Russie (qui n’a en rien été aidé par le mouvement socialiste international) devant le nationalisme, la possibilité d’une solution ouvrière au conflit semble très lointaine à l’heure actuelle. Cela pourrait changer rapidement sous les coups d’une crise aiguë, mais l’avenir proche paraît sombre. Plus que jamais, les communistes doivent œuvrer à la construction d’un pôle révolutionnaire dans la région en unissant le prolétariat derrière un programme anti-impérialiste commun (voir « L’impérialisme américain serre la vis », Spartacist n° 48, mai 2025).
Israël prépare le prochain bain de sang
Depuis le 7 Octobre, Israël n’a cessé d’intensifier sa campagne de terreur génocidaire contre les Palestiniens. En raison des divisions et des hésitations politiques de l’Axe de la résistance, il a pu s’attaquer séparément et au moment de son choix aux différentes composantes de l’Axe. Cela a permis à Israël de poursuivre son effort de guerre pendant deux ans malgré un engagement au-delà de ses moyens. Aujourd’hui le cessez-le-feu négocié par les États-Unis permet à Israël de faire une pause pendant qu’il se prépare sans aucun doute à une nouvelle vague de carnage.
On peut résumer ainsi le résultat pour l’Axe de la résistance : le Hamas a pris un coup sévère mais a tenu bon, le Hezbollah s’est comporté comme un tigre de papier et panse ses blessures, l’effondrement d’Assad a entraîné une défaite stratégique et les Houthis sont sortis avec une réputation renforcée. Quant à l’Iran, le partenaire principal de l’alliance, il a réussi à tenir bon pendant les 12 jours de guerre avec Israël et les États-Unis. Cependant, sa position dans la région est affaiblie et il est confronté à des tensions internes croissantes.
Malgré le courage affiché par la Résistance, nombreux sont ceux qui se demanderont sans doute : « Tout cela en valait-il la peine ? » Au vu des résultats des deux dernières années, certains sont tentés de tirer des conclusions défaitistes et de faire des concessions aux États-Unis, à Israël et aux Émirats arabes unis. Il faut s’opposer à tout prix à de telles attitudes. Israël et les États-Unis continueront leur carnage dans la région jusqu’à ce qu’ils soient forcés d’arrêter. Il n’y a pas le choix : il faut résister ! Le récent conflit a confirmé ce fait et montré que la conciliation et l’hésitation ne mènent qu’à de nouveaux massacres israéliens. La cause palestinienne n’est pas seulement juste, elle est aussi une question de survie pour toute la population arabe d’Asie occidentale.
Il faut être clair : le conflit est toujours actif et les Palestiniens continuent de se faire tuer ; son intensité a seulement diminué et il éclatera à nouveau. Nous devons nous assurer que lorsque cela se produira, les leçons politiques et militaires appropriées auront été tirées (voir « Coulez le plan ! », supplément de Spartacist, reproduit dans Le Bolchévik n° 241, novembre 2025). Cela ne se fera pas automatiquement ; les communistes doivent aider à tirer ces leçons et à les transmettre aux éléments d’avant-garde de la lutte antisioniste, dans le monde arabe et à l’étranger.
L’Asie du Sud se délite
L’Asie du Sud est secouée par une instabilité croissante. Le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal ont tous connu des soulèvements populaires ces dernières années. Les tensions au Cachemire couvent. Il y a quelques mois à peine, le Pakistan et l’Inde étaient en guerre, et récemment l’Afghanistan et le Pakistan se sont livrés à des hostilités. Aujourd’hui les tensions montent à nouveau après les attentats à la bombe à New Delhi et à Islamabad. Alors que les différents gouvernements de la région ressentent le poids croissant des tensions géopolitiques et de la pression économique impérialiste, il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Cependant, de nouveaux chocs sont à prévoir. Compte tenu du poids démographique et économique du sous-continent indien, ceux-ci auront certainement des conséquences importantes sur la situation mondiale.
Les tensions croissantes en Asie du Sud sont elles-mêmes en grande partie le résultat d’un contexte international de plus en plus tendu. L’Inde, puissance hégémonique et pays le plus stable de la région, est elle-même de plus en plus sous pression. La détérioration rapide des relations entre Trump et le Premier ministre Modi a surpris et secoué la classe politique indienne. Beaucoup ont émis l’hypothèse que l’Inde chercherait à se rapprocher de la Chine et se détournerait des États-Unis. Il ne faut pas accorder beaucoup de crédit à ces idées. La classe capitaliste indienne reste profondément intégrée à l’Occident. Il faudrait une crise beaucoup plus grave pour rompre ces liens, notamment parce que les relations entre la Chine et l’Inde ont été marquées historiquement par une extrême hostilité.
Alors que les tensions menacent la région, la gauche doit dépasser les débats historiques cherchant la petite bête, dont elle se délecte, et se mettre à organiser une lutte unifiée contre l’impérialisme et les capitalistes vénaux qui bradent leurs pays et dressent leurs peuples les uns contre les autres (voir « La poudrière sud-asiatique », Spartacist édition en anglais n° 70, mai 2025).
Le facteur décisif : l’économie mondiale
Le facteur le plus important dans l’évolution de la politique internationale est l’économie mondiale. Elle sous-tend fondamentalement tout le reste et son évolution sera décisive sur le cours des événements. Il est impossible de prédire exactement quand la prochaine crise économique majeure éclatera, mais il ne fait aucun doute qu’elle approche et qu’elle aura des conséquences dévastatrices.
L’économie mondiale ne s’est jamais complètement remise de la crise de 2008. La croissance globale de l’économie réelle a été modeste et le niveau de vie dans la plupart des pays a stagné ou a reculé. Les principaux facteurs soutenant la croissance mondiale étaient les investissements massifs dans les infrastructures et le logement en Chine, les gigantesques mesures de relance monétaire et budgétaire prises par les gouvernements occidentaux pour soutenir leur économie et la frénésie spéculative sur les prix des actifs, centrée sur les États-Unis.
Parmi ces trois facteurs, seul le troisième perdure aujourd’hui. Le PCC a ralenti le rythme des investissements dans les infrastructures et a fait éclater la bulle immobilière, plongeant le marché dans une dépression. En réponse, le régime a investi massivement dans les « nouvelles forces productives », faisant baisser le prix de nombreux produits industriels, notamment les voitures électriques et les panneaux solaires. Ces investissements massifs ont créé un cycle déflationniste en Chine et accéléré la tendance à la désindustrialisation dans d’autres parties de la planète. Partout dans le monde, on observe un ralentissement de la production et une offre excédentaire de biens industriels.
Sur le plan monétaire, la plupart des grandes économies ont augmenté leurs taux d’intérêt en réponse à la flambée de l’inflation qui a suivi la pandémie de covid. Cela a marqué une rupture avec les conditions d’emprunt ultra-souples qui existaient depuis 2008. Il en résulte que l’emprunt devient de plus en plus coûteux, ce qui pousse de nombreux gouvernements à essayer de limiter leurs déficits. La plupart des pays impérialistes se retrouvent aujourd’hui avec un endettement historiquement élevé, qui risque de provoquer une grande instabilité politique et économique à l’avenir. Ces problèmes sont tous exacerbés par la volonté d’augmenter considérablement les dépenses militaires.
Quant à la bulle boursière centrée sur le marché américain, elle continue de gonfler après la correction des premiers jours de la présidence Trump. Cela a permis à ceux qui possèdent des actions de continuer à consommer à un niveau élevé. Pendant ce temps, tous les autres ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. La flambée massive des actions technologiques due à la soi-disant révolution de l’IA continue d’être le principal, et de plus en plus le seul, moteur des bénéfices des marchés boursiers. La valorisation boursière du concepteur de puces Nvidia a récemment atteint cinq mille milliards de dollars, ce qui signifie que la société vaut autant que la production annuelle totale de l’économie allemande. Il est évident que c’est insensé. Jusqu’à présent, la bulle a pu continuer à enfler en tirant parti de la valeur croissante des entreprises d’IA pour acheter davantage de produits d’IA, provoquant une spirale ascendante des valorisations. Cela aboutira nécessairement à un effondrement catastrophique. Il est impossible de prédire quand cela se produira exactement. Mais on peut constater que baisse le nombre de facteurs soutenant la bulle boursière, qui dépend de la croissance continue d’un nombre décroissant de valeurs.
Lorsque la musique s’arrêtera, on aura un aperçu de l’état réel de l’économie mondiale et du véritable rapport des forces économiques entre les grandes puissances. Dans un premier temps, un choc majeur n’entraînera probablement pas une montée de la combativité de la classe ouvrière. La peur de l’avenir et l’instinct de survie seront probablement les attitudes dominantes, ce qui permettra aux gouvernements de pressurer davantage les travailleurs malgré leur impopularité croissante. Les difficultés économiques à venir sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous insistons que la classe ouvrière doit adopter une posture défensive (voir « RP, NPA-R au 7e ciel, ouvriers au 36e dessous : Il faut combler le gouffre ! », Le Bolchévik n° 241, novembre 2025).
Cependant, la classe ouvrière ne se laissera pas malmener éternellement, et elle finira par se rendre compte que la lutte collective est nécessaire pour survivre. En particulier lorsque l’économie reprendra, nous pourrions assister à une montée à grande échelle des luttes ouvrières.
Les révolutionnaires dans une période réactionnaire
En tant que communistes, nous reconnaissons l’importance de l’élément subjectif, c’est-à-dire la capacité des individus et des partis à façonner l’histoire par leurs actions. À certains moments, comme lors de la Révolution d’octobre 1917, l’action consciente d’une avant-garde révolutionnaire peut être décisive. Mais le rôle des individus n’est décisif que dans la mesure où ils s’inscrivent dans le développement de processus historiques objectifs. Pour transposer cela dans le domaine de la voile, il est évident que savoir régler sa voile est décisif pour qu’un bateau puisse capter le vent, mais sans vent pas de navigation.
Que doivent donc faire les révolutionnaires dans une période où les vents de la lutte des classes ne soufflent pas dans notre direction ? Cela limite certainement de façon considérable l’impact direct que nous pouvons avoir sur les masses. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts subjectifs, pousser les masses à lutter. Mais cela ne signifie pas que nous soyons inutiles. Bien au contraire. Dans des conditions objectives difficiles, il est d’autant plus important de faire des choix avisés et conscients dans l’orientation de nos énergies. Nous devons anticiper les évolutions politiques et nous positionner pour y faire face avec succès (voir « La crise de la gauche marxiste et les tâches de la LCI », Le Bolchévik n° 239, mai 2025).
Il ne fait aucun doute que notre analyse sera considérée comme trop pessimiste par la plupart des militants, voire comme défaitiste. Nous ne pouvons que hausser les épaules face à de telles critiques. Leur optimisme aveugle face à la montée de la réaction est une caricature grossière du marxisme. Nous nous appuyons au contraire sur l’expérience du Parti bolchévique en suivant Trotsky :
« Grâce à ces événements, les “trotskystes” ont appris à connaître le rythme de l’histoire, c’est-à-dire la dialectique de la lutte des classes. Ils ont appris et, me semble-t-il, réussi dans une certaine mesure à subordonner à ce rythme objectif leurs desseins subjectifs et leurs programmes. Ils ont appris à ne point désespérer parce que les lois de l’histoire ne dépendent pas de nos goûts individuels et ne sont pas soumises à nos critères moraux. Ils ont appris à subordonner leurs goûts individuels aux lois de l’histoire. Ils ont appris à ne pas redouter les ennemis les plus puissants, si cette puissance est en contradiction avec les exigences du développement historique. Ils savent nager contre le courant avec la conviction profonde que le nouveau flux historique les portera jusqu’à l’autre rive. Tous ne l’atteindront pas ; beaucoup se noieront en chemin. Mais participer à ce mouvement les yeux ouverts, avec une volonté intense, c’est la satisfaction morale la plus élevée qui puisse être donnée à un être pensant ! »
− Leur morale et la nôtre, 1938