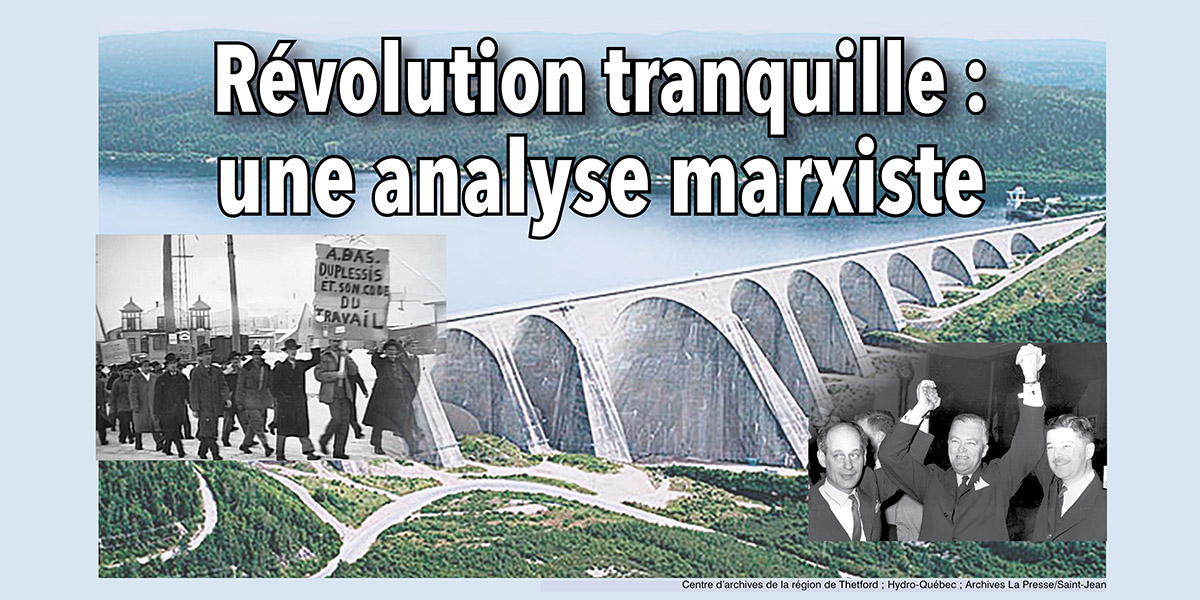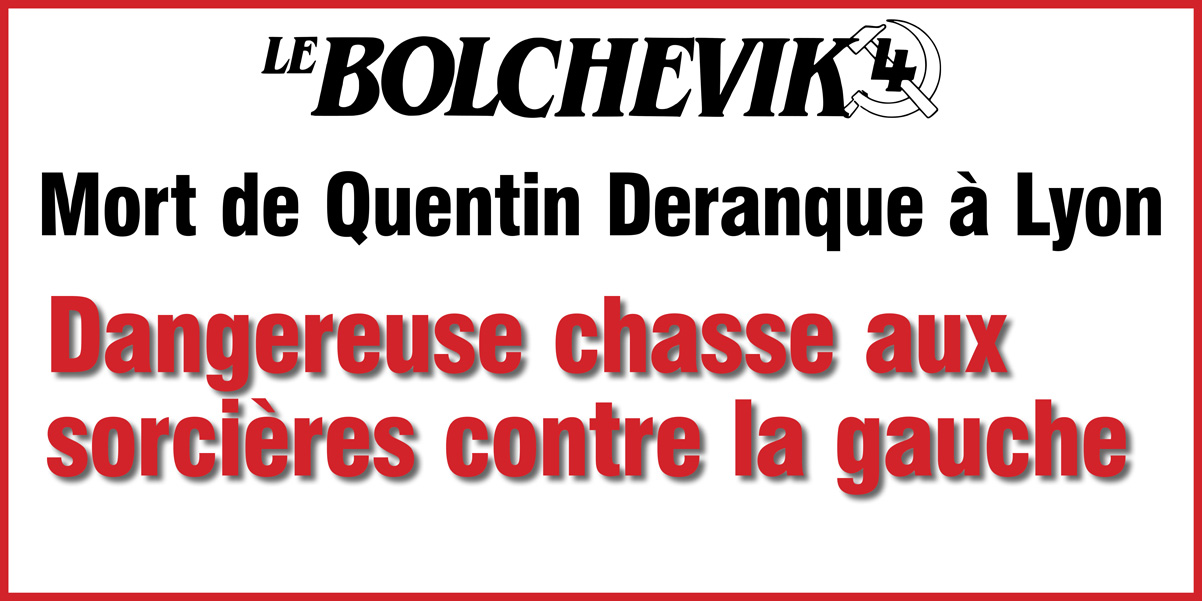https://iclfi.org/pubs/ro/6/revolution-tranquille-p1
Plus de soixante ans après le lancement de la Révolution tranquille, tous les progrès et les grands espoirs des années 1960-70 sont sous attaques constantes : infrastructures qui s’écroulent, système de santé et d’éducation en déroute, droits syndicaux bafoués, et la langue française de plus en plus en recul. En même temps, la question nationale fait un certain retour en force au Québec. Au moment d’écrire ces lignes, le Parti québécois est en tête des sondages contre le régime en fin de règne de la CAQ. Le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon n’hésite pas à parler ouvertement de la souveraineté. Et rien ne porte à croire qu’il s’agit là d’un feu de paille : c’est en fait toute la situation mondiale actuelle qui pousse objectivement à un regain du sentiment indépendantiste au Québec, y compris chez une partie grandissante, même si encore minoritaire, de la jeunesse. En effet, les crises à répétition récentes partout dans le monde engendrées par le déclin de l’Empire américain et la réaction trumpiste ne font qu’affermir les courants des petites nations cherchant à se libérer du joug de l’impérialisme. Que ce soit le génocide à Gaza, la guerre en Ukraine ou les menaces tarifaires de Trump, tout le vieil ordre mondial néolibéral de « libre échange » et de paix relative s’écroule. Et avec lui l’idée du « post-nationalisme » chère aux libéraux à la Trudeau qui ont toujours traité les aspirations nationales du Québec comme du tribalisme réactionnaire. La lutte de libération nationale du Québec s’exprimera au contraire de plus en plus comme un combat contre cet ordre mondial oppressif en déroute. La question sera de savoir si la prochaine génération de combattants pour la cause du Québec saura éviter les erreurs du passé et accomplir ce que la Révolution tranquille n’a réussi qu’à moitié : la libération nationale et sociale complète et entière du Québec, liée au combat de tous les opprimés de la terre pour leur libération.
Pour ce faire, étudier les leçons de la Révolution tranquille sera crucial. Du début des années 1960 jusqu’à 1980, le Québec était la scène des mouvements de contestation sociale les plus intenses : l’indépendance nationale se profilait comme véritable possibilité historique pour la première fois depuis la Rébellion des Patriotes, les syndicats parlaient de révolution, les jeunes rejoignaient l’extrême gauche, les artistes chantaient des temps nouveaux, etc. Simultanément et en conséquence, la société faisait des bonds gigantesques et très concrets vers la libération nationale, la libération des femmes, le pouvoir syndical, etc. La Révolution tranquille a ainsi été sans conteste la période la plus progressiste de l’histoire du Québec : en quelques années, cette nation opprimée est passée de la « Grande Noirceur » cléricale semblable à un régime néocolonial, à une société moderne et avancée. Une province auparavant complètement à la botte des maîtres anglo-canadiens et de l’impérialisme américain s’est dotée de leviers économiques et sociaux capables de jeter les bases d’un État indépendant. L’Église catholique, qui avait dominé toute la vie sociale et politique, a elle-même été essentiellement foutue à la porte. Des programmes publics d’éducation et de santé au départ pratiquement inexistants ont été établis. Et le mouvement syndical québécois, la véritable force motrice de toute la Révolution tranquille, s’est affirmé comme acteur incontournable. Bref, la Révolution tranquille était bel et bien une révolution au sens large, un éveil collectif, un changement de paradigme, et l’« avant » et l’« après » étaient tangiblement différents à tous les niveaux.
Alors pourquoi tout recule depuis ? Il est généralement compris que la défaite du référendum de 1980 et le tournant néolibéral qui a suivi ont cassé l’élan de la Révolution tranquille. Mais ce constat, en soi factuellement correct, n’explique pas grand-chose. Pourquoi les mouvements sociaux se sont-ils soudainement prostrés dans l’impuissance face à ce tournant ? En fait, ce qui n’est généralement pas compris, c’est que le marasme actuel au Québec trouve ses véritables racines dans le seul grand point faible de la Révolution tranquille : le fait que les besoins de la libération nationale et sociale du Québec aient été subordonnés aux intérêts de ses élites politiques et économiques ou, comme on dit entre marxistes, de la bourgeoisie québécoise. Ces élites menaient la Révolution tranquille poussées dans le dos par les masses populaires, mais sur la base de leurs intérêts à elles : s’arracher un peu de pouvoir pour elles-mêmes par rapport aux dirigeants anglo-américains, tout en réprimant les travailleurs pour qu’ils ne dépassent pas le cadre de la propriété privée et de la subordination à l’ordre impérialiste mondial dominé par les États-Unis. Le grand timonier de la Révolution tranquille lui-même, René Lévesque, personnifiait cette contradiction, dénonçant l’exploitation des travailleurs québécois un jour, puis s’acharnant contre les syndicats le lendemain ; déclamant contre l’impérialisme américain dont sont victimes les Québécois dans un discours, pour ensuite courir à Wall Street pour « rassurer » les marchés financiers !
Pour qu’elle aboutisse à une victoire sur toute la ligne, il aurait fallu que ce soit la classe ouvrière qui prenne la direction de la Révolution tranquille. Ou dit autrement, il aurait fallu un parti des travailleurs pour arracher la direction de la Révolution tranquille des mains du Parti libéral de Jean Lesage et plus tard du Parti québécois de René Lévesque. Mais c’est là précisément ce qu’ont toujours refusé de faire et les chefs syndicaux, et la gauche, même l’extrême gauche : à tous les tournants, ils ont plutôt promu ou du moins concédé que la lutte des Québécois se fasse sous la direction de ces bourgeois, quitte à se battre pour le socialisme « après » l’indépendance… que la classe dirigeante québécoise n’a jamais pu accomplir.
Cela est d’autant plus enrageant que c’est le mouvement ouvrier qui a été le fer de lance, l’épine dorsale et l’énergie vive de la nation et qui a fait de la Révolution tranquille une réalité. C’est la classe ouvrière du Québec, depuis la grève de l’amiante de 1949, qui a été à l’origine de tous les points forts de la Révolution tranquille, la plus grande période progressiste de l’histoire du Québec. Dès les débuts de l’industrialisation et des luttes syndicales du tournant du XXe siècle, les travailleurs étaient devenus une force sociale incontournable, tandis que les capitalistes québécois demeuraient en grande partie des notables de village insignifiants, en tous points subordonnés aux grands capitalistes anglophones qui contrôlaient les secteurs clés de l’économie du Québec. Les réformes d’État de la Révolution tranquille qui ont constitué une rupture avec cet état de subordination totale et ont bénéficié à tous les Québécois — l’institution d’organes financiers et économiques sous contrôle national, la nationalisation de l’hydro-électricité, le système de santé public, un réseau d’éducation moderne, les avancées pour les femmes, etc. — ont toutes été le résultat de la poussée de la classe ouvrière. C’est sur le dos des luttes des travailleurs que les élites québécoises ont pu s’élever et se tailler une place plus confortable face à leurs rivaux, jusqu’à devenir les chefs du « Québec Inc. »
Cette tension entre la poussée des travailleurs d’un côté et les intérêts étroits de l’élite de l’autre a toujours été présente dans la Révolution tranquille. En fait, plus le « rattrapage démocratique » du Québec se résolvait, plus le caractère irréconciliable des intérêts des travailleurs et des patrons prenait les devants de la scène, et plus le conflit de classe sous-jacent affichait un caractère aigu et explosif. La tâche de la gauche durant cette période aurait dû être de pousser de l’avant les aspirations de libération de la classe ouvrière pour les dresser contre la direction bourgeoise nationaliste — et contre les bureaucraties syndicales qui la soutenaient — en démontrant que celles-ci faisaient en fait obstacle au progrès national et social. Il fallait un parti révolutionnaire pour gagner la direction de la classe ouvrière sur cette base, démontrant qu’elle seule serait capable de mener les aspirations nationales et sociales jusqu’à leur réalisation par une lutte pour la prise du pouvoir des travailleurs. Mais faute d’un tel pôle ouvrier cherchant à arracher la direction du mouvement de libération nationale à la bourgeoisie québécoise, c’est finalement la classe capitaliste, sous la direction du Parti québécois, qui a pu casser l’élan du mouvement ouvrier et renverser la dynamique progressiste de la Révolution tranquille dans ses attaques sauvages contre les syndicats du secteur public en 1982-83.
Au fond, l’échec de la Révolution tranquille est aussi l’échec de la gauche québécoise, qui n’a pas su appliquer les leçons de la Révolution russe d’Octobre 1917 au contexte du Québec afin que la Révolution tranquille devienne une révolution « tout court ». Pour ce faire, il aurait fallu comprendre et appliquer la méthodologie de la révolution permanente développée par Trotsky sur la base de l’expérience de la Révolution russe. En effet, les bolchéviks de Lénine n’ont pas simplement porté la classe ouvrière russe au pouvoir en criant « révolution ! » Non, pendant des années, ils se sont battus pour l’indépendance de classe des travailleurs par rapport aux libéraux dans la lutte contre l’autocratie tsariste, pour démontrer que seul le prolétariat, en luttant pour le pouvoir, pouvait mener une lutte conséquente pour la résolution des questions démocratiques (les réformes dans le système politique et les réformes économiques et sociales qui étaient une nécessité pour la Russie), tout particulièrement la réforme agraire et la libération des nationalités opprimées dans l’empire russe. Ils ont montré à la classe ouvrière, à travers ses propres expériences, que la bourgeoisie libérale, son gouvernement provisoire résultant de la Révolution de Février, ses conciliateurs menchéviks et sociaux-révolutionnaires dans le mouvement ouvrier, que tout cela se dressait comme des obstacles qui devaient être balayés pour résoudre les questions démocratiques brûlantes. Dans les mots du dirigeant bolchévique Léon Trotsky : « le torrent national, de même que le torrent agraire, se déversait dans le lit de la Révolution d’Octobre » (« La question nationale », Histoire de la Révolution russe). De façon primordiale, les bolchéviks avaient scissionné d’avec l’aile réformiste du mouvement ouvrier, ces forces qui cherchaient à concilier la bourgeoisie libérale. C’est ce qui permit aux bolchéviks de gagner la direction de la classe ouvrière sur une base véritablement révolutionnaire.
Le Québec de la Révolution tranquille était de toute évidence bien différent de la Russie tsariste. Mais on y trouve de façon similaire une accumulation de questions démocratiques non résolues qui découlent toutes du fait que le Canada a été fondé sur l’oppression de la nation québécoise. Pour que la Révolution tranquille aille jusqu’au bout, il aurait fallu que la classe ouvrière rompe avec toutes les ailes de la bourgeoisie québécoise et se batte pour prendre le contrôle de la société sous une République ouvrière du Québec. Mais la gauche québécoise et canadienne n’a jamais été en mesure de mettre de l’avant une telle direction prolétarienne, indépendante et révolutionnaire. Incapables de lier « question nationale » et « question sociale » sur une base véritablement révolutionnaire, tous ces groupes vont capituler soit à la bourgeoisie nationaliste avec un programme pour s’allier avec elle et faire pression sur elle ; soit, comme les maoïstes, à la bourgeoisie anglo-chauvine canadienne en niant l’aspect progressiste de la lutte de libération nationale au nom d’une lecture totalement rigide et caricaturale du léninisme. Tare qui n’est pas unique aux maoïstes d’ailleurs : de nombreux groupes trotskystes, dont la Ligue trotskyste à l’époque, sont également tombés dans ce même panneau. Certains petits groupements arrivaient bien parfois près d’une analyse théorique correcte du Québec et de la Révolution tranquille, mais ne savaient pas la mettre en application en challengeant directement les dirigeants procapitalistes du mouvement ouvrier.
Les groupes de gauche se casseront la margoulette sur cette contradiction d’une bourgeoisie qui paradoxalement faisait des avancées progressistes tout en jouant un rôle réactionnaire. Tout d’abord le Parti communiste du Canada, qui prétendait porter la bannière de la révolution d’Octobre au Québec, s’opposait depuis toujours à l’indépendance et s’était débarrassé du gros de ses membres québécois en 1947 pour cause de « déviations nationalistes » suspectées. Les premiers trotskystes, c’est-à-dire la véritable continuité révolutionnaire et internationaliste avec la révolution d’Octobre, ont quant à eux défendu les leçons internationales du bolchévisme mais ne les ont pas appliquées sur le terrain québécois : ils n’avaient pas de position en faveur de la libération nationale non plus. D’ailleurs, ils n’étaient tout simplement pas un facteur au Québec au tournant de la Révolution tranquille. Lorsqu’ils se sont finalement implantés au Québec et ont commencé à appeler à la libération nationale, ils n’ont pas su combattre efficacement la bourgeoisie nationaliste et ses laquais ouvriers. De même, les autres groupes de la gauche radicale qui vont émerger au cours de la Révolution tranquille, y compris Parti pris et le FLQ, capituleront eux aussi dans les faits à ces élites nationalistes. Mais nous y reviendrons.
Question nationale ou question sociale ? Pour la gauche, la question se réduisait à ce paradigme apparemment insoluble : lutter pour l’indépendance en soutenant la bourgeoisie québécoise, ou rejeter la lutte de libération du Québec sous prétexte de s’opposer aux capitalistes québécois. Plus de soixante ans après le début de la Révolution tranquille, c’est toujours cette fausse dichotomie qui domine la gauche québécoise et qui doit être combattue pour la sortir de son impuissance. Il faut appliquer les véritables leçons de la Révolution tranquille et lutter pour jeter les bases d’une direction révolutionnaire de la classe ouvrière québécoise. Ce ne sera pas chose facile étant donné tout le temps perdu, mais c’est vital. Et c’est là le but de l’étude que nous présentons dans ces pages — résultat du combat politique que la Ligue communiste internationale, dont la Ligue trotskyste est la section au Québec et au Canada, a entamé pour se réapproprier une position véritablement léniniste sur la question nationale et la lutte pour la révolution permanente (voir Spartacist édition en français no 46, novembre 2023).
Les racines sociales de la Révolution tranquille
Pour comprendre le déroulement de la Révolution tranquille, il faut d’abord comprendre en quoi la structure sociale du Québec d’avant les années 1960 est le produit de la Conquête anglaise et plus directement de la défaite des rébellions des Patriotes de 1837-38. Le retard social et démocratique du Québec qui découle de son oppression nationale et conditionne toute la marche de la Révolution tranquille est issu de l’échec de cette tentative de révolution démocratique bourgeoise contre le colonialisme britannique et sa tyrannie monarchique. Le caractère fondamentalement réactionnaire de la bourgeoisie québécoise, les tâches du prolétariat qui allait se développer dans les cent prochaines années, et les rapports de classe qui existent au Québec à l’aube de la Révolution tranquille ont tous été façonnés par les évènements historiques de 1837-38.
Les patriotes du Haut et du Bas-Canada (qui deviendront plus tard respectivement l’Ontario et le Québec) luttaient pour des républiques démocratiques, pour la séparation de l’Église et de l’État, pour des réformes agraires et pour l’égalité de droits et de citoyenneté pour tous (pour tous les hommes en tout cas). Les radicaux canadiens-anglais comprenaient notamment que la lutte des Canadiens français pour leur souveraineté nationale était inséparable de leur propre combat démocratique. L’assemblée révolutionnaire de Toronto, par exemple, vota une résolution disant :
« Les réformistes du Haut-Canada sont appelés, par leurs sentiments, leurs intérêts et leurs devoirs, à faire cause commune avec leurs concitoyens du Bas-Canada. Leur écrasement présagerait le nôtre tandis que la réparation des injustices qu’ils subissent serait la meilleure garantie de redressement de celle que nous connaissons »
— cité dans Roch Denis, Luttes de classes et question nationale au Québec 1948-1968 (1979)
Les rébellions des Patriotes marquent effectivement la dernière fois que francophones et anglophones du Canada ont été véritablement unis dans une lutte progressiste. Elles furent écrasées dans le sang par les armées britanniques, leurs chefs pendus ou exilés. L’oppression du Québec s’inscrivit dans la fabrique même du Canada. Les francophones, qui formaient alors la majorité de la population, furent placés en minorité politique sous l’Acte d’Union avec un objectif assimilationniste conscient, tel que l’avait préconisé Lord Durham dans son tristement célèbre rapport suite aux rébellions :
« On ne peut guère concevoir de nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que celle des descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu’ils ont conservé leur langue et leurs coutumes particulières. C’est un peuple sans histoire et sans littérature….
« Tout plan qui sera adopté pour le gouvernement futur du Bas-Canada doit être d’en faire une province anglaise et qu’à cet effet il doit voir à ce que l’influence dominante ne soit jamais de nouveau placée en d’autres mains que celles d’une population anglaise. En vérité, c’est une nécessité évidente à l’heure actuelle. Dans l’état d’esprit où se trouve la population canadienne-française, état que j’ai décrit comme étant non seulement maintenant, mais pouvant aussi vraisemblablement durer longtemps, lui confier l’entière autorité de cette province ne serait de fait que faciliter la rébellion. Le Bas-Canada doit être gouverné maintenant, comme il doit l’être à l’avenir, par une population anglaise. »
« Tout plan qui sera adopté pour le gouvernement futur du Bas-Canada doit être d’en faire une province anglaise et qu’à cet effet il doit voir à ce que l’influence dominante ne soit jamais de nouveau placée en d’autres mains que celles d’une population anglaise. En vérité, c’est une nécessité évidente à l’heure actuelle. Dans l’état d’esprit où se trouve la population canadienne-française, état que j’ai décrit comme étant non seulement maintenant, mais pouvant aussi vraisemblablement durer longtemps, lui confier l’entière autorité de cette province ne serait de fait que faciliter la rébellion. Le Bas-Canada doit être gouverné maintenant, comme il doit l’être à l’avenir, par une population anglaise. »
Derrière ce mépris élitiste et raciste, les dirigeants coloniaux britanniques s’assuraient aussi de monter les deux groupes nationaux l’un contre l’autre pour prévenir toute autre lutte commune contre la monarchie britannique et pour la souveraineté nationale des Canadiens français.
La classe dirigeante anglo-britannique triomphante établit un nouveau « pacte » avec l’Église catholique, tolérant la langue et la religion des Canadiens français à condition que le clergé lui garantisse que cette province demeure docile et ne se révolte plus jamais. D’où le poids colossal que l’Église catholique acquit au Québec jusqu’à la Révolution tranquille. Pendant près de 125 ans, elle fut la « gardienne » de l’identité nationale, bien que de façon complètement réactionnaire, c’est-à-dire basée sur le maintien de l’oppression nationale du Québec et de la foi catholique romaine. Dès lors, chaque aspect de la vie sociale des Québécois fut soumis à la toute-puissance des curés — du berceau à la tombe, en passant par les écoles, les hôpitaux, les productions culturelles, la chambre à coucher. Les femmes en particulier en payèrent le prix avec une oppression des plus abjectes.
Les dirigeants patriotes eux-mêmes étaient surtout issus de la petite bourgeoisie, des notables et membres des professions libérales animés par les idéaux des lumières, la Guerre d’indépendance américaine et la Révolution française. Mais c’est la bourgeoisie québécoise (la classe à l’époque à peine naissante des chefs d’entreprises francophones) qui aurait immédiatement bénéficié des rapports sociaux que les rébellions des Patriotes auraient instaurés — constitution d’un État-nation, développement d’un marché intérieur, liberté d’entreprise et de commerce, etc. Cette défaite a donc aussi conditionné le développement rachitique de cette bourgeoisie québécoise : subissant elle-même une oppression nationale, elle s’est développée dans un état de subordination et de dépendance face aux puissances impérialistes montantes dans la deuxième partie du 19e siècle (d’abord les Britanniques, et plus tard les Américains) ainsi que leurs partenaires au Canada anglais. L’oppression nationale offrait des conditions d’autant plus favorables aux capitaux étrangers dans le processus d’industrialisation, ce qui accéléra en même temps la naissance d’un puissant prolétariat québécois. Au moment où est apparu au Québec quelque chose comme une classe bourgeoise francophone distincte, elle était déjà prise en étau entre l’impérialisme étranger d’un côté et la classe ouvrière québécoise de l’autre. Elle n’était plus en mesure de jouer un quelconque rôle indépendant pour libérer la nation.
En effet, la défaite des Patriotes et le développement subséquent de la bourgeoisie devaient confirmer, dans le contexte du Québec, le constat que Marx avait dressé après la vague révolutionnaire de 1848-49 en Europe : le rôle historiquement progressiste de la classe bourgeoise était terminé. Confrontée aux tâches démocratiques inachevées d’un côté, et, de l’autre, à un prolétariat entré dans l’arène révolutionnaire et qui risquait du même coup de porter atteinte à ses intérêts de classe capitalistes, la bourgeoisie allemande, par exemple, préféra se ranger du côté de la réaction féodale pour écraser la classe ouvrière. De façon similaire, même si la bourgeoisie québécoise avait aussi intérêt à s’émanciper nationalement, toute lutte conséquente sur cette voie risquait du même coup de déchaîner le prolétariat contre ses intérêts de classe fondamentaux. C’est ce qui en fit une classe réactionnaire, amère face à son oppression nationale, mais globalement complaisante dans son rôle de sous-fifre local pour le compte des impérialistes.
Les conclusions programmatiques que Marx dressa après 1848-49 s’appliquent ainsi tout autant au Québec. En parlant des ouvriers allemands, Marx disait :
« Mais ils contribueront eux-mêmes à leur victoire définitive bien plus par le fait qu’ils prendront conscience de leurs intérêts de classe, se poseront dès que possible en parti indépendant et ne se laisseront pas un instant détourner — par les phrases hypocrites des petits bourgeois démocratiques — de l’organisation autonome du parti du prolétariat. Leur cri de guerre doit être : La révolution en permanence ! »
— « Adresse du Comité central à la Ligue des communistes » (mars 1850)
Autrement dit, la classe ouvrière ne devait plus en aucun cas se subordonner à la bourgeoisie, pas même dans un premier stade pour l’accomplissement des tâches démocratiques-nationales, mais bien lutter absolument indépendamment de celle-ci pour réaliser elle-même l’accomplissement de ces tâches démocratiques dans une lutte continue (permanente) vers sa prise du pouvoir et le socialisme. Voilà également le programme qui aurait dû guider les révolutionnaires tout au long de la Révolution tranquille.
Ce n’est effectivement qu’avec l’arrivée en scène de la classe ouvrière et lorsque celle-ci portera au-devant de la société ses propres intérêts de classe que la libération nationale du Québec deviendra à nouveau une possibilité historique. Mais ce combat n’était alors plus porté par la classe bourgeoise dont la tâche historique consiste simplement à réaliser la constitution d’un État-nation ; il l’était maintenant par la classe ouvrière, pour qui les tâches historiques sont socialistes et dont les intérêts se heurtent en tous points avec ceux de la bourgeoisie. La véritable force motrice derrière la Révolution tranquille, c’était bel et bien les travailleurs, dont les aspirations sociales et nationales « se déversaient dans un seul et même torrent », brisant la structure politique réactionnaire héritée de la défaite des Patriotes et ouvrant une voie vers l’indépendance et le socialisme.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les vieux empires coloniaux européens, dont britannique, sont en lambeaux et des luttes de libération nationale éclatent partout dans le monde. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les luttes au Québec, où la classe ouvrière avait acquis un niveau d’organisation et de force qualitativement suffisant pour mettre au défi le régime en place. Ses grèves massives et ses luttes dures, bien que souvent déclenchées autour de demandes économiques de base, se confrontaient immédiatement à toute la structure politique réactionnaire : des boss anglophones, une bourgeoisie francophone subalterne et l’Église catholique complètement imbriquée avec le pouvoir d’État et soutenant tout cet édifice réactionnaire. Sous le régime de l’Union nationale de Maurice Duplessis, toutes les tensions de la société québécoise vont être portées à leurs limites et atteindre un point de bascule. La grève des mineurs d’Asbestos (1949), des tisserands de Louiseville (1952) des mineurs de Murdochville (1957) : ces conflits vont être pratiquement immédiatement élevés au point de confrontation contre le gouvernement lui-même et polariser l’ensemble de la société.
La petite bourgeoisie éclairée se rangera aussi aux côtés de la classe ouvrière. Déjà en 1948, le Refus global posait les jalons d’une révolte des intellectuels contre le duplessisme. Mais les luttes ouvrières allaient leur donner le moyen de leurs ambitions en quelque sorte. Un jeune avocat, fraichement sorti de Harvard et de la London School of Economics puis de retour au Québec, écrira par exemple au sujet de la grève d’Asbestos de l’année suivante :
« Elle a fait la preuve pour la première fois et une fois pour toutes, dans la province de Québec, qu’un mouvement ouvrier uni n’a à reculer devant aucune conjonctions de forces, quelles qu’elles soient, et quels que soient leur enracinement dans la tradition ou leur appui dans la morale du jour. De la sorte, une puissance nouvelle et contemporaine affirma sa maîtrise sur nos destinées collectives, le cours de l’histoire de notre province fut exorcisé, l’envoûtement qu’exerçait notre passé sur notre présent fut brisé, et une multitude de puissances créatrices fut libérée dans tous les domaines. »
Cette prose (certes plutôt pompeuse) est celle de nul autre que… Pierre Elliott Trudeau (« Épilogue », La grève de l’amiante, 1956, souligné dans l’original) ! Qu’un des futurs personnages les plus détestés de l’histoire du Québec put à l’époque marcher aux côtés des travailleurs sur les lignes de piquetage d’Asbestos n’est pas du tout fortuit. C’est en fait toute une couche de futures personnalités de la Révolution tranquille — de Trudeau à René Lévesque, en passant par Michel Chartrand — qui ont fait leurs classes dans le mouvement ouvrier d’avant la Révolution tranquille. Cela démontre bien ce que plus ou moins tout le monde se dit à l’époque : c’est la classe ouvrière qui est en train de chambouler en profondeur le Québec et qui ouvre la voie du progrès. Toute la question restait de savoir « où cela va nous mener ? » et, surtout « qui va prendre la direction de cette explosion d’énergie combative ? ». Lorsque Duplessis meurt en 1959, le Québec est déjà sur la voie de l’explosion sociale… et tout le monde le sait.
Le premier cul-de-sac : l’appui au Parti libéral
Les libéraux de Jean Lesage se présentent aux élections de 1960 sous le slogan « C’est le temps que ça change ! », mais le changement social est déjà bien entamé et a atteint un point de non-retour. Le succès de Jean Lesage et de son Parti libéral c’est plutôt d’avoir eu la clairvoyance que « nous, classe dirigeante québécoise » devons prendre la tête de ce mouvement, l’utiliser à nos fins et le garder dans les bornes que nous lui imposerons. Le rôle et la position contradictoires de la bourgeoisie québécoise se manifestent on ne peut plus clairement ici. Ce n’est pas la force motrice pour le changement social et l’émancipation nationale ; c’est la classe ouvrière qui lui donne l’impulsion et la confiance pour cela. Mais elle a aussi son propre intérêt à s’émanciper nationalement et à se placer dans une meilleure position face aux impérialistes anglophones. Ces intérêts, Lesage les explique de façon limpide dans son message aux capitalistes québécois en vue des élections de 1960 :
« [Les chefs d’entreprises] doivent se rendre compte avant qu’il ne soit trop tard, que l’Union Nationale bloque la voie du progrès économique, qu’elle pratique à leurs dépens le chantage électoral et qu’elle crée chaque jour, par son favoritisme et son encouragement aux abus, de nouveaux ennemis au système de l’entreprise libre. Ils doivent également se convaincre que si le mouvement de libération se fait sans eux, il pourrait peut-être — et ce serait regrettable — se faire aussi contre eux. »
— cité dans Roch Denis, Luttes de classes et question nationale au Québec 1948-1968 (1979, souligné dans l’original)
Quand Lesage parle de l’Union nationale qui « bloque la voie du progrès économique », de son « favoritisme » et de ses « abus », tous comprennent qu’il s’agit des politiques honnies du régime duplessiste, soudé au clergé : l’antisyndicalisme, les méthodes brutales contre toutes formes d’opposition et, surtout, ces politiques consistant à dilapider les ressources du Québec pour le bénéfice de compagnies américaines et canadiennes-anglaises. Lesage dit à la bourgeoisie québécoise qu’il faut que ça change, qu’il faut favoriser « notre » développement économique « à nous », capitalistes québécois. Il comprend en même temps que si la bourgeoisie québécoise ne se met pas elle-même à la tête de l’opposition à Duplessis et des aspirations démocratiques et nationales qui poussent la classe ouvrière de l’avant pour les canaliser vers ses intérêts de classe bourgeoise à elle, alors ce mouvement pourrait bien la renverser aussi.
Le fait que les aspirations sociales et nationales de la classe ouvrière se trouvèrent canalisées dans un soutien au Parti libéral n’était cependant pas du tout prédéterminé, et la responsabilité pour cette trahison repose entièrement sur les épaules des directions syndicales de l’époque. Celles-ci avaient toutes été éduquées à l’école du conservatisme ouvrier. Que ce soit, d’un côté, les dirigeants des « unions internationales », affiliées à l’American Federation of Labor ou au Congress of Industrial Organizations qui étaient hostiles aux revendications nationales des Québécois et suivaient les directives conservatrices et anticommunistes de leurs bureaucraties aux États-Unis ; ou, de l’autre, ceux de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC, ancêtre de la CSN), qui étaient organiquement liés à l’Église catholique et prêchaient la « bonne entente » entre patrons et travailleurs. Les deux tendances cherchaient d’une manière ou d’une autre à faire l’équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux à la tête du régime réactionnaire au Québec pour maintenir la « paix sociale ». Pour ne donner que l’exemple le plus flagrant de cette perspective de collaboration de classe, citons la première constitution de la CTCC qui disait :
« La CTCC réprouve en principe et en pratique la théorie de ceux qui prétendent que le capital, les capitalistes et les employeurs, sont des ennemis-nés du travail, des travailleurs et des salariés. Elle prétend, au contraire, qu’employeurs et employés doivent vivre en s’accordant, en s’aidant et en s’aimant. »
C’est sous la pression immense de la base des syndicats que de telles directions archiconservatrices furent poussées en lutte. De la grève d’Asbestos, où les travailleurs défièrent les appels de la direction de la CTCC de se soumettre à l’arbitrage, en passant par la grève de Louiseville, où les directions se dégonflèrent devant l’idée de lancer une grève générale dans la province, à la grève de Murdochville, tous les conflits majeurs qui déclenchèrent la Révolution tranquille allèrent bien au-devant des intentions des directions du mouvement ouvrier de l’époque.
Ce ne sont donc pas les bureaucraties syndicales qui poussaient de l’avant la classe ouvrière, bien au contraire. Absolument vouées au maintien de l’ordre capitaliste d’un côté, mais en contact le plus immédiat avec la force qui poussait contre les limites de cet ordre de l’autre côté (les travailleurs), les directions syndicales étaient simplement sur la ligne de crête de la vague montante de la classe ouvrière qui se frappait contre le régime réactionnaire du Québec, et donc ceux qui devaient y répondre et s’adapter en premier. Ils le feront par conséquent de la manière la plus conservatrice possible : en offrant à la bourgeoisie québécoise une voie de sortie pour résoudre les problèmes soulevés par la classe ouvrière d’une façon qui demeurerait fermement dans les limites de l’ordre capitaliste. Ainsi, le programme politique qui sera mis de l’avant par les syndicats dans la deuxième moitié des années 1950 — essentiellement un programme réformiste-nationaliste en santé, en éducation, pour la nationalisation de certaines ressources, pour le « réaménagement » des relations fédérales-provinciales dans le cadre de la constitution — et la plateforme électorale qui portera Jean Lesage au pouvoir sont à toutes fins pratiques identiques, ligne par ligne.
Certains analystes issus de la gauche québécoise — et au premier chef parmi ceux-ci l’ex-membre du Groupe socialiste des travailleurs du Québec Roch Denis (voir son livre autrement fort instructif sur la Révolution tranquille cité plus haut) — se lamentent sur le fait que l’action syndicale des années 1950 n’ait pas débouché sur la création d’un parti social-démocrate (comme le NPD) au Québec. Quiconque comprend de façon réellement marxiste les rapports de classe et le développement de la Révolution tranquille devrait cependant saisir immédiatement à quel point il s’agissait là d’une entreprise vaine. D’ailleurs, toutes les tentatives de créer une expression organisationnellement indépendante de la classe ouvrière sur la base d’un programme réformiste n’ont jamais fonctionné au Québec étant donné la dynamique même de la Révolution tranquille : une bourgeoisie nationaliste qui a un intérêt dans la mise en œuvre de réformes et va mettre en pratique le programme de la social-démocratie. Le Parti libéral n’avait vraiment qu’à cueillir le fruit que les directions syndicales avaient fait mûrir pour lui pendant des années, d’où le message de Jean Lesage aux syndicats avant les élections :
« [Les chefs syndicaux] devraient être convaincus que la province ne pourra se débarrasser de l’occupant s’ils ne participent pas activement au mouvement de libération ou s’ils décident d’entrer dans des formations politiques qui peuvent théoriquement satisfaire davantage leur idéal mais qui n’ont, en fait, aucune chance de réussir. »
— cité dans Roch Denis, Luttes de classes et question nationale au Québec 1948-1968 (1979)
En d’autres mots, Lesage demande l’unité dans la lutte nationale plutôt que la division en lignes de classes. À la fin des années 1950, une grande partie des dirigeants syndicaux québécois sont effectivement favorables au projet du nouveau parti ouvrier (le futur NPD) qui se prépare au Canada. Mais ce projet présuppose l’abstention du mouvement syndical sur la question des droits nationaux du Québec, qui seront toujours ignorés, ou même dénoncés, par les dirigeants ouvriers canadiens-anglais. Lesage indique en même temps que son programme de réformes sociales correspond à celui des syndicats et qu’il peut le mettre en pratique maintenant, alors pourquoi perdre son temps à créer un parti des travailleurs ? Les libéraux de Lesage enjoignent donc plutôt les syndicats à rejoindre le mouvement national… sous son leadership à lui !
Les syndicats allaient se rallier à ces arguments. Aucun parti ouvrier ne contesta les élections de 1960, et les chefs syndicaux donnèrent un soutien à tout le moins implicite aux libéraux — soutien qui deviendra explicite dans les prochaines années. Pourtant, le choix n’aurait pas dû se réduire à construire un parti social-démocrate déconnecté de la lutte nationale ou alors à soutenir le haut bourgeois (et fédéraliste !) Jean Lesage comme grand timonier de la nation. Son « maîtres chez nous » voulait dire en fait que les patrons québécois seraient les demi-maîtres d’une province canadienne.
La gauche aurait dû montrer que le prix de l’alliance avec Jean Lesage c’était de sacrifier les intérêts de la nation et des travailleurs. Elle se devait de résister à la pression très forte de simplement se mettre à la remorque du Parti libéral et des élites nationales. Au contraire, il fallait briser cette alliance et construire un parti ouvrier en opposant aux libéraux un programme qui corresponde aux intérêts sociaux et nationaux de la classe ouvrière. Un programme pour que les travailleurs soient « maîtres chez eux », c’est-à-dire un programme pour la République ouvrière du Québec !
Les réformes de la Révolution tranquille
En 1962, les libéraux déclenchèrent des élections sur la nationalisation de l’électricité. Dans ses discours, Jean Lesage présente la nationalisation comme la « clé » qui permettra de contrer le « colonialisme économique » soutenu par la « clique politique » des « rois nègres » ; la nationalisation permettra à la population entière du Québec « d’orienter elle-même son propre avenir économique » (cité dans Stéphane Savard, Hydro-Québec et l’État québécois 1944-2005, 2013). Avec la nationalisation et leur slogan de campagne « Maîtres chez nous ! », « l’équipe du tonnerre » de Jean Lesage et de son ministre vedette René Lévesque, venait cette fois taper au cœur des aspirations nationales de la classe ouvrière. Le mouvement ouvrier était déjà bien harnaché à son ennemi de classe lorsque le Parti libéral prit le pouvoir en 1960, mais les directions syndicales appelèrent cette fois ouvertement à voter « pour la nationalisation de l’électricité », ce qui signifiait tout simplement de voter libéral. Ce fut là le point culminant de la subordination de la classe ouvrière à la bourgeoisie québécoise durant cette période.
La bourgeoisie québécoise avait intérêt à moderniser la structure sociale du Québec. Elle avait besoin d’ingénieurs, d’une bureaucratie d’État et de technocrates éduqués, d’un réseau de santé capable de répondre minimalement aux exigences d’une société industrielle avancée. Faire apprendre le latin et la philosophie thomiste à la petite bourgeoisie éduquée est utile pour former des prêtres qui peuvent débattre du sexe des anges ; ce l’est moins lorsqu’il s’agit de construire des barrages hydroélectriques et des lignes à haute tension, ou de manier les chiffres de la statistique économique. Certes, la nationalisation de l’électricité au Québec était « une mesure hautement progressiste d’auto-défense nationale » (pour le dire dans les mots de Trotsky, lorsqu’il parlait du cas analogue de la nationalisation du pétrole au Mexique). Hydro-Québec, le développement subséquent de la Caisse de dépôts et placement, la centralisation dans les mains du gouvernement de pouvoirs politiques et économiques : c’est dans la mesure où ces réformes étaient dirigées contre l’oppression nationale du Québec qu’elles étaient foncièrement progressistes. C’est notamment ce qui a permis au Québec d’avoir la base économique nécessaire pour un éventuel État indépendant et de financer le rattrapage social des Québécois par rapport aux anglophones.
La nationalisation de l’électricité au Québec était une mesure qui allait à l’encontre de certains intérêts impérialistes (comme ces 11 entreprises qui seront nationalisées), mais qui demeurait nécessairement dans le cadre de la domination impérialiste et du capital financier. Jean Lesage était très clair sur ces motifs au début de la campagne de 1962, lorsqu’il disait :
« Non seulement la nationalisation de l’électricité n’est pas le début d’une campagne de socialisation générale à travers le Québec, mais je dirais même que la nationalisation est une condition essentielle à l’essor de l’entreprise privée de la Province. »
Même si la bourgeoisie québécoise avait déjà nationalisé le réseau électrique de la région de Montréal et créé Hydro-Québec en 1944, le développement économique de tout le territoire et de sa propre entreprise privée continuait de lui échapper presque entièrement. Elle avait besoin d’un point d’ancrage dans le processus industriel et de production de marchandise à partir duquel pouvoir l’influer vers son propre développement. L’électricité, une marchandise stratégique, pratiquement toujours en demande croissante et dont le potentiel de développement au Québec s’avérait le plus grand de tout le nord-est de l’Amérique apparaissait comme logique et nécessaire. Pour racheter ces compagnies étrangères entre lesquelles était morcelé le réseau électrique, c’est Jacques Parizeau qui est allé chercher 300 millions de dollars en emprunts à… Wall Street (après un « non » catégorique de toutes les banques canadiennes) pour racheter ces compagnies cotées à… Wall Street. Willis Armstrong, à l’époque bras droit de l’ambassadeur américain à Ottawa, offrait les remarques suivantes au sujet de la nationalisation : « Cela m’amusait d’entendre les gens parler de cette opération comme si nous allions réagir avec colère, alors que notre position était simple : si vous payez, vous avez le droit. » Et d’ajouter :
« Des intérêts américains [Wall Street] avançaient l’argent pour déposséder d’autres intérêts américains [des actionnaires des compagnies d’électricité], ce qui fondamentalement prouve que l’Amérique du Nord est un marché commun financier. »
— cité dans Jean-François Lisée, Dans l’œil de l’aigle (1990)
Est-ce qu’on s’émancipe nationalement des impérialistes en s’ouvrant un beau compte de dette chez eux avec lequel ils vont vous prendre par la gorge après ? Non, de toute évidence ! Dans le cas de la nationalisation de l’électricité, la bourgeoisie québécoise a réussi à tirer avantage de cette complaisance relative et conjoncturelle de l’impérialisme américain en s’appuyant sur la force de la classe ouvrière. Mais ces nationalisations sous le capitalisme ne sont pas le programme des socialistes. Si les révolutionnaires défendent ces mesures, ce n’est pas parce qu’elles sont une étape qui mènera « progressivement » vers le socialisme, mais bien parce que la défense des nations opprimées contre l’impérialisme est inexorablement liée à la lutte révolutionnaire. Le prolétariat avait intérêt à appuyer cette réforme, non parce qu’elle est un pas vers le socialisme, mais simplement parce qu’elle bénéficiait à la souveraineté nationale du Québec. En même temps, la nationalisation faite par la bourgeoisie a servi à endiguer et à contenir la lutte du prolétariat et à le rallier derrière les libéraux de Lesage. Avec l’appui des directions syndicales, elle s’est assurée à ce que les travailleurs ne dépassent pas les limites imposées par la classe dirigeante. Du fait de sa position de classe possédante, elle ne peut mener une lutte décisive contre l’impérialisme auquel elle est liée par mille liens sans remettre en cause les fondements de sa propre domination de classe dans la propriété privée, tandis que la classe ouvrière luttant pour ses propres intérêts la pousse toujours plus dans les bras des impérialistes. De fait, la nationalisation a constitué l’apex des grandes réformes de la Révolution tranquille : sa réalisation, l’appui des dirigeants ouvriers traîtres et l’absence d’un pôle révolutionnaire auront en fait permis à la bourgeoisie québécoise de mieux trahir la lutte pour la libération nationale (l’indépendance) à long terme, un thème qui reviendra tout au long de la Révolution tranquille.
C’est que la direction de la bourgeoisie nationale dans la lutte de libération nationale sera toujours timorée et limitée. Ce qui était posé était la nécessité d’une mouvance prolétarienne indépendante, un bloc ouvrier luttant contre la direction libérale des élites québécoises en mobilisant pour mettre en œuvre les nationalisations par les propres moyens des travailleurs préservant leur indépendance politique face à la bourgeoisie et menant les réformes par des méthodes de lutte de classe. Pour faire avancer les intérêts de la classe ouvrière en défense des réformes et en opposition aux libéraux, y compris sur le plan électoral, un parti des travailleurs se serait battu pour que la classe ouvrière prenne la direction du mouvement pour qu’elle arrache ce qui lui était dû, au premier chef l’indépendance du Québec (ce pour quoi aucune aile de la bourgeoisie à l’époque ne luttait d’ailleurs), mais aussi l’annulation de la dette que la bourgeoisie a fait payer aux travailleurs et l’expropriation sans compensation des compagnies électriques, ainsi que des autres secteurs clés de l’industrie, les mines, les banques, les transports, etc. Promouvoir et faire avancer de telles mesures aurait exposé le nationalisme bourgeois comme un obstacle à la lutte de libération nationale et à la promotion des intérêts de la classe ouvrière. Au lieu de cela, le prix payé pour la subordination au programme de Jean Lesage par la bureaucratie syndicale et la gauche nationaliste c’est d’avoir garanti que les intérêts économiques centraux de la bourgeoisie ne seraient pas confrontés et que l’émancipation nationale du Québec resterait inachevée.
Fondamentalement, ce sont les mêmes conclusions qui s’imposent en ce qui concerne les réformes sociales de la Révolution tranquille et la lutte pour l’émancipation des femmes. Les sociologues derrière le rapport de la Commission Castonguay-Nepveu (à l’origine de la réforme de l’assurance-maladie en 1970) parlaient eux-mêmes de la nécessité de s’attaquer aux racines sociales de la maladie dans la pauvreté et les conditions de vie en général. De même, le rapport Parent sur l’éducation préconisait la gratuité scolaire complète jusqu’à l’université pour former des citoyens capables de participer pleinement à la vie politique et aux décisions de la société tout en nourrissant une industrie nationale naissante en main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux. En effet, régler les problèmes de santé et d’éducation ne peut pas se faire juste au niveau de la gestion des établissements et des structures administratives, mais cela touche à chaque aspect de la société, des infrastructures matérielles aux conditions de travail, en passant par le logement, la recherche, le niveau culturel de la population, etc. Mais accomplir même de telles réformes élémentaires soulèvera l’hostilité du capital anglo-canadien et américain (et de leurs alliés chez les capitalistes québécois). Encore une fois, laisser la responsabilité pour de telles réformes dans les mains d’un parti ou de l’autre de la bourgeoisie québécoise garantit leur défaite. La classe ouvrière a certainement intérêt à soutenir toutes les réformes du genre qui pourraient être néanmoins accomplies, mais il doit surtout se mobiliser sur une base indépendante en étant pleinement conscient que la bourgeoisie québécoise et ses représentants politiques trahiront sous la pression du capital.
Subordonner la classe ouvrière aux partis « progressistes » de la bourgeoisie québécoise (libéraux ou péquistes ensuite), c’était condamner les réformes de la Révolution tranquille à rester fermement dans les limites que leur imposerait la bourgeoisie québécoise sur chacun de ces aspects : moderniser les services sociaux complètement vétustes qui freinait le développement de la bourgeoisie québécoise elle-même, mais développer un système de santé pour maintenir une main d’œuvre bonne pour l’exploitation au moindre coût possible, et un système d’éducation pour former une main d’œuvre juste assez compétente pour répondre aux besoins du marché, au moindre coût encore.
Encore une fois, ce n’est pas la bourgeoisie qui est la force motrice derrière ces changements. C’est seulement la poussée du prolétariat combatif, devenu hostile au clergé, qui l’a forcée à se débarrasser de ce dernier comme outil de contrôle social et qui lui a donné un point d’appui pour des réformes sociales majeures. Non seulement le clergé était devenu une entrave au développement des forces productives dans leur ensemble, mais il était devenu lui-même l’une des principales causes de révolte constante qui soulevait toute la base de la société. Il ne remplissait plus son rôle de maintenir une classe ouvrière docile et soumise et la bourgeoisie devait nécessairement le tasser pour continuer de contenir la classe ouvrière et de supprimer sa poussée.
Plus le retard « démocratique » du Québec sur ces questions se résolvait (avec la fin du contrôle de l’institution moyenâgeuse catholique sur la société, ou encore avec l’accessibilité à l’éducation dans sa langue), plus l’aspect proprement social de ces questions était soulevé, et plus le choc entre les intérêts capitalistes et les intérêts de la classe ouvrière devenait manifeste. S’appuyer sur le Parti libéral pour le progrès social ne servait qu’à enchaîner la force motrice derrière ces avancées, la classe ouvrière, et à la faire dévier de la seule voie pour faire avancer ses aspirations. Les marxistes auraient non seulement lutté pour faire rompre la classe ouvrière d’avec la bourgeoisie nationaliste, mais aussi mené un combat politique contre toutes les forces politiques qui souhaitaient maintenir l’unité avec elle. En définitive, malgré les réels progrès sociaux du Québec dans cette période, toutes les aspirations profondes qui animaient les travailleurs et les opprimés furent nécessairement déçues au terme des années de règne libéral. Celles-ci allaient entrer en éruption de façons d’autant plus « explosives » au cours des années subséquentes, seulement pour être déçues encore plus drastiquement par les années de règne du PQ.
[À suivre]