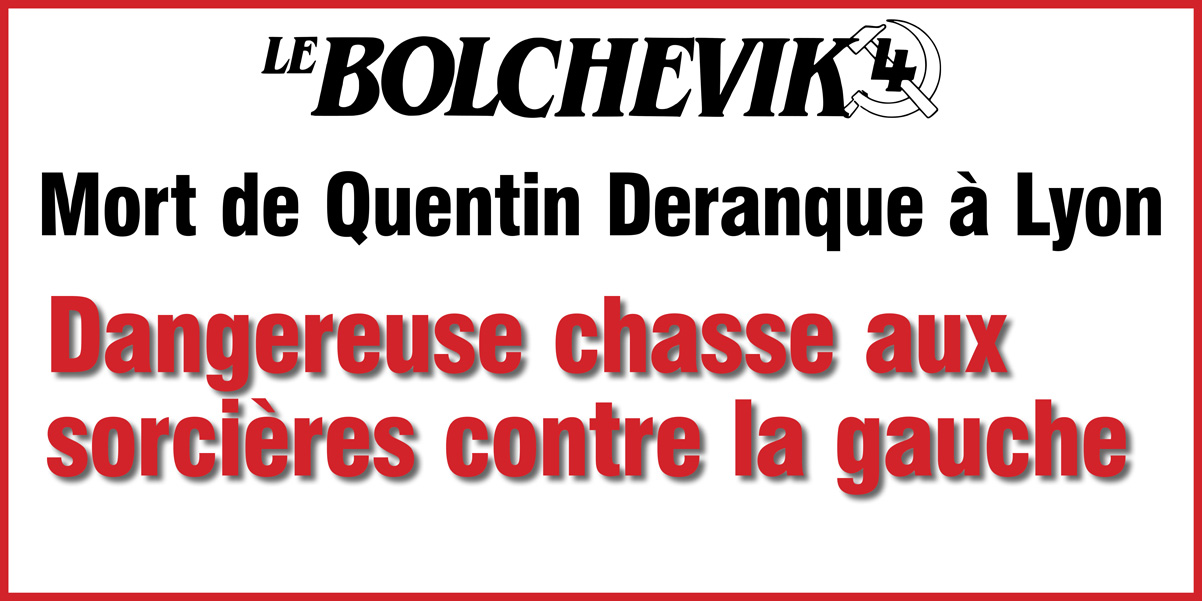https://iclfi.org/pubs/ro/6/syndicats-gauche
Malgré les crises de fin de règne de la CAQ, le mouvement syndical continue de subir des attaques constantes et personne ne semble pouvoir y résister. Le projet de loi 89 est le dernier exemple en date, où Legault et sa bande se sont sentis capables de passer avec impunité une des pires lois antisyndicales depuis des années — et la bureaucratie syndicale de leur donner essentiellement raison, elle qui n’a pratiquement rien fait pour stopper cette loi matraque ! Pourtant, une année avant les prochaines élections, le gouvernement Legault est honni et clairement en état de faiblesse. Ravagée par les scandales comme SAAQclic et Northvolt, la CAQ titube de crise en crise. Le gouvernement a dû reculer cet été sur ses coupures les plus drastiques en santé et en éducation, même si les dommages dans ces secteurs sont déjà si extrêmes que ça prendra des réinvestissements massifs pour même commencer à rétablir des services de base. Mais ça démontre bien qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que le mouvement syndical puisse ébranler Legault et casser la vague d’attaques.
Mais plutôt que de se battre pour défendre ses membres, la bureaucratie qui dirige les grandes centrales s’évertue à essayer de reconstruire un soi-disant dialogue social avec ce gouvernement en faillite. En d’autres mots, Legault est dans les câbles et plutôt que de le mettre K.O., la bureaucratie lui tend la main ! Le résultat : les droits des travailleuses et des travailleurs continuent de reculer. Le fait par exemple qu’Amazon ait pu fermer tous ses entrepôts au Québec pour contrer la syndicalisation, et ce, sans riposte sérieuse des syndicats est une catastrophe pour le mouvement ouvrier québécois (voir notre déclaration en page 4). Et depuis la défaite du Front commun de 2023-24, toutes les grèves se terminent par des reculs pour les syndiqués, sans parler du fédéral avec ses ordonnances de retour au travail à répétition.
C’est dans ce contexte que la CAQ a fait passer au printemps son projet de loi 89 qui limite encore plus le droit de grève au nom des « services essentiels ». En riposte, les centrales syndicales n’ont rien fait à part organiser quelques manifs sans conséquences et de pleurnicher que Legault déclarait « la guerre ». Effectivement : devant une telle attaque, la seule riposte sérieuse aurait été des grèves massives, sinon la grève générale dans tout le Québec, c’est-à-dire une « guerre » de classe. Mais non. Dans les faits, les chefs syndicaux acceptent depuis longtemps le cadre des « services essentiels » imposé par les gouvernements. Alors un peu plus, un peu moins…
Le mouvement ouvrier québécois, avec son taux de syndicalisation à 40 %, est l’un des plus puissants au monde, du moins en potentiel. Mais pour déployer cette puissance et arrêter les reculs constants, il faut l’utiliser. Des grèves solides, pas des affaires de trois jours ; des lignes de piquetage massives, pas des piquets symboliques imposés par la soi-disant loi anti-scabs ; la solidarité de tous les travailleurs, pas des actions isolées de syndicats divisés les uns contre les autres (comme à la STM — voir notre tract en page 5). C’est ça, et beaucoup plus, que ça prend. Mais avec son souci de garder la « paix sociale » et rétablir la « concertation » avec les patrons, la bureaucratie syndicale ne va pas mener de telles luttes. Il va falloir regarder ailleurs pour raviver le mouvement syndical au Québec.
Que fait la gauche ?
Même si la gauche est petite au Québec, il se trouve quand même des centaines de militants actifs dans différents groupes socialistes, syndicalistes et autres. Ça devrait être une tâche centrale pour ces militants de combattre l’aplaventrisme de la bureaucratie et de mobiliser la base des syndicats derrière une véritable alternative qui rejette la « bonne entente » avec les patrons. Cela nécessite évidemment un combat politique ouvert contre les chefs syndicaux actuels, tâche certes difficile, mais essentielle. Sinon tout va continuer de reculer.
Alors quel est l’état des choses à gauche, que fait la gauche québécoise pour faire avancer ces luttes ? Malheureusement, il semble, pas grand-chose.
Mentionnons d’abord Québec solidaire, puisque c’est l’organisation dite de gauche la plus reconnue au Québec. QS prend parfois des positions correctes à l’Assemblée nationale, comme s’opposer au PL 89. Mais ses crises à répétition de ces derniers mois indiquent bien l’état de désarroi dans lequel cette organisation se trouve. Ses défections fracassantes, tant de l’aile gauche (Catherine Dorion) que de l’aile droite (Gabriel Nadeau-Dubois) sont symptomatiques d’un parti en chute libre. Les sondages prévoient que QS sera essentiellement rayé de la carte aux prochaines élections.
Mais au-delà des débats idéologiques qui déchirent l’organisation, la véritable cause de l’état lamentable de QS est bien plus profonde. C’est qu’un tel parti dit « citoyen », qui ne se base pas sur le mouvement ouvrier, mais sur les classes moyennes éduquées et les étudiants, typiquement en milieu urbain (Plateau Mont-Royal et autres quartiers St-Jean-Baptiste), n’a aucune assise sociale pour sérieusement défier l’ordre établi. La classe moyenne (la petite bourgeoisie), divisée en plein de petits sous-groupes, n’a pas la cohésion sociale, ni les intérêts communs, ni la puissance sociale qui lui permettraient de combattre le capitalisme. Typiquement, dans les grands moments historiques, la classe moyenne suit l’une des deux classes principales dans la société : la bourgeoisie ou la classe ouvrière. Depuis 2006 que QS s’évertue à trouver une façon de « dépasser le capitalisme » sans tracer une ligne de classe et se mettre résolument du côté des travailleurs. Au plus, comme pour la nouvelle porte-parole Ruba Ghazal, QS se contente-t-il de relayer les appels de la bureaucratie syndicale pour la « concertation » et le « dialogue social ». Clairement, le mouvement ouvrier ne sera pas ressuscité par un tel oiseau.
Bien plus à gauche on trouve le Parti communiste révolutionnaire. Le PCR prodigue beaucoup d’analyses de la situation mondiale, et celle au Canada et au Québec. Il a consacré plusieurs articles et balados à la crise dans QS par exemple, et déplore aussi le manque de combativité du mouvement ouvrier. Le PCR appelle correctement les syndicats à défier les lois de retour au travail et argumente pour plus de combativité, prônant entre autres « les grèves et les occupations » comme tactiques qui permettraient aux syndicats de relever la tête. Le PCR organise même quelques factions communistes au sein des syndicats, comme dans le syndicat des postiers.
Tout cela représente des pas dans la bonne direction, mais ce qui manque au PCR c’est une perspective de mener une opposition à la bureaucratie syndicale. Dans toutes ses interventions et tous ses textes, le PCR évite soigneusement de mettre au défi les chefs syndicaux avec autre chose que des platitudes marxistes générales. Pourtant, la raison d’être d’une faction communiste dans les syndicats doit précisément être de contrer la bureaucratie, de l’exposer et de proposer une direction alternative dans les luttes quotidiennes des syndiqués. En d’autres mots, il faut se battre pour une direction révolutionnaire des syndicats, pas seulement en parole, mais dans les actions de tous les jours ; sinon, toutes les bonnes idées de militantisme resteront lettre morte.
Quand les camarades du PCR sont questionnés sur leur refus de directement combattre la bureaucratie dans les luttes concrètes, ils répondent généralement qu’ils sont « trop petits » et que ce sera une tâche pour « plus tard ». Mais ce n’est pas plus tard, mais maintenant que la classe ouvrière a besoin d’une direction alternative ! Avec leur attentisme « révolutionnaire », le PCR abdique dans les faits le combat contre la bureaucratie et sert au mieux de voie de contournement pour des jeunes qui devraient, en fait, se lancer pleinement dans la lutte pour une nouvelle direction des syndicats au Québec et au Canada. Et il s’assure que la gauche reste inefficace et… « trop petite » : effectivement, les travailleurs embarqueront quand la gauche pourra leur démontrer, concrètement, pas tant la supériorité de la théorie marxiste (aussi important cela soit-il), mais celle des marxistes à les aider à gagner des luttes dans le monde réel.
Dans un autre coin de la gauche québécoise, le groupe Alliance ouvrière a eu son congrès de fondation à Montréal en décembre 2024. AO s’est fondé sur un programme pour raviver le mouvement ouvrier dans une perspective de guerre de classe et en avant vers la grève politique. Ce sont les militants fondateurs d’AO qui ont mené la lutte pour la syndicalisation d’Amazon à Laval et le congrès reflétait la grande autorité acquise par cette victoire. Des militants de la Ligue trotskyste ont rejoint AO et nous encourageons tout le monde dans la gauche à faire de même.
Malheureusement, c’est justement la fermeture d’Amazon, en réponse directe à la syndicalisation, qui a exposé toutes les faiblesses d’AO. Se contentant d’abord de suivre la bureaucratie de la CSN dans son boycott de consommateur complètement inefficace, AO a ensuite viré à gauche en organisant des actions de petits groupes pour bloquer différents points de distribution d’Amazon. Mais rien de tout cela n’a fait reculer Amazon, ni même gagné un sou de plus pour ses travailleurs licenciés. C’est qu’AO, tout comme le PCR, refuse de confronter les dirigeants syndicaux et préfère toutes sortes de diversions. Aussi militantes soient-elles, les actions de blocage déconnectées de la lutte syndicale ne mobilisent en rien la masse des travailleurs, qui sont enchaînés par leurs dirigeants aux sornettes de légalisme et de « dialogue social ».
AO répliquerait que la campagne de boycott a été un succès parce qu’elle a été largement suivie au Québec. C’est vrai — mais tout ce que cela indique, c’est l’énorme potentiel qu’il y aurait eu pour une vraie lutte syndicale contre Amazon. Mais les dirigeants syndicaux se sont évertués à l’empêcher — et AO refuse de challenger ces dirigeants, avec essentiellement la même excuse que le PCR d’ailleurs — nous sommes « trop petits » ou n’avons pas « la légitimité » d’entreprendre un tel combat. Mais la bureaucratie syndicale n’a pas plus de « légitimité » à saborder le pouvoir syndical — c’est devant un véritable combat entre celle-ci et les militants qui cherchent à rebâtir les syndicats sur une base de lutte de classe que les travailleurs pourront décider d’eux-mêmes qui est « légitime » ou non !
Il existe encore plusieurs autres petits groupes de gauche, tous avec leurs différences idéologiques, mais ils partagent tous à peu près la même tare : un refus systématique de combattre la bureaucratie syndicale et de proposer une direction alternative. Pourtant, si la gauche québécoise ne sort pas de son fatalisme et de son manque d’ambition navrant, le mouvement syndical québécois va continuer de péricliter.